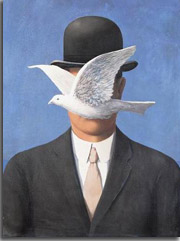
J. Belaisch,
PARIS
L’anonymat dans le don des gamètes et le secret qui entourent ces dons est un sujet représentatif de l’état d’esprit régnant aujourd’hui et ce, sur deux plans : celui de la pression exercée sur l’ensemble de la population par des personnes affirmant un point de vue excessif et celui d’un désir de transparence à tout prix, comme si c’était là une qualité majeure qui avait « le droit » d’écraser tous les autres points de vue.
Depuis quelque temps, une tendance se manifeste dans le monde
entier en faveur de la révélation de l’IAD et pour l’abandon
complet de l’anonymat des donneurs. Le débat sur les avantages
respectifs du secret et de la révélation reste cependant largement
ouvert. En France, une proposition de loi a été déposée à
l’Assemblée Nationale le 28 juin 2006 ; elle serait cependant
caduque du fait des résultats des dernières élections. Georges
David, au nom de l’Académie de Médecine, a posé à ce sujet quelques
questions essentielles. La littérature internationale témoigne de
l’ampleur du sujet.
Le but de cet exposé est de connaître et de transmettre l’opinion
spécifique et l’expé-rience des gynécologues intéressés, afin de
les confronter aux publications récentes parues dans la presse
mondiale. Ils savent mieux que quiconque ce qu’est la situation du
père légal qu’ils connaissent et dont ils comprennent qu’il ne
veuille pas que son handicap soit connu. Il est pour eux normal
qu’il souhaite que son enfant l’aime comme un père au plein sens du
terme, et ils pensent aussi que l’enfant pourrait en bénéficier en
retour.
Les psychothérapeutes ont un point de vue nécessairement
particulier. Ils croient, en raison de l’expérience qu’ils ont
acquise au contact de sujets qui leur ont décrit leurs souffrances
existentielles, que la levée de l’anonymat pourrait avoir sur eux
des effets bénéfiques. Leur bonne foi est totale.
Madame Delaisy de Perceval (1) a pris la défense de cette catégorie
de patients. Pour elle, seuls les hommes de stérilité définitive et
incontestable ont recours au don de sperme, ce qui n’est pas le
cas, et souvent l’enfant est le fils de son père légal, alors que
ce dernier était seulement sévèrement oligospermique.
D’autre part, elle admet que, par principe, l’enfant est descendant
du donneur, comme si la mère était enfermée dans un harem.
C’est-à-dire qu’elle néglige la double incertitude biologique et
sociale.
En outre, on peut penser que ces expériences sont biaisées car
ces psychothérapeutes ne rencontrent que les personnes pour
lesquelles le secret a été un échec.
Or, il est nécessaire de peser, pour l’ensemble de la population,
les avantages et les inconvénients de l’attitude adoptée. Et dans
cette situation, les tenants du secret ne peuvent se faire entendre
que par leur silence (mais on verra que celui-ci « parle » tout de
même en faveur de son maintien). Et c’est en cela qu’il est
indispensable que chacun puisse bénéficier de l’opinion des
gynécologues ayant suivi pendant des années les couples après une
insémination.
Personne ne peut ignorer les inconvénients potentiels du secret. La
mère est probablement hantée par de nombreuses questions : a-t-elle
fait le bon choix par rapport à son mari ? Et pour l’enfant,
qu’arriverait-il s’il se doutait un jour de ce qui lui est caché et
davantage encore s’il en avait la preuve ?
Nous n’avons eu qu’une seule fois l’occasion d’observer un échec du
secret, contre de très nombreuses évolutions parfaitement banales
et très satisfaisantes. Mais il est vrai que plusieurs couples
n’ont pas été suivis longtemps.
La littérature montre les deux facettes de la réflexion théorique
de ce délicat problème. Elle apporte aussi des informations
chiffrées d’un certain intérêt pratique.
Que se passerait-il si la levée du secret et de l’anonymat du
donneur étaient décidés ? Deux problèmes sont intimement liés :
l’effet de la levée de l’anonymat sur les dons et les conséquences
de la révélation sur la vie de l’enfant.
Point de vue des donneurs
En 1985, la législation suédoise donne accès à l’identité du
donneur. Depuis cette date, des études ont été réalisées pour
connaître les effets possibles sur la collecte des dons de sperme.
Elles révèlent un fait largement attendu : la réponse des donneurs
varie selon les pays. Aux États-Unis, la motivation pécuniaire est
primordiale : 69 % des donneurs refuseraient de continuer à donner
s’ils n’étaient pas rémunérés et de préférence dans l’anonymat(2).
En Australie, selon Rowland (3), la majorité d’entre eux ne refuse
pas que l’on donne quelques informations, mais pas leur nom ; et la
moitié accepterait de rencontrer à 18 ans leur enfant. Une enquête
danoise (4) montre que 20 % seulement des donneurs persisteraient
si l’anonymat était levé : 60 % donnent pour des raisons à la fois
altruistes et financières ; 76 % acceptent que l’on fournisse des
informations phénotypiques non identifiantes, mais 28 à 40 %
seulement des données psychosociales.
En France, le don est gratuit et l’altruisme (avec toutes les
réflexions que comporte ce concept) est la principale
motivation.
Une publication de 2007 (5) apporte un éclairage complémentaire :
les banques de sperme nord-américaines se dirigent vers l’« open
identity donor insemination », c’est-à-dire que le donneur accepte
que l’enfant, avant ou à 18 ans, puisse connaître son identité s’il
le souhaite et accepte de le rencontrer au moins une fois. Depuis
10 ans, la proportion de ces banques et des donneurs acceptant
l’absence d’anonymat s’est accrue régulièrement. Cette information
met-elle un point final à ces interrogations ? Non, car les
dernières lignes de l’article précisent que les couples de
lesbiennes et les femmes seules sont la première « force » qui
pousse vers cette évolution. Et dans ce cas, les réticences
masculines, principale justification et moteur du secret, sont
absentes !
Les personnes intéressées devront lire un article récent,
farouchement en faveur de la levée de l’anonymat, analysant la
situation en Europe. Il ne s’agit pas d’un article médical stricto
sensu (et il est d’ailleurs impossible de connaître la profession
des auteurs). Il fait preuve d’une objectivité légale, sans doute
volontairement, dépourvue de tout sentiment ou émotion (6).
Les parents potentiels
En 1997, Brewaeys (7) a rapporté la préférence des parents : 57
% préféreraient un don anonyme ; 31 % des informations non
identifiantes. De même pour Rowland (3), les trois quarts des
couples potentiels maintiendraient le secret.
En miroir, dans un travail français, 70 % des couples ayant
bénéficié d’un don d’ovocytes ont gardé le secret pour leur enfant
(8).
En somme, que le don soit de sperme ou d’ovocytes, les couples ont
une préférence affichée pour le secret.
Du côté des enfants
Certains enfants peuvent souffrir d’une atmosphère particulière
provoquée soit par les efforts du père social pour conserver le
secret(9), soit due aux perturbations psychologiques pouvant
exister chez la mère. La religion des psychothérapeutes est faite
sur ce point. En outre, le droit des enfants à connaître leur
origine ne leur est pas donné si le secret reste (10).
Pourtant 3 observations objectives tempèrent ces réflexions :
Sangren (11) au Danemark n’a observé aucun effet délétère dans le
développement psychosocial chez les enfants nés après insémination
(mais aucun adulte n’avait été interrogé). Les 22 couples
sélectionnés par Schilling (Allemagne) avant IAD ont témoigné que
leurs enfants étaient proches de l’image idéale de l’enfant qu’ils
se faisaient.
Enfin et surtout, Georges David (12) élargit la question en
rapportant que sur les 15 dernières années, moins de 25 adolescents
ou adultes conçus par IAD ont spontanément pris contact avec
l’ensemble des CECOS, en vue d’obtenir des informations
déterminantes les concernant. Si l’on se souvient de ce que 50 000
enfants sont nés dans cette situation et que la moitié d’entre eux
sont adolescents ou plus âgés, on relativise le retentissement du
secret quant à la fréquence des troubles (mais non à leur
degré).
D’autre part, un psychologue lyonnais, après de multiples appels
par la presse, n’a pu rencontrer que 21 jeunes dont seulement 2
auraient souhaité connaître le donneur ! Il n’est donc pas exclu
qu’il pourrait y avoir plus d’inconvénients que d’avantages à
modifier l’état des choses.
Qu’en serait-il aussi de ces révélations sur les enfants nés de
père inconnu (environ 15 000 par an) ? Et quel serait le sort des
enfants nés dans des couples constitués et qui ne sont pas les
enfants du conjoint légal ?
En bref, la situation est loin d’être idéale et des progrès sont
nécessaires pour éviter des souffrances à venir par une
anticipation raisonnée. Les gouvernants et les parlementaires ont
raison de se pencher sur ces sujets, à condition de tenir compte de
la diversité des situations et des opinions de toutes les personnes
impliquées. Les gynécologues sont en pre-mière ligne pour les y
aider.
Il y a plus de 30 ans déjà, un couple d’universitaires avait
accepté d’être interviewé dans un film que nous réalisions sur les
traitements de la stérilité et de faire part de leurs réflexions
devant l’azoospermie incurable du mari. Leur analyse était
remarquablement pointue. Six mois plus tard, ils étaient revenus
pour dire qu’ils avaient renoncé à l’IAD, parce que la femme
estimait qu’il fallait révéler à l’enfant les conditions de sa
naissance et que son mari pensait qu’il fallait les taire ! Aucun
n’ayant pu convaincre l’autre, ils avaient abandonné. La question
reste toujours d’actualité, mais la recherche d’une réponse
entièrement satisfaisante, sans la pression agressive que mettent
certains, est digne des efforts poursuivis.
Une des causes de la révélation non désirée d’un don tient dans les
confidences, faites par les couples à des parents ou amis, de leur
grave stérilité. Il serait peut-être préférable de se contenter,
quand le besoin de se confier est insurmontable, de parler de
difficultés à concevoir sans les qualifier et de décrire la
souffrance qu’elles provoquent sans aller plus loin, quelle que
soit la confiance que l’on a dans ses amis
!
Références
1. Delaisy de Parseval G. Pour la levée de l’anonymat dans le
don de gamètes. Gynécologie, Obstétrique & Fertilité 2007 ; 35
: 691-4.
2. Sauer MV, Gorrill MJ, Zeffer KB, Bustillo M. Attitudinal survey
of sperm donors to an artificial insemination clinic. J Reprod Med
1989 ; 34(5) : 362-4.
3. Rowland R. Attitudes and opinions of donors on an artificial
insemination by donor (AID) programme. Clin Reprod Fertil 1983 ;
2(4) : 249-59.
4. Pedersen B, Nielsen AF, Lauritsen JG. Psychosocial aspects of
donor insemination. Sperm donors--their motivations and attitudes
to artificial insemination. Acta Obstet Gynecol Scand 1994 ; 73(9)
: 701-5.
5. Sheib JE, Cushing RA. Open identity donor insemination in the
United States: is it on the rise? Fertil Steril 2007 ; 88 :
231-2.
6. Guibert J, Azria E. Anonymat du don de gamètes : protection d’un
modèle social ou atteinte aux droits de l’homme ? Journal de
Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction
(2007).
7. Brewaeys A, Golombok S, Naaktgeboren N, de Bruyn JK, van Hall
EV. Donor insemination: Dutch parents’ opinions about
confidentiality and donor anonymity and the emotional adjustment of
their children. Hum Reprod 1997 ; 12(7) : 1591-7.
8. Karpel L, Flis-Trèves M, Blanchet V, Olivennes F, Frydman R.
Oocyte donation: parents’s secrets and lies. J Gynecol Obstet Biol
Reprod 2005 ; 34(6) : 557-67.
9. Schilling G. Parents judge their children after artificial
insemination by donor. Z Psychosom Med Psychother 1999 ; 45(4) :
354-71.
10. David G. Filiation in assisted reproduction with donor gametes.
J Gynecol Obstet Biol Reprod 2000 ; 29(3) : 323-5.
11. Sångren H, Schmidt L. The secrecy aspect of donor insemination.
Ugeskr Laeger 2001 ; 163(11) : 1549-51.
12. David G. À propos de la proposition de loi (juin 2006) relative
à la possibilité de lever l’anonymat des donneurs de gamètes.
Gynecol Obstet Fertil 2007 ; 35 : 486-90.




