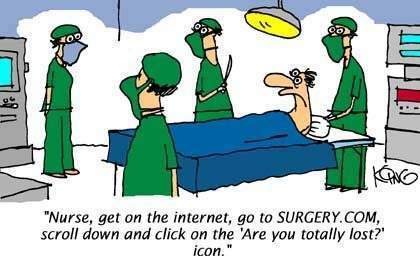
Qu’est-ce qu’il y a de drôle ?
L’engouement des médecins pour les blagues et mots d’esprit a été clairement constaté par Clément Pacault et Damien Maurin. En 2013, les deux compères, à l’aube de finir leur internat choisissent un sujet de thèse jubilatoire : les blagues médicales. Objectif déterminer : « quels sont les stéréotypes sur notre profession de médecin qui se dégagent d’un verbatim de blagues recueillies au sein d’une population médicale » comme le précisent les deux praticiens dans l’introduction d’un article qu’ils viennent de publier sur le sujet dans la Presse médicale. D’abord, bien sûr, il fallait constituer le « corpus » de ces fameuses blagues médicales. Via Twitter, Facebook, la messagerie internet et autres modes de communication plus ou moins modernes, les deux praticiens sollicitent tout d’abord l’attention des médecins et les invitent à se connecter sur leur blog accessible à l’adresse http://humourmedical.overblog.com. Là les médecins sont incités à remplir un formulaire et surtout à livrer la « blague impliquant des médecins » les ayant fait le plus rire. Clément Pacault et Damien Maurin vont rencontrer un succès qu’ils n’espéraient pas. Entre le 6 juin et le 14 juillet 2013, ils récoltent 512 histoires drôles mettant en scène le corps médical, un résultat « largement au dessus de nos estimations » confieront-ils.Médecin et sexualité : le thème incontournable
Commençait alors un harassant travail de classification épistémologique : à quel stéréotype rattacher chacune des blagues ainsi racontées. A partir des 220 plaisanteries retenues (émanant, soulignons le au passage d’hommes dans 63 % des cas…), des stéréotypes ont été fréquemment identifiés et six thèmes ont pu être dégagés. « Les vicissitudes du métier de médecin, la guerre entre collègues du bloc opératoire à l’hôpital, les traits de personnalité du médecin, les études médicales et les malheurs du carabin, sans oublier le psychiatre – un grand classique – et évidemment "médecin et sexualité", thème considéré comme le must de l’humour médical potache » énumère le journaliste scientifique Marc Gozlan qui sur son blog « Réalités biomédicales », fait un résumé apparemment non dénué de plaisir de la thèse et de l’étude des deux praticiens.Dieu et les chirurgiens
Le journaliste poursuit en remarquant que « les blagues sur l’hôpital sont majoritaires » avec deux personnages principaux : les chirurgiens et les anesthésistes. Les premiers y sont présentés sous les traits de mégalomanes, "têtes brûlées " et peu soucieux de leurs patients, avec, emblématique, une blague récurrente : « Quelle est la différence entre Dieu et un chirurgien ? Dieu ne se prend pas pour un chirurgien ». Les seconds semblent plus endormis que leurs propres patients et ont pour unique manie la consommation de café. « Que fait un anesthésiste entre deux cafés ? Il boit du café ».Le psychiatre : un héros récurrent des blagues médicales
Autre cible privilégiée des humoristes : les psychiatres. « Ils sont avant tout décrits comme ne devant pas écouter leurs patients afin de se protéger : ‘Que fait un psychiatre quand son patient est absent avant son RDV ? Il commence sans lui’ », cite Marc Gozlan. Les internistes bien sûr en prennent aussi pour leur grade, dans des histoires très probablement inventées par des médecins eux-mêmes. Ainsi, sont-ils dépeints sous les traits de ceux qui « savent tout mais ne font rien », s’amuse Hervé de Maisonneuve qui a lui aussi pris plaisir sur son blog à évoquer cette publication dans La Presse médicale. Enfin, les grands classiques sont les blagues à caractère sexuel, qui sont légions et qui plus encore que toutes autres confirment bien la fonction de catharsis de la plaisanterie médicale.Les médecins (non anesthésistes) pensent-ils vraiment qu’ils ne sont bons qu’à boire du café ?
Mais au-delà du sourire, que disent ces blagues sur les stéréotypes médicaux, et plus encore que dit l'attention que les praticiens portent à ces plaisanteries ? Ces sarcasmes, véhiculant des stéréotypes « assez caricaturaux » notent les deux jeunes médecins généralistes, confirment d’abord que les praticiens prennent garde de ne pas s’épargner eux-mêmes et surtout leurs confrères. Faut-il y voir un reflet de leurs rapports professionnels ? Il n’est pas impossible que les plaisanteries ainsi distillées soient une façon d’assouplir le « carcan » de la confraternité, tout en la renforçant d’une manière plus chaleureuse. « Les médecins en se moquant d’eux-mêmes, renforcent ainsi leur appartenance au corps médical » remarquent Clément Pacault et Damien Maurin. Ces blagues si riches en stéréotypes permettraient également d’alléger le poids d’une forte compétition. Cependant, on ne peut totalement écarter que ces plaisanteries reflètent un tant soit peu l’idée que les médecins se font les uns des autres. « Nous pensons que ces stéréotypes restent dans le domaine de l’imaginaire. Mais cela mérite d’être creusé » répondent sur ce point les jeunes médecins au Quotidien du médecin. L’étude en tout état de cause aura permis de susciter le sourire de plusieurs blogueurs et de la presse médicale et de rappeler comme le faisait Alphonse Allais cité par Marc Gozlan que « les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux ».Pour rire un peu plus vous pouvez lire le résumé de l’article sur le site de la Presse médiale :
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0755498214004199
et découvrir un florilège des blagues étudiées par les docteurs Clément Pacault et Damien Maurin sur le blog de Marc Gozlan :
http://biomedicales.blogs.sciencesetavenir.fr/archive/2014/10/18/humour-une-these-de-medecine-sur-les-blagues-medicale-23092.html
Aurélie Haroche




