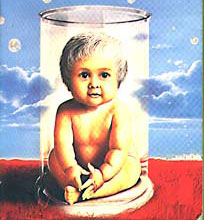
Boston, le mercredi 18 mars 2015 – Brossant le portrait de la chercheuse française Emmanuelle Charpentier, nous évoquions récemment dans ces colonnes le caractère révolutionnaire de ses travaux qui ont contribué à considérablement simplifier les méthodes de modification d’un gène dans une cellule, les rendant quasiment aussi accessibles qu’un "jeu d’enfant" selon l’expression de la Fondation Louis-Jeantet qui lui a récemment décerné son prix annuel. Les nouvelles technologies d’édition du génome ou CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Plaindromic Repeats), parfois également décrites comme des "ciseaux moléculaires" ont de fait été très rapidement adoptées par les laboratoires de biologie moléculaire du monde entier. Pour donner une idée de la généralisation de ces méthodes, Laurent Alexandre spécialiste (entre autres !) de questions d’éthique explique dans les colonnes du site Atlantico : « Il faut bien comprendre que le coût des enzymes qui permettent de modifier nos chromosomes a été divisé par 10 000 en sept ans. Ces enzymes coûtent aujourd’hui douze dollars à fabriquer. Autrement dit, un étudiant en troisième année peut le faire sur sa paillasse entre le déjeuner et le goûter. A l’horizon 2020, ce sera aussi simple que de rédiger un texte sous Word. C’est d’ailleurs pour cela que l’on parle « de gene editing ». La technologie permettant de modifier l’ADN dans nos cellules est donc en train de devenir banale » affirme-t-il.
Une première qui inquiète à Harvard ?
Cette "révolution" représente un espoir très important pour des milliers de chercheurs et des millions de malades à travers le monde. En effet, cette nouvelle technique porte la promesse de traitement pour de nombreuses maladies génétiques. Cependant, elle fait également redouter des dérives. Pour de nombreuses équipes, la limite à ne pas franchir est la modification de cellules germinales. Mais, celle-ci a déjà été dépassée.
La semaine dernière le quotidien britannique The Independent consacrait en effet un reportage aux recherches d’une équipe d’Harvard conduite par un jeune chercheur chinois Luhan Yang, qui travaille au sein du laboratoire dirigé par George Church, l’un des grands noms de la génétique aux Etats-Unis. Les travaux de Luhan Yang ont consisté à tenter de modifier le génome de tissus ovariens d’une femme porteuse d’une prédisposition au cancer des ovaires, afin d’éviter l’expression du gène BRCA1. Selon The Independent et la Technology Review éditée par le MIT, ces travaux et leurs résultats doivent faire l’objet d’une publication prochaine : ils sont les premiers rapportant une tentative de modification génétique de cellules germinales.
Couper court
Cette première n’est pas sans inquiéter de nombreux scientifiques. La veille même de la présentation des recherches de Luhan Yang par The Independent, cinq chercheurs appartenant à la firme biopharmaceutique Sangamo BioSciences appelaient dans une tribune publiée par Nature à la vigilance et à un moratoire sur tous les travaux visant une modification génétique de cellules germinales. Ces chercheurs sont tous des grands spécialistes du « gene editing » et font donc état de leurs préoccupations en connaissance de cause. Les inquiétudes des spécialistes concernent tout d’abord les nombreuses incertitudes quant aux risques de cette méthode pour les embryons qui pourraient être issus de cellules ainsi modifiées. La technique CRISPR si elle est révolutionnaire n’est cependant pas parfaitement fiable : que se passerait-il en cas de ratés des "ciseaux moléculaires" ? Pour Jean-Louis Serre, professeur de génétique à l’université de Versailles, le danger est élevé. Pour Atlantico, il résume : « Si les gamètes étaient utilisés après manipulation à des fins de fécondation, cela pourrait soit mener à pas grand-chose, car une fois touchées, les cellules reproductrices peuvent ne pas se développer, soit à une sorte de monstre ». Au-delà de ces inconnus sur les risques de cette méthode, toute manipulation des cellules germinales et de l’embryon soulève des questions éthiques, notamment parce qu’il est impossible de prévoir les conséquences pour la descendance. Et surtout, beaucoup s’inquiètent d’une utilisation de ces techniques à des fins non thérapeutiques, mais eugéniques.
Un moratoire voué à l’échec
L’idée d’un moratoire afin d’engager une véritable réflexion éthique à l’échelon international comme le suggèrent les chercheurs signataires de la tribune dans Nature peut-elle être néanmoins envisageable ? Laurent Alexandre ne se fait pas beaucoup d’illusion. « Bien que les dangers existent, ce sera un moratoire de plus qui ne sera pas respecté. Il en est allé de même avec la conférence d’Asilomar en 1975, à l’issue de laquelle tous les généticiens présents s’étaient engagés à ne pas manipuler les bactéries. Cette résolution n’a pas tenu 15 jours. Au début des années 80, on disait la même chose sur la fécondation in vitro. Si les scientifiques n’ont pas respecté leurs engagements, c’est parce qu’ils se rendaient bien compte que les autres ne le feraient pas non plus, et qu’ils se mettraient ainsi en retard » remarque le spécialiste. Par ailleurs, outre la difficulté pour des chercheurs de se « brider » eux-mêmes, la pression de la société est également importante. Aujourd’hui, parallèlement à l’inquiétude et à l’indignation que suscite l’idée de manipulation de cellules germinales, d’autres y voient la promesse de l’éradication de maladies mortelles et hautement invalidantes. D’ailleurs, une enquête réalisée en 2014 aux Etats-Unis, citée par la Technology Review met bien en évidence cette attente. Ainsi, si 83 % jugent totalement inconcevable l’idée de manipuler un embryon pour rendre l’enfant plus intelligent, ils ne sont plus que 50 % à estimer que la science irait trop loin s’il s’agissait d’éviter le risque d’une maladie grave…
Gardes fous
Ainsi, bien plus que des moratoires, il semble que des gardes fous soient nécessaires, notamment législatifs. D’ailleurs, aujourd’hui, dans la très grande majorité des pays occidentaux, la manipulation génétique de cellules germinales avant fécondation est interdite et passible de peines de prison.
Reste à trouver un équilibre entre la nécessaire sauvegarde de l’éthique et l’avancée de la science.
Aurélie Haroche




