
Paris, le vendredi 22 mai 2015 – Parmi les dispositions du projet de loi de santé qui seront les plus discutées lors de la présentation du texte au Sénat, figure sans doute l’amendement tentant de modifier les conditions de recueil de la position d’un défunt vis-à-vis du prélèvement de ses organes. On s’en souvient les professeurs Jean-Louis Touraine et Michèle Delaunay ont soutenu un amendement visant à revenir à l’esprit de la loi d’Henri Cavaillet de 1976 instaurant le principe du don d’organe. Selon ce texte, le consentement de tout défunt doit être considéré comme présumé. Seule façon de s’opposer à cette "logique systématique", s’inscrire sur le registre des refus qui compte aujourd’hui 90 000 noms. Cependant, tant l’évolution de l’activité de transplantation que celle de la société n’ont pas permis de maintenir une telle stratégie. En 1994, le législateur amendait la loi Cavaillet et précisait que le recueil de la position du défunt devait être réalisé par « tous moyens », notamment par un dialogue avec la famille. Cette modification, si elle a contribué à renforcer la confiance du grand public dans l’activité de prélèvement et de greffe, aurait favorisé une diminution importante des prélèvements. Nombreuses en effet sont les familles qui ignorent la position de leur proche, voire qui, frappée par une douleur soudaine, choisissent de s’opposer tout simplement au prélèvement. Dans ce contexte, l’amendement de Jean-Louis Touraine et de Michèle Delaunay visait selon ces derniers à libérer les proches de ce poids, tout en acordant à chacun « la présomption de générosité » selon l’expression de l’ancien ministre aux Personnes âgées sur son blog.
Le gouvernement fait don de son ambiguïté, rejetée par tous
Face aux nombreuses critiques qu’a cependant suscitées cette initiative parlementaire totalement inattendue, lancée sans aucune concertation avec les équipes concernées, le gouvernement a choisi d’introduire une nuance. Le texte précise en effet aujourd’hui que l’opposition au prélèvement d’organe devra être « principalement » matérialisé par l’inscription au registre national des refus. Une précision qui laisse ouverte la possibilité que d’autres moyens (qui pourraient être fixés par décret) seront encore admis, parmi lesquels, éventuellement, la présentation de sa position à sa famille. Une ambiguïté qui a beaucoup déçu les auteurs de l’amendement qui l’ont considéré comme dépourvu de sa force et de son sens, mais qui n’a nullement rassuré ceux qui refusent de contourner l’avis de la famille. Une ambiguïté qui a en outre autorisé à Marisol Touraine un jeu d’équilibriste, affirmant un jour à l’Assemblée que le texte marquait une très importante avancée et assurant le lendemain à un citoyen l’interrogeant sur une radio que rien n’allait changer…
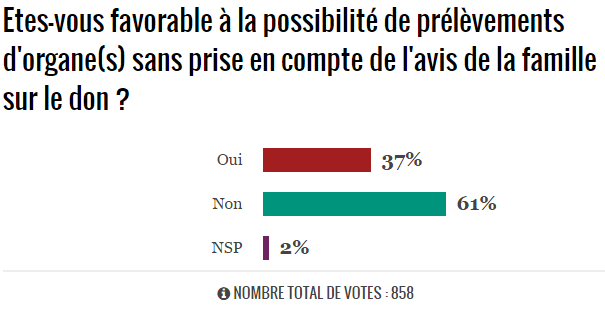
Sondage réalisé du 27 avril au 20 mai
Une opposition marquée de ceux qui sont sur le terrain
Dans ce débat, les professionnels de santé ont pour la plupart exprimé leur désapprobation. Outre les arguments refusant de considérer un patient comme un « réservoir de pièces détachées », beaucoup ont surtout insisté sur l’importance de conserver un lien de confiance avec les familles. Les spécialistes du prélèvement sont notamment montés au créneau, pour dénoncer l’absence de concertation et pour s’inquiéter des troubles qu’une telle mesure pourrait entraîner. Enfin, l’Ordre des médecins s’est clairement exprimé contre l’absence de consultation des proches. S’inscrivant dans cette même lignée, la majorité de nos lecteurs (61 %) se sont déclarés défavorables à la possibilité de prélèvements d’organe(s) sans prise en compte de l’avis de la famille sur le don, au cours d’un sondage réalisé du 27 avril au 20 mai auquel 858 lecteurs du JIM ont répondu. Ainsi, seuls 37 % des professionnels de santé partagent le point de vue de Jean-Louis Touraine et Michèle Delaunay qui affirment que le recueil de l’opinion de la famille n’est pas indispensable. Vision matérialiste de l’existence (que certains considéreront poussée à l’extrême) et sentiment que l’impérieux besoin d’organes peut justifier que le prélèvement soit plus systématiquement présumé animent sans doute les 37 % de professionnels de santé qui se déclarent favorables à la non prise en compte de la position de la famille, ne serait-ce que pour tenter de déterminer l’opinion du défunt. Une autre perception de la vie et du respect dû aux êtres (même morts) ont sans doute inspiré les répondeurs majoritaires ; tandis qu’on remarquera qu’un sujet aussi délicat et complexe n’a pourtant pas laissé un nombre important de praticiens (2 %) dans l’indécision. Transparaît sans doute ici le fait que plutôt qu’un dossier mêlant pragmatisme et éthique, cette question renvoie à des considérations philosophiques et existentialistes, qui laissent moins de place à la circonspection. En tout état de cause, les résultats de ce sondage représenteront un argument supplémentaire pour ceux qui, sans doute nombreux, tenteront au Sénat de revenir sur ce texte.
Aurélie Haroche




