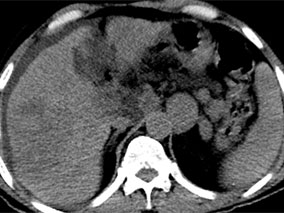
Le carcinome hépatocellulaire (HCC) est la plus fréquente des tumeurs primitives du foie. Il s’agit du 5e cancer par ordre de fréquence mais le 3e en terme de mortalité. Il se développe habituellement sur une hépatopathie chronique, virale ou toxique. Différentes modalités de dépistage par imagerie sont possibles : échographie (US), sans ou avec injection de micro bulles (technique à ce jour non approuvée par l’US Food and Drugs Administration), scanner (CT) ou imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM), elles mêmes généralement couplées à l’utilisation d’agents de contraste vasculaires, du fait de la nature typiquement hyper vascularisée de l'HCC.
R Chou et ses collègues, de l’Agency for Healthcare Research and Quality, ont voulu évaluer de façon comparative les performances de ces différentes techniques d’imagerie, tant dans la détection des HCC que dans celles des lésions focales du foie. Ils ont, dans ce but, conduit une recherche bibliographique à partir des principales banques de données informatiques: MEDLINE, de 1998 à Décembre 2014, Cochrane Library Database et Scopus, complétée par d’autres sources. De façon habituelle, un investigateur a extrait les données pertinentes des articles sélectionnés (type d’étude et d’imagerie, date, population, taille de l’échantillon…) ; un second les a validés et 2 autres, indépendants, en ont précisé la qualité et le niveau de preuves. N’ont été inclus que les articles publiés en langue anglaise et après 1998. La revue systématique a porté sur les HCC mais aussi sur les cholangiocarcinomes ( qui représentent moins de 10 % des tumeurs hépatiques primitives), à l’exclusion des autres tumeurs malignes du foie, métastases notamment.
Sur un total de 890 articles, 241 publications ont été retenues,
dont 68 concernant l’US, 131 le CT et 125 l'IRM. La plupart d’entre
elles précisaient bien la sensibilité de la technique mais seules
139 en rapportaient la spécificité. Soixante-quinze étaient
prospectives, 6 seulement portaient sur le diagnostic de l’HCC lors
d’un programme de surveillance systématique. Soixante-treize ont
évalué l’intérêt de l’utilisation d’un produit de contraste
hépatique spécifique (acide gadoxétique ou gadobenate) en
IRM, et 47 celui de l’injection de microbulles en
échographie.
Peu de travaux ont évalué l’apport des diverses techniques
d’imagerie dans le cadre de programmes de surveillance pour la
survenue d’un HCC. La sensibilité de l’US simple y était de 0,78
(intervalle de confiance à 95 % [IC] : 0,6- 0,99) et la spécificité
de 0,89 (IC : 0,80- 0,94) ; celle du CT de 0,84 (IC 0,59- 0,95)
pour une spécificité de 0,99 (IC 0,86- 0,999). Aucun n’a examiné,
dans cette situation le bénéfice potentiel de l’US avec contraste
ou de l’IRM.
Des performances similaires pour les trois types d’imagerie sauf pour les petites lésions
Dans les autres situations diagnostiques, la sensibilité de l’US sans micro bulles était de 0,73 (IC 0,46-0,90) pour une spécificité de 0,93 (IC 0,85-0,97). Concernant le CT, elles étaient respectivement de 0,83 (IC 0,75- 0,89) et de 0,91 (IC 0,86- 0,96). Enfin, pour l’IRM, les valeurs étaient de 0,80 (IC 0,79- 0,93) et de 0,89 (IC 0,83- 0,93).Globalement, la sensibilité de l’US sans injection de micro bulles s’est montrée moindre que celle du CT ou de l'IRM, la différence combinée, à partir de comparaisons directes se situant entre 0,11 et 0,22. L’IRM apparaît plus sensible que le scanner (différence combinée : 0,09). L’écart entre US et CT est de moins 0,10. Les différences de sensibilité sont apparues plus marquées quand il s’agissait de petites lésions, inférieures à 2 ou 3 cm et quand étaient utilisés en IRM des agents de contraste spécifiques hépatiques, acide gadoxétique ou gadobenate plutôt que des agents non spécifiques tels que gadopentétate ou gadodiamide.
Lors de l’évaluation de lésions focales hépatiques, la sensibilité de l'US avec contraste est de 0,87 (IC : 0,79- 0,92) pour une spécificité de 0,92 (IC : 0,83- 0,95). Elle est de 0,86 (IC : 0,75- 0,92) pour le CT avec une spécificité de 0,88 (IC : 0,76- 0,98) et enfin de 0,75 (IC 0,65- 0,89) pour l’IRM, la spécificité se situant alors à 0,83 (IC 0,61- 0,93). Deux études confirment que la sensibilité de l’US avec contraste est supérieure à celle de l’US simple (différence 0,50, IC : 0,41- 0,58). La sensibilité de l’US avec contraste est plus faible que celle de l’IRM en cas de lésions de petite taille. Dans l’ensemble des travaux, la sensibilité est d’autant plus faible que les données de la biopsie hépatique sont prises pour référence, que les lésions sont de petite taille et qu’elles sont bien différenciées. Pour l’IRM, la sensibilité s’est aussi avérée inversement proportionnelle à la classe Child-Plug de l’hépatopathie. Pour l’US, l’influence de paramètres tels que la profondeur de ou des lésions ou l’indice de masse corporelle n’ont pas été évalués.
Ainsi ressort-il de cette revue systématique que l’US sans produit de contraste a, dans le cadre d’un programme de surveillance des HCC, une moindre sensibilité que le CT ou l’IRM, la différence se situant entre 0,11 et 0,22. Aucune disparité n’est constatée entre les 3 techniques dans l’évaluation des lésions focales hépatiques, l’IRM paraissant toutefois plus sensible dans la détection des lésions de petite taille. Le recours à des produits de contraste, tant pour le CT que l’IRM améliore la sensibilité. Les conclusions de cette revue diffèrent quelque peu de celles des publications antérieures qui, globalement, n’avaient pas montré de différence patente en ce qui concerne les sensibilités des 3 techniques d’imagerie. Cependant, plus de la moitié des publications sélectionnées étaient d’origine asiatique, et beaucoup excluaient les lésions hépatiques non hyper vasculaires. De plus, depuis 1988, date du début de la recherche bibliographique, les techniques ont continué à s’améliorer. enfin, un haut degré d’hétérogénéité statistique était présent entre les diverses études; seules celles de langue anglaise ont été retenues; des biais de publication restent toujours possibles; la disponibilité et les coûts financiers n’ont pas été appréhendés, ni enfin les possibles effets secondaires de chacune des méthodes d’imagerie.
En conclusion, dans le diagnostic des HCC, tant le CT que l’IRM sont associés à une plus grande sensibilité que l’US sans produit de contraste, l’IRM paraissant la plus performante. Dans l’évaluation des lésions focales hépatiques, les 3 techniques sont sensiblement équivalentes, avec une sensibilité moindre en cas le lésions de petite taille ou bien différenciées.
Dr Pierre Margent




