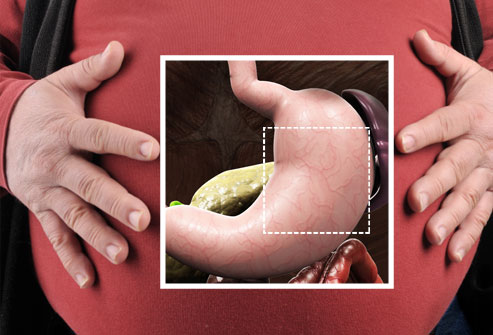
Une forte obésité est associée, de façon significative, à des douleurs articulaires et à une perturbation du fonctionnement physique (difficultés pour se pencher, se laver, se mouvoir…). Elle est, en soi, cause de lésions articulaires, source complémentaire de restriction d’activité et de limitation à la marche. D’autres facteurs peuvent intervenir, tels une dysfonction cardio-circulatoire, une inflammation systémique, une perte de souplesse et de force musculaire, une composante dépressive.
La chirurgie bariatrique a démontré son efficacité dans la réduction pondérale et son maintien ainsi que dans l’amélioration ou la rémission de nombre de comorbidités comme, par exemple, un diabète de type 2. Elle serait aussi associée à une diminution des douleurs corporelles et à un gain en termes d’activité physique ; ces notions sont fondées sur des travaux de petite taille et de brève durée, avec un suivi ne dépassant pas un an.
Plus de deux mille opérés
L’étude Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery 2 (LABS-2) est une vaste enquête observationnelle, multicentrique (10 hôpitaux US) sur une cohorte de patients obèses ayant eu un acte de chirurgie bariatrique entre le 14 Mars 2006 et le 24 Avril 2009. L’ évaluation initiale, puis le recueil annuel des données pendant 3 ans, a été effectué par un personnel spécialisé. Il a porté sur la douleur et la fonction physique, tant dans le ressenti des patients qu’à l’aide de mesures objectives. Les auteurs du travail se sont également efforcés d’identifier les facteurs associés à un meilleur résultat. L’état de santé et le bien être global ont été mesurés par le 36-Item Short Form Health (SF-36), essentiellement dans ses 2 items douleur corporelle et ses 10 items concernant l’activité physique. Son score varie de 1 à 50, témoignant alors d’une condition parfaite, toute variation de plus de 5 points étant significative. L’index Western Ontario and Mc Master Universities Osteoarthritis (WOMAC) a plus spécifiquement porté sur l’arthrose de hanche et de genou. Son score peut aller de 0 à 100, la douleur et la fonction étant d’autant améliorées qu’il est plus bas ; une baisse de 9,3 et 9,7 points témoignant d’un gain significatif. Le test de marche sur 400 mètres (Long Distance Corridor Walk ou LDCW) a fourni une appréciation objective, quand il a été possible, de la capacité à la marche. Son seuil a été fixé à 7 minutes pour parcourir cette distance, toute diminution du temps de marche de 24 secondes traduisant, déjà, une amélioration significative.
Les critères primaires d’évaluation ont été les modifications pré vs post chirurgie de l’index SF-36 et du LDCW. L’amélioration du WOMAC a fait partie des critères secondaires. Le recueil des données comportait également les mesures anthropologiques habituelles, des éléments socio démographiques, la consommation tabagique, l’ethnie, la prise éventuelle de béta bloquants, les principales co morbidités, les chiffres de pression artérielle et l’appréciation d’une possible composante dépressive grâce au Beck Depressif Inventory (BDI), version 1.
La cohorte de départ inclut 2 221 participants ; 2 042 (84 %) ont pu être suivis à un an, 1 794 (74 %) à 2 ans et 1 724 (72 %) à 3 ans ; 1 743 (78,5 %) étaient des femmes. L’âge moyen se situe à 47 ans et l’indice de masse corporelle pré chirurgical (IMC) atteignait 45,9 kg/m2. Le by pass gastrique Roux en Y (RYGB) a été la technique chirurgicale la plus utilisée (70,4 %). En second lieu vient la pose sous laparoscopie d’un anneau gastrique ajustable, LAGR (20,5 %). La perte moyenne pondérale, en pourcentage (IQR) a été de 30,5 % (21,3- 37,5 %) à un an, 30,5 % (21,3- 38,3 %) à 2 ans et de 28,2 % (19,8- 36,4 %) à 3 ans. Elle était nettement plus marquée en cas de RYGB.
Amélioration du fonctionnement physique, du temps de marche, et régression des douleurs
A un an, une amélioration clinique manifeste était constatée chez 57,6 % (intervalle de confiance à 95 % [IC] : 55,3- 59,9%) des participants pour la composante douloureuse corporelle, chez 76,5 % (IC : 74,6- 78,5%) pour la partie fonctionnement et chez 59,5 % (IC : 56,4-62,7 %) pour le temps de marche sur 400 mètres. De plus, parmi les patients souffrant, à l’entrée dans l’étude, de lésions arthrosiques sévères du genou (n = 633) ou de la hanche (n = 500), approximativement les trois quarts ont témoigné d’une amélioration nette de leur douleur du genou (77,1 %, IC : 73,5- 80,7 %) et de leur fonctionnalité au niveau de la hanche (79,2 %, IC : 75,3- 83,1 %). Entre la 1ère et la 3e année, les taux d’amélioration ont diminué significativement, à 48,6 % (IC :46,0- 51,1%) pour la douleur et à 70,2 % (IC : 67,8- 72,5 %) pour la fonction physique, sans dégradation du temps de marche, des douleurs ou de la fonction des genoux ou des hanches. Parallèlement, en post chirurgical, était noté par les patients une moindre gêne dans leurs activités, un moindre degré d’insatisfaction. Leur consommation médicamenteuse a baissé tout comme la fréquence cardiaque.
Plusieurs facteurs ont pu intervenir. Un jeune âge, un niveau de ressources élevé, un IMC de départ plus bas, une amélioration ou une disparition de la symptomatologie dépressive ou du diabète étaient associés à un bénéfice plus marqué. Le gain a été aussi plus net chez les hommes que chez les femmes. A l’inverse, la technique chirurgicale retenue (RYGB, LAGB ou autre) n’a pas semblé, en soi, influer. A un an, l’incidence d’un acte opératoire sur le genou ou la hanche s’élève à 3,7 % pour passer à 4,6 % à 3 ans. Celle d’une intervention sur le rachis est de 1,5 %, puis de 2,3 %.
Cette étude, avec un suivi de 36 mois, révèle qu’approximativement 50 à 70 % des adultes avec obésité sévère améliorent, après chirurgie bariatrique, significativement leurs douleurs corporelles et leur limitation fonctionnelle. Il en va de même pour trois quarts des patients souffrant d’arthrose du genou ou de hanche. Ce bénéfice va de pair avec une diminution de la fréquence cardiaque et une meilleure capacité à la marche, qui est un des éléments prédictifs de la mortalité globale. Elle a, également, permis d’individualiser des facteurs prédictifs de bon pronostic. Ces résultats rejoignent ceux d’études antérieures, notamment le travail de Sanchez Santos qui a suivi pendant 5 ans des obèses après RYGB mais différent de ceux de la Swedish Obesity Study, qui rapportent une moindre amélioration à 6 ans. Les réserves possibles concernant cette étude tiennent à l’absence de groupe témoin, non opéré, à l’absence de prise en compte de la durée et de l’importance de l’obésité et à l’ignorance sur la nature exacte des douleurs chroniques alléguées par les patients. A l’inverse, on se doit de souligner la diversité géographique de la cohorte, un recueil de données validé, standardisé et effectif sur 3 ans.
En conclusion, suivant un acte de chirurgie bariatrique, une large proportion de patients obèses notent une amélioration significative de leur symptomatologie douloureuse, de leur restriction physique et de leur périmètre de marche, avec, cependant, une légère baisse entre la 1ère et la 3e année de suivi.
Dr Pierre Margent




