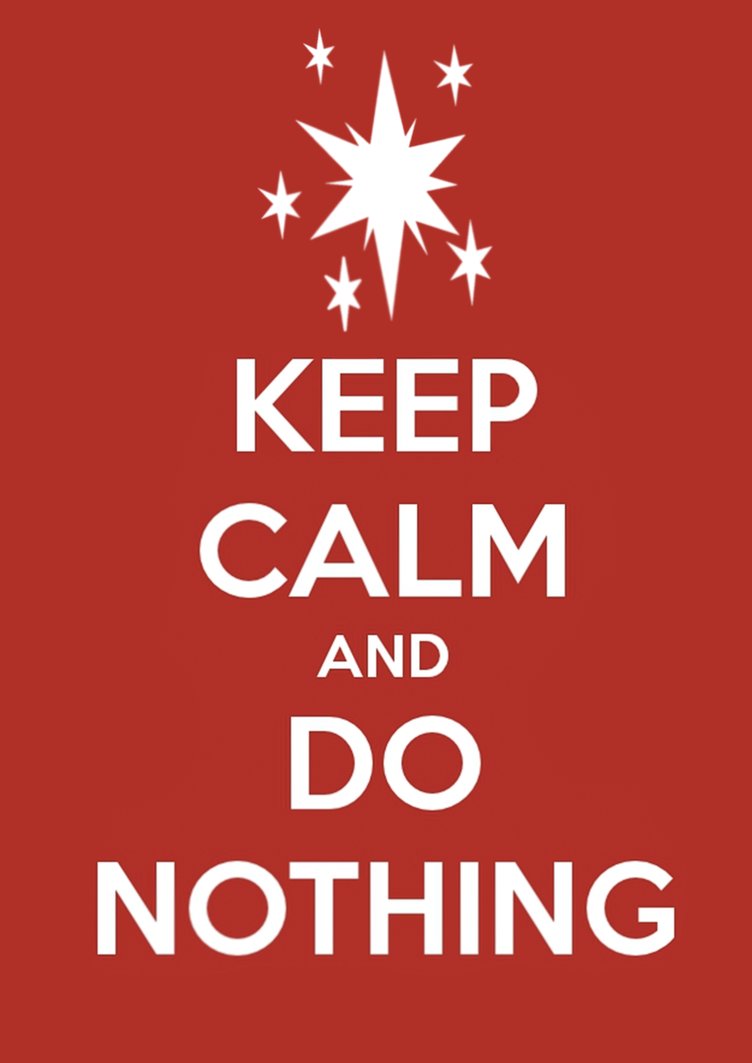
Paris, le samedi 23 juillet 2016 – Tous les médecins vivent quotidiennement cette situation : le patient qui attend fébrilement que la consultation s’achève par une prescription, alors que rien dans son état de santé ne le justifie. Fréquemment, le praticien répond à cette injonction tacite, poussé tout à la fois par le refus de décevoir, l’impossibilité de se résoudre à ne rien faire, l’envie d’agir, le sentiment que la prescription faite ne peut pas être préjudiciable ou encore que cette volonté de suivre un traitement ne doit pas être contrariée en prévision des jours où elle sera indispensable. Expliquer l’absence d’intervention, les enjeux de ce qui peut passer pour une surprenante passivité, est complexe et nécessite non seulement de dépasser ses propres préjugés mais aussi de lutter contre l’ensemble des informations distillées quotidiennement et qui invitent encore et toujours à agir.
Hélas
Certains praticiens cependant ne renoncent pas. Plutôt que de souscrire à la longue liste des actes dont l’utilité et l’efficacité sont plus que remises en question, ils ont choisi de relever le défi de ne rien faire et de faire comprendre aux patients qu’une telle attitude est préférable. Ils ont choisi d’entrer dans ce discours dont le paradoxe apparaît parfois comme une menace : traiter n’est pas toujours nécessaire, intervenir peut-être plus néfaste que bénéfique. Sans revenir sur le sempiternel exemple de la prescription d’antibiotiques, c’est sous l’angle du dépistage que l’auteur du blog Jaddo aborde cette problématique. Le dépistage des cancers est en effet un paradigme en la matière. « C’est très compliqué d’expliquer pourquoi dépister un cancer ne sauve pas forcément de vies et pourquoi ne pas dépister peut parfois le faire » explique en introduction Jaddo qui à son tour donne les raisons de cette complexité : « D’abord parce que c’est tout à fait contre intuitif (…). Ensuite parce que c’est la seule partie visible de l’iceberg (…). On ne peut pas voir ce qui ne se passe pas. Du coup, aucun patient ne viendra jamais me dire « Oh docteur merci de ne pas m’avoir dépisté quand j’avais 60 ans, je ne serais plus là pour vous remercier si vous l’aviez fait ». Pourtant, en dépit de la difficulté d’une telle entreprise, Jaddo a décidé de s’y atteler et revient sur les différentes failles des dépistages systématisés, en soulignant le caractère faillible de certains examens, les risques de complication de ces derniers, le fait que « les cancers peuvent guérir tout seul ou évoluer tellement lentement qu’on mourra d’autre chose avant qu’ils ne se manifestent » ou encore les complications parfois graves des traitements anti-cancer. Cet exposé lui permet de conclure que « Beaucoup de dépistages actuellement proposés n’ont pas fait leur preuve de leur efficacité, et les preuves de leur nocivité ou de leur inefficacité sont de plus en plus probantes, hélas. C’est très difficile à croire, à voir et à expliquer ».
Distinction
Cependant, Jaddo n’ignore pas qu’un tel message peut certes susciter l’incrédulité chez beaucoup mais également attiser un réflexe de défiance totale chez d’autres. Aussi, patiemment, elle rappelle que la remise en cause des examens de dépistage qu’elle cite ne les concerne pas en tant que tel mais vise « leur utilisation dans un contexte de dépistage de masse, appliqué à toute la population sans distinction ». Enfin, elle invite à faire la différence en fonction des différents types de cancer. Si elle rappelle les doutes importants qui concernent les dépistages du cancer du sein, de la prostate et même du côlon, elle note concernant le cancer du col de l’utérus : « on est à peu près sûr que le dépistage systématique par frottis sauve des vies ».
Culture de l’action
Pour tenter de faire comprendre qu’intervenir n’est pas toujours la panacée, contrairement à ce que semble enseigner la logique et mille recommandations officielles et moins officielles, il y a la méthode pédagogique de Jaddo, schéma et références à l’appui. Il y a aussi l’énumération à la Prévert pratiquée par l’anesthésiste réanimateur auteur du blog Hic et nunc. « Il y a un sacré paquet de trucs en médecine qui sont réalisés dont on pourrait se passer. Le dépistage est un exemple connexe complexe mais très pertinent » observe-t-il avant de se concentrer sur sa spécialité. Il remarque : « Je m’interroge quant à notre tendance à intervenir en excès. Nous avons un métier où la physiologie se vit "en live" avec des médicaments puissants aux effets immédiats, nous sommes donc imprégnés d’une culture de l’action. De plus, y’a quand même un paquet de littérature qui nous enjoint à agir vite dans bon nombre de situations médicales ». Ce contexte favorise des décisions parfois trop précipitées et automatisées qui mériteraient pour le praticien d’être remises en question. Il en propose une liste non exhaustive qui passe des morphiniques en per-opératoire à la prescription d’atenolol en passant par l’insuline trop « agressive » ou encore « l’IPP prescrit comme un réflexe dans 1 000 situations où les patients n’en ont pas besoin ». Cette liste est destinée à rappeler qu’il « y a plein de situations où ne rien faire, c’est bien faire (…). Il y a plein de fois où juste attendre à côté du patient est suffisant. Et il y a plein de fois où nous faisons peut-être pire que mieux en prescrivant. Ainsi, il me paraît vraiment important de vous arrêter 30 secondes lorsque vous êtes devant un dilemme de prescription. Interrogez-vous sur votre "impulsion": habitude ou besoin de donner une réponse (facile) à une question difficile ».
Lassitude
Les auteurs de Jaddo et de Hic et nunc paraissent relativement jeunes, plus certainement au début de leur carrière qu’à la fin. Cependant, chez le praticien plus âgé, ayant fait lui aussi vœu de limiter l’interventionnisme, de restreindre la systématisation, pourtant fortement encouragée à l’ère des "recommandations de bonne pratique", une lassitude peut s’installer. C’est ce qui apparaît dans le témoignage de Jean-Claude Grange sur son blog Docteur du 16. Il révèle ainsi que bien qu’il songeât poursuivre à temps partiel son activité au moment de prendre sa retraite (en juin 2018) il pourrait y renoncer pour des raisons « non administratives ». Il s’agit notamment de tout ce temps perdu à devoir réexpliquer le « rapport bénéfices/risque » des dépistages du cancer du sein, de la prostate ou encore du cancer colorectal. Il s’agit des longues batailles à propos de la prescription de traitements considérés comme inutiles ou non toujours appropriés (médicaments contre l’Alzheimer, traitements anti douleur, statines…). Bref, ce temps à défaire ce qui aurait pu ne pas être fait ou imposé avec autant d’autorité.
Pour refaire le débat, vous pouvez vous rendre sur les blogs de
Jaddo
http://www.jaddo.fr/2016/06/19/et-mes-fesses-elles-sont-roses-mes-fesses/
Hic et nunc
http://www.nfkb0.com/2016/06/21/ne-rien-faire-cest-bien-faire/
et Docteur du 16
http://docteurdu16.blogspot.fr/2016/06/ce-sont-des-raisons-non-administratives.html
Aurélie Haroche




