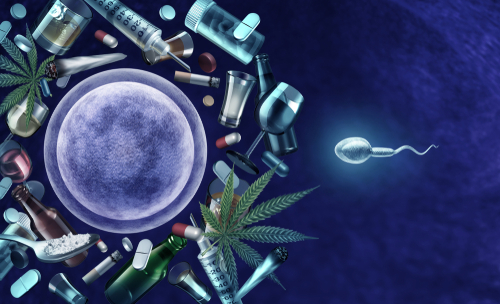
On estime que 15 % des couples sont confrontés à des problèmes
d’infertilité et que la responsabilité en est masculine une fois
sur deux. Pour la moitié encore de ces hommes la cause en est
inconnue (« stérilité » idiopathique). Divers traitements
empiriques sont proposés pour améliorer cette situation.
Pour se faire une idée rationnelle de ces options thérapeutiques,
il a été procédé à une revue systématique de la littérature (à
partir de MEDLINE, Embase, LILACS, Cochrane library) qui a retenu
61 articles publiés entre 1990 et 2017, dont 59 concernaient des
essais randomisés contrôlés et deux des études comparatives non
randomisées. Les résultats poolés suggèrent que la pentoxyfilline,
le coenzyme Q10, la L-carnitine, la FSH (follicle-stimulating
hormone), le tamoxifène et la kallicréine sont capables de modifier
favorablement les paramètres du spermogramme. D’autres
approches médicales ou nutritionnelles ont été identifiées comme
pouvant elles aussi améliorer la qualité du sperme mais il
s’agissait d’études individuelles limitées avec des biais
méthodologiques.
Par ailleurs, le critère principal de jugement dans ces différents essais était le plus souvent les améliorations du spermogramme et non l’accouchement d’enfants vivants. Or, les premières n’entraînent pas forcément les secondes, loin s’en faut.
Amélioration du spermogramme ne signifie pas grossesse…
Si l’on ajoute que les auteurs ont eu plus tendance à publier des résultats positifs que négatifs et que la fréquente hétérogénéité des résultats se traduit par un léger chevauchement des intervalles de confiance, il convient d’interpréter les dits résultats avec une extrême prudence car la certitude de la preuve est jugée comme « très faible », notamment en ce qui concerne la survenue de grossesses et de naissances vivantes.
C’est souligner la nécessité d’études bien conçues, puissantes, prospectives, randomisées, avec comparaison à un placebo, où l’évaluation de l’efficacité du traitement médical ou des suppléments alimentaires doit se faire non seulement sur l’évolution de l’oligoasthénospermie, mais aussi sur les grossesses et les naissances. Dans ces essais, doivent être pris en compte le mode de vie, les contraintes, l’activité physique, la qualité du sommeil, le régime alimentaire, les mesures hygiéno-diététiques (alcool, tabac). C’est une tâche monumentale pour un résultat qui risque d’être peu évident ; il faut néanmoins continuer à stimuler les chercheurs pour qu’ils multiplient les essais cliniques, avec l’espoir d’identifier un sous-groupe d’hommes infertiles qui pourraient bénéficier de tel ou tel traitement médical et nutritionnel tout en permettant un ciblage plus précis de ce qu’est vraiment la stérilité masculine idiopathique.
Dr Jean-Fred Warlin




