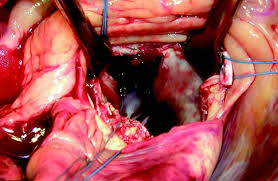
L’obstruction de la chambre de chasse du ventricule gauche est
fréquente dans la cardiomyopathie hypertrophique (CMH). Les
procédures de réduction septale (alcoolisation ou myectomie) qui
lèvent l’obstruction et améliorent les symptômes des patients
réfractaires au traitement médical optimal, peuvent être à
l’origine de troubles de la conduction en raison de la localisation
anatomique des branches du faisceau de His. Ainsi, un bloc
auriculo-ventriculaire (BAV) complet survient chez 10 % à 15
% des patients. Le bloc de la branche droite (BBD) est plus
fréquent après alcoolisation septale tandis que le bloc de la
branche gauche se voit plus souvent après myectomie septale.
Cui et coll. ont tenté de déterminer l’impact des anomalies de
la conduction sur la mortalité de 2 482 patients (hommes : 55,2 %)
porteurs d’une CMH obstructive (CMHO) traitée par myectomie septale
entre 1961 et 2016. Pour ce faire, ils ont notamment soigneusement
analysés les ECGs pré- et postopératoires de ces patients.
Globalement, seuls 2,3 % des malades ont développé un BAV
complet. Après la myectomie, sur les 2 159 patients (87,0 %) qui
avaient une conduction normale en pré-opératoire, 38,8 % ont
présenté un BBG, 1,1 % un BBD et 0,6 % un BAV complet. Parmi
les 112 patients qui avaient un BBD à l’état basal, 34,8 % ont
développé un BAV complet en postopératoire.
La nécessité d’une stimulation cardiaque postopératoire est prédictive de la mortalité
Lors d’un suivi moyen de 8,6 ans, après ajustement pour l’âge,
le genre et les procédures concomitantes, la mortalité globale
différait significativement (p = 0,015) selon les différents
troubles de la conduction présents en postopératoire.
C’est ainsi, en particulier, qu’après la myectomie, les
patients dont le rythme cardiaque était entrainé électriquement
avaient une mortalité plus élevée (hazard ratio 1,57; intervalle de
confiance 95 % : 1,15 à 2,14; p = 0,005), que celle des patients
dont la conduction était normale, sans différence toutefois entre
les groupes BBD et BBG (comparés à la normale).
Dr Robert Haïat




