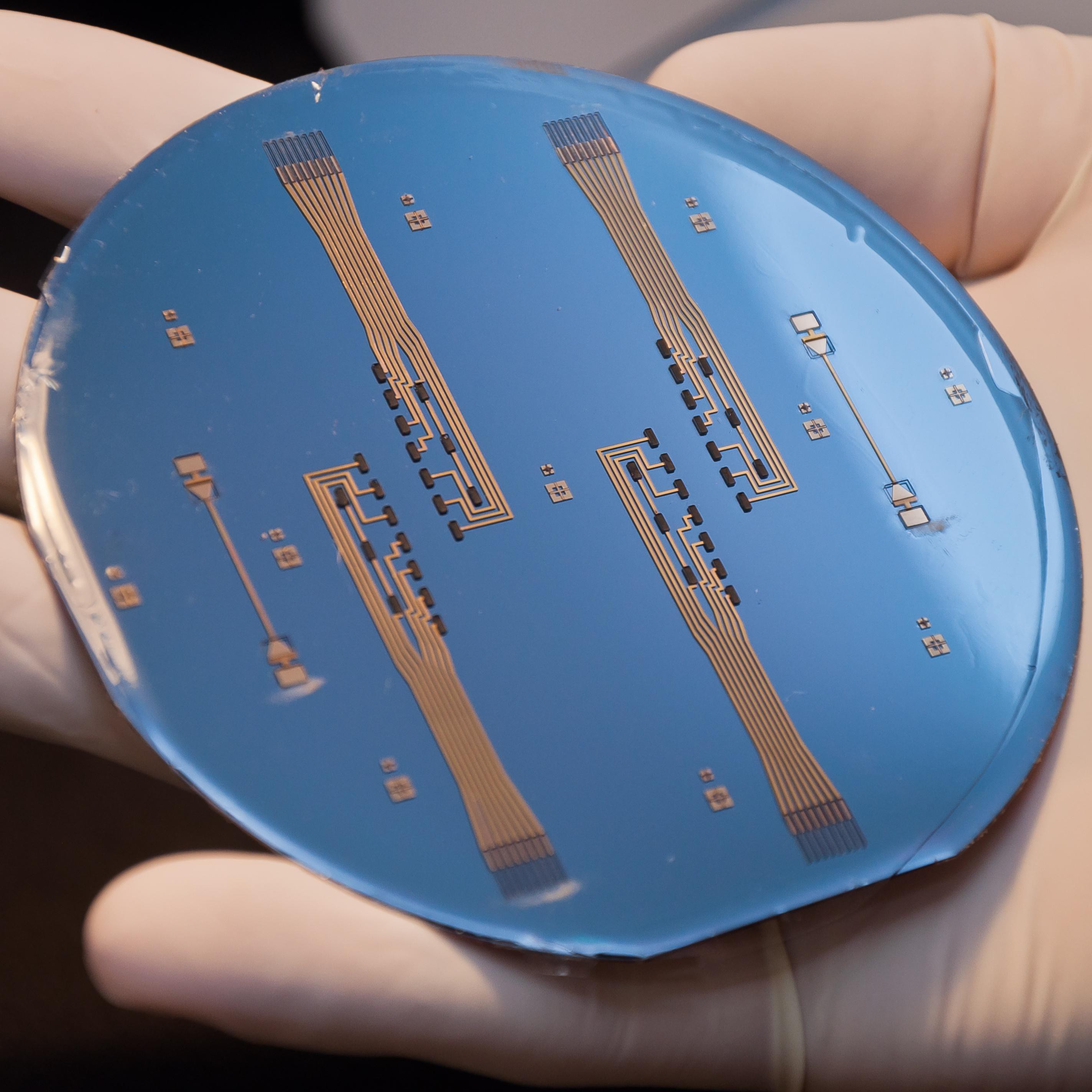
Protocole expérimental
Parmi ces freins, les méthodes et critères d’évaluation
classiques des dispositifs médicaux peuvent être mal adaptées à ces
innovations, qui ont fréquemment pour spécificité d’être
personnalisées. Pour répondre à cette limite, le Laboratoire des
Interfaces Bioélectroniques (LSBI) de l’EPFL a développé un «
protocole expérimental multimodal pour tester, optimiser et
valider des dispositifs implantables, souples et personnalisés
», détaille un communiqué de l’EPFL. Les chercheurs ont présenté
leur méthode dans la revue Advanced Materials.
IRL
La première étape de ces travaux a consisté à concevoir un
modèle reproduisant le « tissu dans lequel sera implanté le
dispositif in vivo avec ses propriétés anatomiques et
biophysiques ». Il s’agit d’une « reproduction
personnalisée » reposant sur des données d’imagerie médicale et
le recours à l’impression en trois dimensions. « Cela signifie
que pour chaque individu, nous reproduisons la structure anatomique
exacte du tissu qui hébergera l’implant », précise Giuseppe
Schiavone. Outre l’insertion dans ce tissu et l’observation de
l’adaptation de la neuroprothèse, cette dernière peut être soumise
à différents stimuli mimant les conditions d’utilisation normales
de la vie quotidienne, générés par une « plateforme »
spécifique également développée par le laboratoire. Ainsi
l’évaluation repose sur des critères plus proches d’une utilisation
dans la vie réelle, tandis que cette méthode, plus facilement
reproductible, permet en outre d’éviter des interventions
chirurgicales. Plus éthique, elle est également plus rapide et
moins coûteuse. « Cela permet aussi de tester le dispositif à
chaque étape, et de faire des modifications ou des améliorations,
sans que cela soit lourd de conséquence » remarque Guiseppe
Schiavone.
Encourager l’approche translationnelle pour apporter un bénéfice rapide aux malades
Aurélie Haroche




