
Durant ce confinement « long comme un jour sans pain », songeons aux malades du Moyen Âge frappés par la terrible « peste de feu », due à l’ingestion de pain empoisonné : confinés dans une cathédrale, ils prient avec ferveur pour leur salut. Écartons le brouillard tourmenté de l’Histoire, pour évoquer l’une des épidémies les plus effroyables de tous les temps : ignis sacer, le feu pestilentiel...
Le dragon de Satan
En 945, Flodoart de Reims donne le premier tableau de cette «
étrange et redoutable maladie » d’apparence épidémique.
Fléau essentiellement médiéval inspirant une abondante
iconographie, le mal des ardents sévit depuis l’Antiquité (où
plusieurs textes latins semblent l’avoir décrit) jusqu’au XVIIIème
siècle, avec une ultime flambée épidémique en 1951 à Pont-Saint
Esprit[1] (Gard). Il frappe des pays consommateurs de pain, comme
le monde gréco-romain antique (avec la « peste » d’Athènes
de 430 avant J.C) et la France médiévale où une trentaine de foyers
épidémiques sont recensés du Xème au XIVème siècle. Mais
contrairement à d’autres maladies épidémiques réellement
contagieuses comme la variole, l’Extrême-Orient (où le riz occupe
la place du blé dans l’alimentation) semble épargné. Rares sont les
affections avec autant de dénominations : mal des ardents, feu
sacré (ignis sacer), feu de saint-Antoine, raphanie, peste de feu
(ignis plaga), feu invisible, ardeur pestilentielle, arsura (du
latin ardere, à l’origine des mots français ardeur, ardent et arsin
: bois endommagé par le feu), feu caché, feu perse, mal injuste
(comme s’il existait une maladie justifiée !), feu divin, feu
sous-cutané, feu infernal, feu de Géhenne (du nom d’un ravin proche
de Jérusalem, lieu de sacrifices d’enfants, puis décharge publique
pour l’incinération d’immondices : Géhenne finit par désigner une
situation intenable, infernale), mal sylvestre (se propageant tel
un incendie de forêt, avec les membres nécrosés du patient se
détachant de son corps, comme le bois mort d’un arbre : voir arsura
et arsin). Problème de société au Moyen Âge, le mal des ardents
interpelle médecins, prêtres, dirigeants, chroniqueurs,
alchimistes. Il reçoit son nom explicite au XIXème siècle :
ergotisme gangréneux, ou empoisonnement par le seigle atteint d’une
affection cryptogamique, l’ergot. L’ergotisme est donc une maladie
au second degré, une pathologie (humaine) consécutive à une autre
pathologie (végétale). Mais les praticiens médiévaux ignorent
l’existence des alcaloïdes de l’ergot, même s’ils soupçonnent le
rôle du « pain de disette », fait d’une farine avariée ou
d’un méteil (mélange de seigle et de blé) de mauvaise qualité.
Relatant l’épidémie frappant Blois en l’an de disgrâce 1039, le
chroniqueur Raoul Glaber écrit : « Cette ardeur mortifère touche
les grands comme les médiocres : Dieu les laisse amputés pour
servir d’exemples à l’avenir, tandis que presque toute la terre
souffre d’une disette due à la rareté du pain. » Les tableaux
cliniques de l’ergotisme ont le feu pour dénominateur commun :
comme sur des charbons ardents, le patient est en proie à des
douleurs et brûlures intolérables (qualifiées aujourd’hui de
causalgies) prédominant aux extrémités des membres. Malgré cette
chaleur étrange justifiant le terme « ardent », car le
malade semble « s’embraser sous les flammes du Malin », ses
extrémités sont « froides comme glace » et une nécrose du
membre atteint succède souvent à cette acrocyanose. Moine de Cluny,
Raoul Glaber écrit en l’année de Dieu 994 : « Un feu occulte
consume et détache le membre du corps ; en une nuit, les malades
sont dévorés par cette affreuse combustion. Dans le souvenir de nos
saints, on trouve l’apaisement du mal. » Quel rapport entre
l’ergotisme et la vie de saint-Antoine ? Car il devient éponyme de
cette maladie. Ce rapprochement semble opéré à la fin du XIème
siècle par Gaston, Seigneur de la Valloire, dont le fils survit
miraculeusement aux atteintes du redoutable fléau. Guérison
attribuée à l’effet thaumaturgique des reliques du saint qu’on
vient de déposer dans l’église de la Motte-sous-Bois, rebaptisée
plus tard Saint-Antoine-en-Dauphiné. Pour remercier le saint,
Gaston de la Valloire s’adonne à l’assistance des déshérités, à une
époque où la médecine se résume presque à la charité. Il fonde
l’ordre des Antonins dont PF Girard[2] rappelle qu’il comptera au
XVème siècle près de 400 hôpitaux répartis dans l’Ancien Monde, et
jusqu’à dix mille religieux. Les Antonins adoptent la croix en Tau,
évoquant « la béquille des malades estropiés par le feu de
saint-Antoine. » Parmi les souvenirs toponymiques de cet ordre
médico-caritatif, il reste l’Hôpital et le Faubourg Saint-Antoine à
Paris, la Commanderie des Antonins et le Quai Saint-Antoine à Lyon,
la Préceptorerie des Antonins à Issenheim (la ville du célèbre
retable de Grünewald dont un tableau évoque le « miracle du
pain » partagé entre les deux ermites Antoine et Paul). Pour
les historiens de la médecine, la relation entre l’ergotisme et la
vie d’Antoine n’est pas fortuite : il existe un parallèle entre la
symptomatologie de l’ergotisme et des caractéristiques de la vie
d’Antoine, l’anachorète. Retiré du monde, Antoine ne connut
sûrement ni l’infarctus du myocarde ni l’ulcère gastro-duodénal.
Mais de quels maux souffrit-il ? Mort à l’âge (fort canonique pour
le IVème siècle) de 104 ans, saint-Antoine fit beaucoup d’envieux,
on l’invoquait pour devenir centenaire. Sauf à tout expliquer par
des interventions divines ou diaboliques, il faut subodorer quelque
pathologie dans la vie d’Antoine, narrée par son biographe
Athanase, sous le titre Vie et conduite de notre père Antoine,
écrites et envoyées à des moines étrangers. Saint-Antoine est
célèbre pour résister aux tentations du Malin. Cité par Girard[2],
ce texte d’Athanase évoque des hallucinations auditives et
visuelles (notamment des zoopsies), avec ces velléités d’intrusion
du démon : « Antoine vit les murs s’entrouvrir, et une foule de
démons firent irruption, ayant revêtu l’apparence de bêtes sauvages
et de reptiles. Le lieu fut rempli de spectres de lions, ours,
léopards, taureaux, serpents, scorpions, loups... Ces apparitions
farouches faisaient un bruit affreux et montraient leur
férocité. » Or, fait capital, les hallucinations font aussi
partie de la sémiologie de l’intoxication ergotée, comme du tableau
psychiatrique lié au « voyage » suscité par la mouture
moderne de l’ergotisme : son dérivé de synthèse tristement célèbre,
« l’acide » ou LSD. Dans l’épidémie de feu sacré frappant
les Flandres en 1088, la chronique décrit l’apparition d’un «
dragon satanique, dragon de feu vomissant des flammes par la
bouche, envoyé par le Malin pour tenter les bons Chrétiens ».
Durant la dernière épidémie d’ergotisme, à Pont-Saint-Esprit en
1951 (nom prédestiné pour un mal rattaché à la religion !), ces
thèmes démoniaques n’ont plus cours : les patients voient une «
boule de feu » attribuée parfois à un OVNI, et les médecins
diagnostiquent causalgies et troubles ischémiques des extrémités :
à chaque siècle sa vérité...Le coronavirus de l’an 1000
On sait que le changement de millénaire bouleverse les esprits
médiévaux. À l’approche du millésime fatidique, une Grande Peur
s’abat sur l’ensemble du monde chrétien, l’an 1000 sonnant le glas
de l’humanité pour les chantres de l’Apocalypse. Ce phénomène
sociologique du Moyen Âge rappelle nos actuelles angoisses
collapsologiques : pollution, conflit ou accident nucléaire,
réchauffement climatique, coronavirus... La Chronographia
(chronique) du moine Sigebert de Gembloux (ville de Belgique
abritant aujourd’hui un institut royal d’agriculture dans
l’ancienne abbaye bénédictine où vivait Sigebert), les Lettres de
Gerbert (un Auvergnat très érudit qui devient pape en 999 sous le
nom de Sylvestre II), et la chronique de Raoul Glaber évoquent
l’ambiance millénariste, en rejetant sur le passage de la comète
(de Halley) en l’an 989 et sur l’épidémie d’ardeur pestilentielle
les raisons de l’immense effroi populaire. Citons Sigebert
(décrivant les deux formes cliniques de l’ergotisme, gangréneuse et
contracturante) : « De nombreuses personnes se gangrénaient par
un feu intérieur qui les consumait, au point que leurs membres
devenaient aussi noirs que du charbon. Ils mouraient misérablement
ou bien, leurs mains et leurs pieds putréfiés se détachant du
corps, ils ne survivaient que dans une grande infirmité. De
nombreux malades se tordaient en contractions nerveuses et
souffraient de cruels tourments. » Les hallucinations des
ardents revêtent un aspect religieux, propre aux frayeurs
apocalyptiques de l’an 1000, ce qui fera dire plus tard qu’on ne
délire pas seulement avec sa maladie mais surtout avec sa culture.
Les apparitions des saints ou de la Vierge rivalisent avec celles
du Malin et ses sbires tentateurs gardant l’entrée des enfers,
dragons ou feux sataniques. Tel malade voit des flammes s’échapper
de ses mains, tel autre observe Belzébuth, ses cornes et sa queue
fourchue. Thérapeutiques infaillibles des visions infernales :
l’aspersion d’eau bénite (qui « rafraîchit les ardents »
mais n’empêche pas « une puanteur insupportable » de se
répandre, due aux chairs mortifiées) et le recours à la formule
consacrée Vade retro Satanas ! Tandis que des malades d’Arras sont
secourus par l’intervention salvatrice de la Madone[2] : « Dans
une traînée lumineuse apparaît la Vierge portant un cierge éclairé.
Avec la cire du cierge, on prépare un remède qui guérit 143
patients ; tel est le miracle de la Sainte Chandelle, illustré par
un triptyque de la cathédrale d’Arras. » À cette époque
remontent les expressions « en voir trente-six chandelles »
(être très éprouvé par une douleur physique ou morale) et «
devoir une fière chandelle à quelqu’un » (lui être très
obligé, comme les ardents redevables à la Madone et à son cierge
secourable)...Saint-Antoine et l’écuelle
L’humour constitue un excellent vecteur pédagogique. Notamment
l’humour paradoxal : étudié à Palo Alto par William Fry (un
collaborateur de Bateson), il offre une bonne approche didactique
du concept de paradoxe. Comme dans cette histoire de la feuille
blanche censée représenter un loup, des moutons et de l’herbe !
–Mais je ne vois pas d’herbe ! s’étonne l’enfant auquel on montre
cette toile blanche. –C’est parce que les moutons l’ont toute
mangée ! lui explique-t-on. –Mais je ne vois pas non plus les
moutons ? s’étonne-t-il encore. –C’est parce que le loup les a tous
mangés à son tour ! –Et le loup lui-même, on ne le voit pas ! Où
est-il donc ? –C’est normal : après avoir mangé les moutons qui
avaient mangé l’herbe, le loup n’avait plus rien à faire là, alors
il s’en est allé ailleurs !... (Figure 1)Un loup, des moutons et de l’herbe, ou la tentation de saint-Antoine
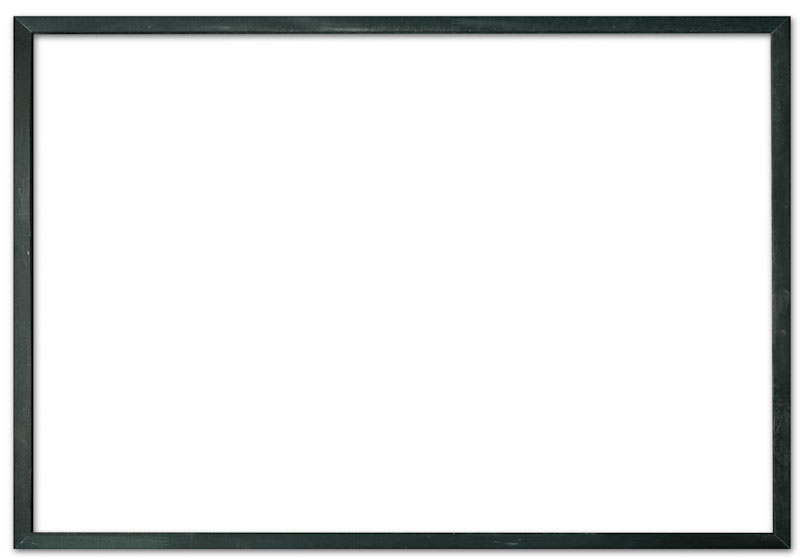
(1) Ce « tableau » (toile blanche) était déjà connu en 1901 sous le titre Portrait de l’Absolu, avec cette légende : « Fixez l’œil de la foi et regardez fixement jusqu’à ce que vous Le voyiez !»
Quel rapport entre ce tableau paradoxal(1) et le mal des ardents ? Cette même volonté de « représenter l’invisible», dans une œuvre du XVème siècle de la collection Robert Lehman (à New York), due au Maître de l’Osservanza : intitulée Saint-Antoine et l’écuelle[3], elle illustre (si l’on ose dire !) une tentation à laquelle résiste saint-Antoine.
Description faite par Girard[2] : « Satan place sur le chemin d’Antoine une écuelle remplie de lingots d’or, dans le but de le tenter. Le Maître de l’Osservanza représente la scène, mais ni l’écuelle ni les lingots d’or ne sont visibles ! C’est vraiment la perception sans objet qui définit l’hallucination.» Sur le même modèle, on connaît un tableau blanc intitulé Couteau sans manche dont on a perdu la lame. Ou un couteau sans lame dont on a perdu le manche ? Censé représenter saint-Antoine et l’écuelle, ce tableau du Maître de l’Osservanza, ne montre que saint-Antoine : peinture d’une écuelle la plus chère de tout le marché de l’art !...
Les ardents n’ont pas mal à la tête
La vie de saint-Antoine présente maintes analogies avec la
symptomatologie du feu sacré. Outre les hallucinations
(remarquables notamment par les zoopsies et l’ubiquité de l’image
du feu, tant visuelle que cénesthésique) et les douleurs atroces
tourmentant l’ermite d’Égypte comme les ardents, il faut signaler
un signe commun important, la privation de sommeil. Ni les ardents
ni saint-Antoine ne dorment normalement, en qualité comme en
quantité de sommeil. Comme ce sera ultérieurement le cas, aussi,
pour les victimes du LSD, l’insomnie ne pèse pas tant pour
elle-même à Antoine ou aux ardents que pour l’impossibilité à
trouver le moindre répit dans les hallucinations et les douleurs.
Notons paradoxalement l’importance capitale d’un signe négatif pour
l’avenir de la pharmacopée : s’ils se tordent de douleur, voient
leurs membres pourrir ou se détacher du corps, sont terrifiés par
mille hallucinations diaboliques, perdent le sommeil, les ardents
n’ont pourtant jamais mal à la tête. Bizarrement, les céphalées
épargnent les victimes du feu de saint-Antoine ! Cette tranquillité
ponctuelle semble incongrue dans un tableau de souffrances aussi
atroces les unes que les autres : elle nous vaudra au XXème siècle,
dans l’héritage des ardents, le tartrate d’ergotamine prescrit
contre des crises migraineuses ou des céphalées
vasomotrices...De même que des tablettes babyloniennes du Xème siècle avant J.C déplorent déjà « l’impiété de la jeunesse et la décadence des valeurs traditionnelles », un auteur anglais, Mc Cance-Widdowson, a vérifié, par la revue de la littérature sur la qualité du pain depuis vingt-cinq siècles, comment les quelques quatre-vingt générations qui traversent sa thèse ont tour à tour regretté que « la qualité du pain d’aujourd’hui ne valait pas la qualité du bon pain d’autrefois ! » La résistance au changement, l’immobilisme sont des phénomènes connus des sociologues et des hommes politiques, soucieux de ne pas mécontenter leur électorat. Mais cette glorification d’un passé révolu n’est qu’un mythe renforçant nos difficultés devant le vieillissement et le changement. Aux chantres d’un passé glorieux sur la qualité du pain quotidien, rappelons le sort tragique des centaines de milliers d’ardents durant le Moyen Âge. Citant un chroniqueur anonyme, Girard[2] évoque l’épidémie de feu sacré de l’an 996 survenant dans le sillage d’une « famine si grande que les gens se livraient, a-t-on dit, au cannibalisme.» L’ergotisme s’accompagne d’une famine, car il sévit surtout quand la récolte est mauvaise ou que les gerbes s’altèrent dans les meules, aggrave la famine en entravant la culture de la terre et compromet aussi la moisson suivante, car hommes et bêtes sont malades. L’affection frappe tous les « copains », toute la « compagnie » (termes désignant étymologiquement ceux qui partagent le pain de quelqu’un, la même lignée panifiée où le langage recèle aussi « compagnon » –dont on connaît toute l’importance symbolique et sociale dans l’ancienne France– et « accompagner », un verbe qui naît au XIIème siècle, alors que l’ergotisme fait rage).
Le socle du trône
Citons encore Girard[2] : « Le feu sévit surtout les années
où la qualité de la récolte de céréales est compromise par des
pluies torrentielles. » L’humidité favorise effectivement la
prolifération de l’ergot du seigle, le champignon Claviceps
purpurea. Nombre de guérisons miraculeuses observées quand les
malades se réfugient dans des églises ou des « maisons-Dieu
» (qui font fonction médiévale de nos actuels hôpitaux : voir «
l’Hôtel-Dieu ») s’expliquent certes en partie, peut-être,
par la faveur de thaumaturgie de la Madone ou de quelque saint,
d’autant que la composante psychiatrique du feu divin est sans
doute sensible à la psychothérapie des bons moines et à la
catharsis permise par la confession, ou à la présence du groupe
humain commentant les apparitions décrites par le patient. Cela
renforce la croyance dans l’efficacité apparente du confinement en
milieu ecclésiastique, mais il est probable que l’effet
thérapeutique revient simplement, bien qu’il reste alors méconnu,
au changement de nourriture : le pain consommé dans les abbayes est
d’une meilleure qualité que le pain de disette ingéré par les serfs
attachés à la glèbe. Il faut se remémorer certaines complaintes
médiévales pour réaliser quelles résonances lugubres ont la
pauvreté et la famine au Moyen Âge. « Elles arrivent de loin
», écrit Lucienne Desnoues[4] à propos de ces complaintes, « du
fond des blancs hivers approfondis par les modulations des grands
loups au cou levé. » Avec cette complainte millénaire évoquant
sans doute la chute des membres nécrosés de quelque ardent
famélique, voici un exemple terrible d’un hiver médiéval, sans rien
à se mettre sous la dent :
Des briques à la sauce cailloux !
Si tu as faim,
Mange ta main,
Et garde l’autre pour demain ! »
La toponymie conserve parfois le souvenir de cette
épouvantable faim médiévale, le vrai drame des années 1000. Par
exemple à Bramefan, un lieu-dit où, jadis, « bramèrent de faim
tous les pestiférés qu’on y reléguait lors des épidémies. » Ou
à Bramevaque (Hautes-Pyrénées), un endroit où beuglèrent autrefois
des vaches affamées. Et, parmi ces pestiférés de Bramefan, combien
d’ardents ! Terrible faim médiévale ! Plus près de nous, Arthur
Rimbaud écrit encore :
Les cailloux qu’un pauvre brise,
Les vieilles pierres d’église,
Les galets, fils des déluges,
Pains couchés aux vallées grises. »
L’héritage des ardents
Dans Booz endormi, Victor Hugo évoque la glaneuse biblique
Ruth épousant Booz l’octogénaire. Dans ce texte placé sous le signe
de la moisson, Hugo montre le grand étonnement de Booz devant la
révélation divine des destinées sublimes de sa descendance :
Qui, sorti de son ventre, allait jusqu’au ciel bleu :
Une race y montait comme une longue chaîne,
Un roi chantait en bas, en haut mourait un Dieu.
»
Le LSD
Obtenu par hasard (vers 1940 par Hofmann) à l’occasion d’un
«bricolage moléculaire » sur les alcaloïdes de l’ergot, il
s’appelle LSD, acide diéthylamide 2-5 de l’acide lysergique. C’est
le « ticket du voyage. » Comme l’ergotamine ou le
méthysergide (dérivé antimigraineux de l’ergot), c’est un
antagoniste des récepteurs sérotoninergiques, donc une substance
antisérotonine. Voici l’appréciation de Henri Ey à son sujet : «
Assez facile à fabriquer, il est devenu depuis la 2ème Guerre
Mondiale, surtout aux USA, l’objet d’un engouement quasi mystique
chez les adolescents. On peut comparer la propagande dont il fut
l’objet à celle de Baudelaire en faveur du haschich au XIXème.
» Si 12,5% des patients s’attendant à recevoir du LSD délirent déjà
même si du sérum physiologique leur est injecté (selon une étude
d’Olievenstein), « l’acide » a un effet hallucinogène très
marqué. Pris surtout per os, le LSD est une porte ouverte vers une
poly-toxicomanie, comme des injections d’héroïne. Avatar actuel de
l’ergotisme, le LSD minimise les effets vasomoteurs des alcaloïdes
de l’ergot mais renforce leurs effets de flash délirant, comme à
l’époque où des dragons sataniques ou la Madone apparaissaient
devant les ardents insomniaques. Triste phénomène de société
culminant dans les sixties sur fond de guerre du Vietnam, angoisse
du nucléaire, et rejet des valeurs traditionnelles (famille,
sédentarité...), le LSD délabre ses adeptes : bouffées délirantes,
psychoses, cachexies, septicémies, hépatites... S’ils parlaient,
des murs d’hôpitaux dénonceraient l’illusion « psychédélique
» ayant tenté, nouvelle version du Malin médiéval, tant de jeunes :
ils diraient que le flower power de San Francisco teinté d’acide,
ce n’est plus la Californie ! Selon le journaliste américain Hank
P. Albarelli Jr. (auteur du livre A terrible mistake, sur la mort
mystérieuse du biochimiste Frank Olson[5] qui travaillait pour la
CIA au temps de la Guerre Froide), l’épidémie de Pont-Saint-Esprit
en 1951 résulterait, non d’un empoisonnement accidentel par l’ergot
du seigle, mais d’une « dissémination de LSD sur des
populations-cobayes », dans le cadre d’opérations secrètes de
la CIA (projets MKULTRA et MKNAOMI)[6] envisageant la «
manipulation mentale » comme arme de guerre éventuelle.
Malgré sa proximité avec les « théories du complot », cette
thèse illustre les liens certains entre ergotisme et LSD.
Appliquons au LSD cette citation de Paul Watzlawick sur une vieille
chanson autrichienne de l’époque des ardents : « Oh du lieber
Augustin, alles is’ hin dont voici une traduction fort libre : Oh
mon Dieu, tout s’est mué en crotte ! » Sinistre retombée des
recherches sur l’ergot de seigle, le LSD montre que la pâte des
découvertes médicales n’est pas toujours bénéfique mais, parfois,
empoisonnée : comme dit un proverbe ancien, « le soleil illumine
les succès du médecin, mais la terre recouvre ses échecs. »
Dr Alain Cohen




