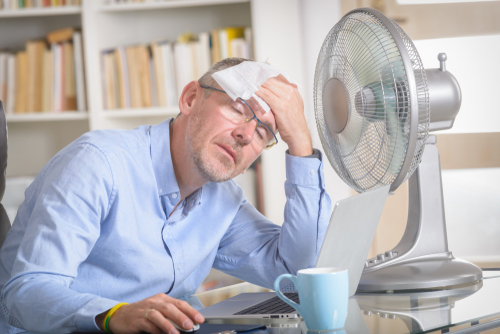
Paris, le lundi 26 octobre – Selon le bilan établi et publié
par Santé Publique France, les épisodes caniculaires de cet été ont
provoqué la mort de 1 924 personnes.
La (sur)médiatisation de l’épidémie de Covid-19 nous ferait
(presque) oublier que les Français sont sujets à d’autres cause de
mortalité « évitable » dont certaines sont parfois plus
meurtrières que la pandémie qui occupe continuellement nos esprits.
Ainsi, durant l’été dernier, alors que le taux de mortalité du
coronavirus était très faible (environ 800 morts en juillet/août en
France), les différentes vagues de chaleur qui ont touché notre
pays ont couté la vie à près de 2 000 personnes en quelques
semaines, selon le bilan publié par Santé Publique France mardi
dernier.
Durant l’été 2020, les services météorologiques ont
comptabilisé trois vagues de chaleur ou épisodes caniculaires, qui
définis par un dépassement des seuils d’alerte pendant trois jours
consécutifs (les températures correspondant à ces seuils d’alerte
différent selon les régions). La plus importante a eu lieu du 7 au
13 août dernier et a concerné 64 départements soit 48 millions de
personnes.
Bilan meurtrier dans le nord de la France
Au total, ces épisodes caniculaires ont conduit à 1 924 décès
en excès, soit une augmentation de la mortalité de 18,3 % durant
les périodes considérées. Les personnes âgées sont, comme à chaque
épisode caniculaire, les plus durement touchées : 1 377 personnes
de plus de 75 ans sont décédés, soit une surmortalité de 20 %.
Mais, un peu comme pour le coronavirus, Santé Publique France
insiste sur le fait que les populations plus jeunes ne sont pas
épargnées. Une surmortalité non négligeable de 12 % est ainsi
observée chez les personnes âgées de 45 à 64 ans.
Les régions du nord de la France, où les températures ont
atteint des records de chaleur, ont été les plus durement touchées.
Les Hauts de France comptent ainsi près de 450 morts en excès, soit
une surmortalité de 46 %. L’augmentation de la mortalité est
également importante dans les Pays de la Loire (34 %) et en
Normandie (28 %) (soit trois régions peu habituées aux vagues de
chaleur). La canicule a également mis à rude épreuve nos hôpitaux,
avec 15 000 passages aux urgences liés à la canicule entre le 1er
juin et le 15 septembre, soit 15 % des passages durant cette
période. En moyenne, une vague de chaleur multiplie par 2,5 les
passages aux urgences. Doit être ajouté à ce bilan 12 accidents du
travail mortels liés à la canicule.
Une politique sanitaire efficace
Bien que de plus faible intensité que celles des années
précédentes (excepté dans le nord de la France), la canicule de
l’été 2020 a été plus meurtrière que celles des années précédentes.
A titre de comparaison, la canicule de 2019 avait tué 1 462
personnes. Le réchauffement climatique risque malheureusement de
rendre ces épisodes caniculaires et ces étés meurtriers de plus en
plus fréquents. La canicule de 2020 est ainsi la quatrième que
connait notre pays en seulement 6 ans.
Nicolas Barbet




