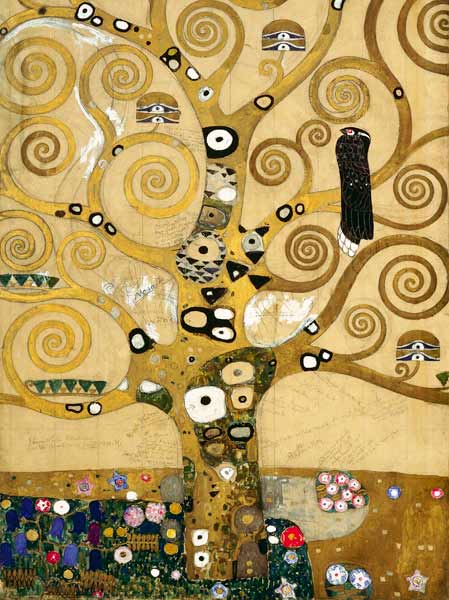
Un oui qui veut dire non ?
Ce fut un des autres revirements de la semaine. Elle a débuté
avec l’idée qu’Emmanuel Macron se refusait de céder aux injonctions
de médecins l’enjoignant à adopter des mesures pouvant quasiment
être considérées comme préventives. Et bientôt, elle a glissé dans
la certitude d’un confinement imminent. Elle a également débuté
avec des sondages mettant en garde contre un risque que
l’acceptation ne soit plus au rendez-vous, tandis qu’aux Pays-Bas
les émeutes flambaient et que dans d’autres états les
manifestations se multipliaient. Et finalement, une nouvelle
enquête mettant en avant une proportion de Français majoritairement
favorables au confinement (62 %) et tout en même temps (french
paradox) refusant la fermeture des écoles (60 %) ou
l’impossibilité de recevoir des proches ou des amis (57 %).
L’ambivalence des résultats rappelle bien sûr les limites de ce
type d’enquête mais révèle également une forme de changement
d’attitude des Français, résignés quant à l’inéluctabilité du
confinement et se raccrochant pourtant encore à l’espoir que les
derniers degrés de liberté dans un pays où tant d’activités sont
déjà impossibles ne leur soient pas enlevés. Cependant, la
proportion de Français affirmant qu’ils pourraient, en tout cas
occasionnellement, transgresser les dispositions est encore
minoritaire (42 %).
Réveillons-nous !
Cette obéissance, qui ne préjuge cependant pas d’un réel consentement « éclairé » pour reprendre l’expression du professeur d’éthique médicale, Emmanuel Hirsch, est évidemment indispensable. D’abord pour garantir une certaine efficacité des mesures et ensuite parce qu’il serait probablement désastreux d’ajouter aux crises que nous traversons (sanitaire, économique, morale et dans une certaine mesure démocratique) un nouveau chaos. Pourtant, il y a dans cette tristesse, cette lassitude repérée par toutes les enquêtes d’opinion un signal préoccupant du renoncement des Français à reconquérir leur vie.Quelques appels pourtant ont été remarqués. Non pas à la désobéissance mais à reconsidérer le sens des proportionnalités et les fondements de ce qui fait notre humanité. C’est bien sûr le désespoir de la jeunesse qui est le stigmate premier de cette perte de sens, le point de départ de la réflexion de beaucoup, mais ces discussions vont au-delà, en nous interrogeant tous sur ce que la crise a fait de nous.
On ne sauve jamais aucune vie
C’est le cri de colère de l’essayiste François de Closets (87 ans) cette semaine sur RMC. « On est parti sur cette idée que la vie n'a pas de prix mais que toutes les vies ont le même prix. Eh bien, moi je vous dis que la vie a un prix et que toutes les vies n'ont pas le même prix. Il est évident que, quand vous arrivez à la fin de votre vie, qu'il vous reste quelques années à vivre, votre vie n'a pas du tout le même prix que la vie d'un jeune qui a 20 ans et qui a sa vie devant lui. S'il faut faire des sacrifices, il faut que ce soit le passé au profit de l'avenir. Moi, je ne pense qu'à l'avenir ! Que je vive un peu plus longtemps, un peu moins longtemps, ça n'a aucune importance. En revanche, il y a la vie de mes enfants, de mes petits-enfants et de toutes ces générations. Cela importe » a-t-il déclaré très ému. « Je trouve honteux la façon dont on tient très peu compte de ce qu'il va se passer si on fait un troisième confinement. Mais comment vont-ils trouver du travail ? Mais comment vont-ils vivre ? C'est ça qui compte ! Ce n'est pas de savoir si l'espérance de vie va reculer de six mois ! Enfin ! C'est la jeunesse qui compte ! Ce n'est pas les vieux ! » a-t-il poursuivi. Le message fait écho à l’analyse du philosophe et essayiste Gaspard Koenig (39 ans), dont l’éditorial dans les Echos, intitulé « Vies prolongées contre vies gâchées » invite à se souvenir d’un fait incontournable et pourtant comme gommé : « On ne sauve jamais des vies, on ne fait que les prolonger : nous sommes tous condamnés à mort (...). Quelles vies prolonge-t-on et de combien d’années ? Toujours selon Santé publique France, l’âge médian des victimes de Covid est de 85 ans légèrement supérieur à l’âge de décès médian en France. Autrement dit, la plupart de ceux dont la mort est évitée par les restrictions appartiennent déjà à la minorité de survivants de leur génération » rappelle-t-il après avoir mis en avant que « Parmi ma classe d’âge (15-44 ans), le nombre de patients décédés sans comorbidité depuis le début de l’épidémie dans notre pays est de 60 ». Il poursuit encore : « On ne ralentit pas l’économie, on gâche d’autres vies (…). Les vies brisées des patrons de bar, des artistes ou des commerçants. Les vies zombies des étudiants devant leurs écrans, des gamins masqués à l’école, des voyageurs testés et restestés. Les vies durablement assombries, les nôtres à tous, parce qu’on ne peut plus danser sans devenir délinquant, prendre un verre sans se munir d’une dérogation ou serrer les mains sans subir l’opprobre générale ». Aussi, pour lui face à cette équation, est-il indispensable de retrouver le sens des proportionnalités.Pas que des bourgeois bohèmes en mal de voyages
On sait déjà les commentaires que peuvent susciter ce type de réflexions : on peut se gausser rapidement de l’égoïsme du bourgeois-bohème mécontent de ne plus pouvoir se promener à l’autre bout du monde ou d’aller au théâtre. La rédactrice en chef de Marianne, Natacha Polony anticipe ces critiques dans son dernier éditorial : « Évidemment, ce ne sont pas les tranchées. Ce ne sont pas non plus les nazis ou la Milice, qui traquent et torturent. On a beau jeu de les traiter de chochottes, ces jeunes qui disent leur désespoir, leur solitude, ces commerçants, patrons de théâtre ou restaurateurs qui, après tout, n’ont pas à se plaindre, puisque, n’est-ce pas, ils sont indemnisés. Oui, nous sommes des générations de consommateurs choyés, trop souvent incapables de simplement nous figurer les horreurs qu’a vécues l’humanité avant nous. Mais quelque chose nous dit que l’argument ne tient pas. Que ces jeunes gens dépressifs ou suicidaires ne regrettent pas seulement de ne pas pouvoir « faire la fête », ce à quoi nous avions réduit la jeunesse et que finalement nous lui avons retiré » débute-t-elle poursuivant encore : « On entend d’ici les commentaires indignés (l’indignation est la nouvelle forme de la vertu contemporaine) : nous n’avons pas le choix, il faut éviter des morts ». Pourtant, alors que la parenthèse s’éternise et que de plus en plus nous percevons qu’elle pourrait encore perdurer, Natacha Polony et d’autres se demandent si le temps ne serait pas venu de reprendre notre destin en main. « Qu’est-ce qui provoque la déprime, la dépression, même, de tant de nos concitoyens ? Pourquoi le désespoir pour les uns, la rage pour les autres ? La plus grande violence qui nous soit infligée, n’en déplaise à ceux qui croient que les confinements à répétition constituent la seule réponse « raisonnable », est de nous priver de toute autonomie. Dans toutes les crises rencontrées jusqu’ici par les générations qui nous ont précédés, il appartenait à chacun de se déterminer en son âme et conscience pour décider de son destin. (…) [Nous sommes] réduits à subir parce que toute forme d’action individuelle, tout refus de subir, serait incivique. Une mise en danger de la vie d’autrui. On ne dit pas organiser des fêtes ou s’entasser dans les bars, non. Seulement agir, travailler, vivre. Et arbitrer en fonction de son intelligence, en interaction avec d’autres, qui, même « fragiles », sont également doués de libre arbitre. (…) Mobiliser les jeunes gens de ce pays, c’est leur apprendre qu’ils sont maîtres de leur destin. Qu’il leur appartient de décider de ce que sera leur vie, et que l’État est là pour leur donner les moyens de cette liberté en compensant les inégalités qui l’entravent. Que la vie, pour un être humain, n’est pas une donnée biologique mais un art très personnel que nul ne doit se laisser voler. Et qu’être véritablement humain, c’est choisir la compassion pour les autres, mais la liberté pour soi-même » conclut-elle.Derrière la logorrhée
On sait. On sait que l’on va nous redire qu’il est tellement facile pour des éditorialistes, bien chaudement dans leur confortable bureau, de se laisser aller à de telles logorrhées, de s’écouter parler, quand les soignants font face au front. On sait que l’on va nous redire que si la Covid tue principalement les plus vieux, des formes graves peuvent également affecter des jeunes, parfois même sans comorbidités, et que les semaines passées en réanimation peuvent laisser de lourdes séquelles et sont toujours traumatisantes. On rappellera que les médecins qui sont les premiers témoins des souffrances mentales des patients et des conséquences des retards de soins sont parfaitement conscients des méfaits du confinement. On remarquera d’ailleurs qu’il n’y a pas parmi ces beaux parleurs beaucoup de médecins. C’est vrai, la plupart, préfèrent utiliser leur temps de parole pour rappeler l’inéluctabilité du confinement, la nécessité d’agir tôt ne serait-ce que pour agir moins longtemps. Ceux qui tiennent des discours décalés, sont moqués (comme Martin Blachier remarquant pourtant que la violence du confinement impose des justifications et des preuves solides) ou relégués dans des médias obscurs, comme le professeur Jean-François Toussaint qui cette semaine sur le site Bas les Masques a lancé un appel à Emmanuel Macron pour qu’il écoute la désespérance de la jeunesse et où il insiste sur le signe inquiétant de la diminution de la natalité. Mais pourtant, plus timidement, même dans les médias mainstream, une parole différente commence à se faire entendre. C’est le professeur Jean-François Delfraissy lui-même qui face aux difficultés de la jeunesse invite à reconsidérer un confinement des plus à risque, ou c’est le professeur Michaël Peyromaure, lui-même confronté à la souffrance tous les jours dans son service, qui, après avoir regretté en novembre le choix de « massacrer un pays pour sauver 30 000 vies » continue à exprimer sa plus grande réticence vis-à-vis du confinement.Enfin, toutes ces voix, médicales ou non médicales, ne sont nullement des chantres d’un laisser faire total, ils ne sont pas totalement sans proposition (même si cela leur est reproché), mais ils tentent d’œuvrer pour « sortir du déni » dit Natacha Polony, pour un autre regard, une pensée plus complexe qu’un manichéisme sanitaire, qu’une liberté confinée.
Gaspard Koenig : https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/vies-prolongees-contre-vies-gachees-le-vrai-dilemme-de-la-lutte-anti-covid-1282608
Natacha Polony : https://www.marianne.net/vivre-avec-le-virus-cest-retrouver-la-liberte
Jean-François Toussaint : https://baslesmasques.com/o/Content/co361985/monsieur-le-president-de-la-republique-liberez-vous
Aurélie Haroche




