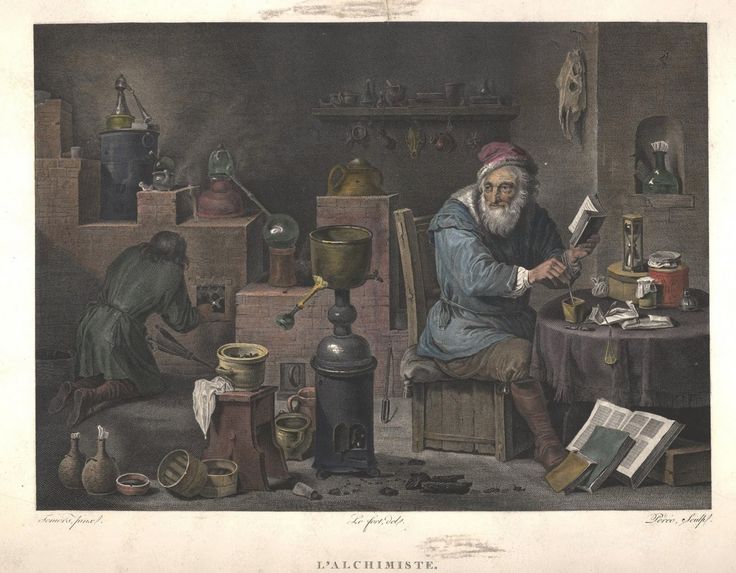
Paris, le jeudi 10 novembre 2022 – Il y a quelques semaines,
des chercheurs de l’université de Boston décrivaient sur le site de
prépublication BioRxiv leurs expériences destinées à comparer la
protéine spike du variant Omicron de Sars Cov-2 avec celle de la
souche originale. Pour ce faire, ils ont mis au point une version
hybride du virus.
La médiatisation de cette présentation, qui s’est notamment
concentrée sur le fait que le virus obtenu par les chercheurs était
associé à une très haute mortalité chez des souris spécifiquement
sélectionnées pour leur grande susceptibilité à SARS-CoV-2, a
contribué à réactiver une controverse très ancienne sur la
pertinence de ce type de manipulation virologique en
laboratoire.
Depuis plusieurs années, la communauté scientifique est en
effet divisée sur la position à adopter face à ces travaux, qui
conduisent à des « gains de fonctions » pour les virus originaux.
Chaque nouvelle expérience médiatisée ravive les discussions, comme
on s’en souvient en 2011 les travaux de Ron Fouchier et Yoshihiro
Kawaoka qui avaient induit des mutations du virus de la grippe
aviaire H5N1 afin d’accroître sa transmissibilité entre humains, ce
qui avait entraîné un regain de popularisation du terme «
Frankenvirus ».
Qu’il s’agisse de ces recherches ou de celles de Boston
aujourd’hui, faut-il considérer qu’elles apportent des
connaissances scientifiques essentielles et doivent donc être
encouragées, si toutefois toutes les conditions de sécurité sont
respectées ou au contraire juger que les risques sont bien
supérieurs aux bénéfices et totalement les interdire ?
Rien à gagner
La Covid a-t-elle modifié les données de cette controverse ?
D’abord, elle a probablement affaibli considérablement un des
arguments souvent mis en avant par les défenseurs de ce type de
manipulations soulignant la nécessité de se préparer à une
pandémie. De fait, les expériences dites de « gains de fonctions »
qui ont été conduites par le passé ne semblent guère avoir permis
au monde de mieux faire face à la plus grande pandémie de ces 100
dernières années, tandis que ce sont d’autres types de recherche
(celles sur les ARNm) qui nous ont permis de nous en libérer (en
partie).
Par ailleurs, même si l’origine de SARS-CoV-2 demeure encore
très opaque, la possibilité que des travaux de laboratoire aient pu
favoriser la circulation du nouveau tueur est très loin d’être
écartée aujourd’hui.
« Au fil du temps, l’hypothèse qu’un accident de
laboratoire soit à l’origine de la pandémie a discrètement fait son
chemin dans les milieux scientifiques. Pourfendue comme complotiste
dans une tribune indignée du Lancet publiée en février 2020,
vilipendée durant les premiers mois de la pandémie par toutes les
sommités de la virologie, cette hypothèse n’a fait que progresser
depuis lors. Au point qu’un grand nombre de chercheurs la tiennent
désormais, généralement en privé, pour la plus probable »
résume dans le Monde, le journaliste scientifique Yves
Sciama.
Les manipulateurs de virus prolifèrent
Si ces différents éléments pourraient nous avoir prévenu des
limites voire des dangers de ce type de travaux, la Covid a en
réalité entraîné leur accélération. « Des expériences qui
étaient rarissimes il y a une quinzaine d’années deviennent
beaucoup plus fréquentes. Ça nécessite d’avoir davantage de
régulations éthiques et davantage de raisonnement sur les risques
et les bénéfices de ce type d’expériences », observait ainsi il
y a quelques jours dans l’émission de Guillaume Erner sur les ondes
de Radio France Etienne Decroly, virologue, directeur de recherche
au CNRS dans le laboratoire Architecture et Fonction des
Macromolécules Biologiques (AFMB) de l’Université
d’Aix-Marseille.
Filippa Lentzos, spécialiste de biosécurité au King’s
College de Londres, lui fait écho dans les colonnes du Monde :
« On voit aujourd’hui se multiplier les demandes de financement
pour la préparation pandémique dans les pays du Sud où le risque
d’émergence est le plus fort, ce qui nous place à une sorte de
croisée des chemins. Est-ce que cet argent va aller dans des
directions sûres, à des investissements dans les hôpitaux, à de la
surveillance de l’état de santé des populations, ou bien est-ce
qu’une partie significative alimentera la dangereuse collecte de
virus dans la faune sauvage, ou des expériences sur ces virus qui
jusqu’à aujourd’hui n’ont jamais permis de prédire ni de préparer
les pandémies ? » s’interroge-t-elle.
Rien de meilleur que le gain de fonction ?
La multiplication probable de ce type d’expériences relance les mêmes interrogations. Sont-elles indispensables dans le sens où aucune autre technique ne permettrait d’obtenir les réponses recherchées ? Là encore, la controverse fait rage, résumée il y a quelques années par Gabriel Gazeau et ses camarades de l’Ecole des mines (à l’occasion d’une réflexion sur les travaux de Ron Fouchier et Yoshihiro Kawaoka) : « Cependant, il ne semble pas y avoir de méthodes alternatives au GOF (Gain of Function, ndlr). Par exemple, certains opposants aux recherches présentent la méthode inverse du Gain-of-Function comme alternative. Il s’agit naturellement du procédé par Loss Of Function, qui suit une logique inverse: en retirant un tropisme génétique, on observe quelle fonction de la molécule est éventuellement perdue. On pourrait ainsi obtenir un résultat similaire sans se retrouver à manipuler une souche virale dangereuse. Cependant, si le processus est symétriquement inverse, les résultats ne le sont pas. Observer une perte de fonction liée au retrait d’un tropisme ne se traduit pas par une corrélation entre le tropisme et la fonction. Ceci signifie que cette relation n’est pas symétrique, et que l’on ne peut en déduire que le gain du même tropisme sur une molécule différente lui fera acquérir la fonction. L’intérêt pratique de la méthode en est grandement atténué, puisque l’on cherche à identifier quels virus dans la nature seraient en mesure d’acquérir la fonction de transmissibilité d’homme à homme ».
Plus rien à perdre !
Cependant, l’objection selon laquelle ces recherches n’ont pas
permis de nous prémunir de la pandémie de Covid n’apparaît pas
totalement disqualifiée. Avant même cette dernière, d’ailleurs,
certains invitaient à se méfier de ce type de discours. Les
étudiants de l’école des mines décrivaient : « Les anti-GOF/PPP
ne nient pas que les expériences menées par Fouchier et Kawaoka ont
permis d’identifier la protéine impliquée dans le processus de
mutation qui confère au virus le caractère transmissible.
Néanmoins, selon eux, l’intérêt d’une telle découverte reste limité
: l’identification de cette protéine n’exclut pas qu’un mécanisme
de mutation associé à des protéines autres puisse lui aussi
contribuer à l’acquisition du caractère transmissible par le virus
H5N1. Considérant la grande instabilité des virus grippaux,
identifier le mécanisme de mutation associée à une protéine
spécifique a donc une valeur scientifique limitée qui de leur point
de vue, est loin de compenser les risques encourus. Les partisans
des expériences de type GOF considèrent que l’identification du
type de mutations impliquées dans l’acquisition du caractère
transmissible fournit, au-delà de la compréhension des mécanismes
en cause, des données utiles pour surveiller, prédire, voire
prévenir le risque de transmissibilité et d’augmentation de la
virulence. Les opposants leur rétorquent qu’en mettant en avant les
applications éventuelles des connaissances acquises pour la
surveillance ou la prévision de pandémie, les promoteurs de ces
expériences en comptent en fait deux fois les « bénéfices ». Il
faut distinguer connaissance scientifique en tant que telle
(établir des relations causales) et application de cette
connaissance (établir des relations instrumentales). La
connaissance acquise est certes un outil qui peut permettre des
avancées dans le domaine de la santé. Néanmoins, il est difficile
d’évaluer à l’avance les possibles bénéfices qui pourront être
tirés de ces applications. Or, les pro-GOF ont tendance à
considérer que les bénéfices tirés de ces applications sont
certains ».
L’histoire a démontré que cela n’était pas parfaitement
prouvé. Néanmoins, de façon paradoxale, Marc Lipsitch,
épidémiologiste américain et professeur au département
d'épidémiologie du Harvard T.H. Chan School of Public Health, qui
s’est pourtant très souvent montré réticent vis-à-vis des travaux
dits de « gain de fonction » note dans le Monde : « La pandémie
a changé à la fois le bénéfice et le risque des expériences de gain
de fonction. Le risque est moindre, puisque si ces expériences
pourraient certes créer une nouvelle vague, la pandémie est déjà
là. Et à l’inverse, les bénéfices de mieux comprendre le virus sont
plus importants, puisque ce virus tue des gens chaque jour.
»
Gestion des risques : des défis à perception variable
Reste en tout état de cause (et puisqu’une interdiction de ces
travaux pourtant souhaitée par certains scientifique apparaît
utopique) la question de la sécurité des laboratoires. Or, outre le
fait que dans les pays émergents, des craintes légitimes peuvent
exister, dans les pays développés, les risques peuvent être plus
insidieux. En effet, comme le faisait remarquer Marc Lipsitch, à
propos de l’expérience de Ron Fouchier et Yoshihiro Kawaoka, «
les gros risques à faible probabilité sont une des choses les plus
difficiles à gérer pour l’esprit humain ».
Ainsi, Ron Fouchier et Yoshihiro Kawaoka n’avaient pas choisi
d’utiliser le niveau maximal de sécurité BSL4 (Biosafety Level),
réservé à la manipulation des agents biologiques les plus mortels,
ce qui a pu être critiqué. Par ailleurs, les cultures scientifiques
et les législations de chaque pays jouent également un rôle majeur.
En France, par exemple Marc Eloit, de l’Institut Pasteur est
convaincu qu’une étude comme celle conduite à Boston n’aurait pas
pu être réalisée.
« « Il ne serait même venu à l’idée de personne de la
proposer », assure-t-il, pointant qu’il y a en France une culture
de la biosécurité et une aversion au risque différentes de ce que
l’on rencontre aux Etats-Unis » relate Yves Sciama. Certes,
mais il existe parallèlement un vide juridique dans notre pays
(rappelé dans Médecine Science par Fanny Velardo et ses confrères
de l’Ecole Pasteur-Cnam de santé publique au printemps dernier) qui
nous place dans une situation si non dangereuse tout au moins
inquiétante.
Ainsi, on le voit, la complexité des enjeux demeure et la Covid si elle a renforcé l’urgence de s’y pencher est loin d’avoir permis d’y répondre. On pourra relire pour s’en convaincre les analyses de :
Yves Sciama,
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/11/07/le-covid-19-ravive-le-debat-autour-de-la-manipulation-des-virus_6148855_1650684.html
Etienne Decroly,
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-question-du-jour/frankenvirus-faut-il-mieux-encadrer-certaines-manipulations-en-laboratoire-7308815
Gabriel Gazeau et coll :
https://controverses.minesparis.psl.eu/public/promo14/promo14_G5/www.controverses-minesparistech-1.fr/_groupe5/index.html
Fanny Velardo et coll :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03620428/
Aurélie Haroche




