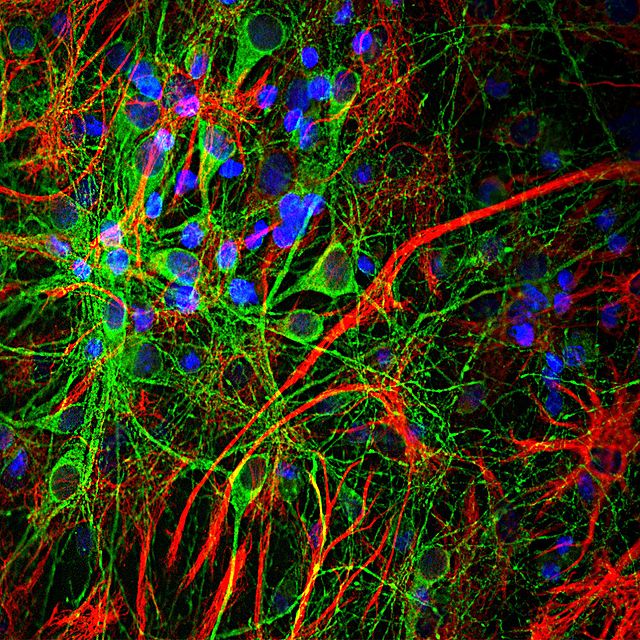
Clarity-AD : un essai contrôlé contre placebo
Il s’agit d’un essai de phase 3 multicentrique, en double
aveugle, mené pendant 18 mois auprès de patients âgés de 50 à 90
ans atteints de MA précoce (troubles cognitifs légers ou démence
légère dus à la MA selon les critères du National Institute on
Aging–Alzheimer’s Association NIA-AA) et présentant des signes
d'amyloïdose à la tomographie par émission de positons (TEP) ou par
dosage du Aβ dans le liquide céphalorachidien.
Les participants ont été assignés au hasard dans un rapport
1:1 pour recevoir du lécanemab par voie intraveineuse (10 mg/kg
toutes les 2 semaines) ou un placebo. Le principal critère
d'évaluation était la variation, entre le début de l'étude et à 18
mois, du score d'échelle clinique de la démence (CDR-SOB ;
intervalle de 0 à 18, les scores les plus élevés indiquant une plus
grande déficience).
Les principaux critères d'évaluation secondaires étaient la
modification de la charge amyloïde à la TEP, le sous-score cognitif
de l'échelle d'évaluation de la maladie d'Alzheimer (ADAS-cog14 ;
de 0 à 90 ; plus le score est élevé, plus l'atteinte est
importante), le score composite de la maladie d'Alzheimer (ADCOMS ;
de 0 à 1.97 ; plus le score est élevé, plus la déficience est
importante) et le score de l'échelle d'activités de la vie
quotidienne de l'étude coopérative sur la maladie d'Alzheimer pour
les déficiences cognitives légères (ADCS-MCI-ADL ; de 0 à 53 ; plus
le score est faible, plus le déficit est important).
Lécanemab mieux que placebo sur les scores cliniques et la TEP…
Au total, 1795 participants ont été recrutés, dont 898 ont
reçu du lécanemab et 897 un placebo. Le CDR-SOB moyen initial était
d'environ 3,2 dans les deux groupes. Le changement moyen ajusté par
rapport au début de l'étude à 18 mois était de 1,21 avec le
lécanemab et 1,66 avec le placebo (différence -0,45 ; intervalle de
confiance [IC] à 95 %, -0,67 à -0,23 ; p<0,001). Dans la
sous-étude en TEP (698 participants) les réductions de la charge
amyloïde cérébrale ont été plus importantes avec le lécanemab
qu'avec le placebo (différence -59,1 centiloïdes ; IC à 95%, -62,6
à -55,6). Les autres différences moyennes de modifications par
rapport aux valeurs initiales en faveur du lécanemab étaient les
suivantes : pour le score ADAS-cog14, -1,44 (IC à 95%, -2,27 à
-0,61 ; p<0,001) ; pour l'ADCOMS, -0,050 (IC à 95%, -0,074 à
-0,027 ; p<0,001) ; et pour le score ADCS-MCI-ADL, 2,0 (IC à
95%, 1,2 à 2,8 ; p<0,001).
…mais un possible risque d’hémorragie cérébrale
Le taux de décès n’était pas différent dans les deux groupes
(0,7 % vs 0,8 % sous placebo). Le lécanemab a entraîné des
réactions liées à la perfusion chez 26,4 % des participants (vs 7,4
% avec le placebo). Des anomalies d'imagerie liées à l'amyloïde
(ARIA) avec micro et macrohémorragies cérébrales (ARIA-H) était
plus fréquentes sous lecanemab 17,3 % vs 9,0 % sous placebo ; les
ARIA-E (avec œdème) également : 12,6 % avec lecanemab vs 1,7 % avec
le placebo.
Pendant l’essai, 13 patients du groupe lecanemab (1,4 %) ont
développé un AVC symptomatique (vs 2 patients sous placebo). Par
ailleurs, 2 décès liés à un AVC ont été rapportés dans les médias,
survenus lors de la prolongation en ouvert de l’essai. Des
investigations complémentaires sont en cours mais il est possible
que le lecanemab majore le risque d’hémorragie cérébrale.
Ainsi, dans cette étude, le lécanemab est associé à une
réduction des marqueurs de l'amyloïdose dans la MA précoce et à un
déclin modérément moindre des scores cognitifs et fonctionnels que
le placebo à 18 mois, mais également à une fréquence d’effets
indésirables non négligeable. Ce traitement pourrait permettre aux
patients de se maintenir plus longtemps à un stade précoce de la
maladie mais est-ce qu’une modification de 0,45 points au CDR a une
signification clinique pour le patient ? Au prix d’effets
secondaires potentiellement graves ? Des essais plus longs sont
justifiés pour déterminer l'efficacité et la sécurité du lécanemab
dans la MA précoce. La Food and Drug Administration rendra
quant à elle sa décision début janvier…
Dr Isabelle Méresse




