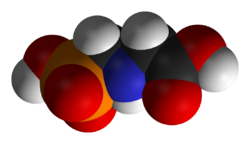
Paris, le samedi 28 octobre 2023 – C’est probablement un des numéros d’Envoyé Spécial qui a suscité le plus de commentaires. Même ceux qui n’étaient pas devant leur écran le 17 janvier 2019 se souviennent des « célébrités » médusées recevant les résultats de leur test urinaire, destiné à rechercher la présence de glyphosate.
Pourtant, comme l’avaient à l’époque signalé plusieurs spécialistes de l’information scientifique, asséner de façon spectaculaire que tous les échantillons d’urine, de Lilian Thuram à Julie Gayet, présentent des traces de glyphosate ne peut nullement être considéré comme une donnée significative et encore moins préjudiciable. Mais ce sont bien plus certainement les effets d’annonce qui avaient été retenus que cette prise de distance.
Un compte-rendu d’audience sans verdict
Outre les douteux tests d’urine, c’est la présentation flatteuse des travaux de Gilles-Eric Séralini qui avait suscité la désapprobation de quelques valeureux « gardiens de la raison », qui avaient rappelé que les « études » du chercheur, censées démontrer chez la souris la toxicité indéniable des OGM et du glyphosate, étaient entachées de tels biais qu’elles avaient été épinglées par nombre de sociétés savantes. La dénonciation du caractère « trompeur » ou encore « frauduleux » des « expériences » du chercheur par Patrick Cohen (sur le plateau de C à vous), Mac Lesggy (M6) et Géraldine Woessner (à l’époque Europe 1) leur avaient valu d’être l’objet d’une plainte en diffamation déposée par Gilles-Eric Séralini.
Les trois journalistes n’ont pas toujours été pleinement soutenus par leurs confrères dans cette bataille judiciaire. Ainsi, comme le rapporte le scientifique agronome André Heitz sur son blog, le jour de l’audience, le 1er septembre 2023, Reportere publiait un entretien avec Gilles-Eric Séralini intitulé Qui va vérifier que Monsanto ne fraude pas, qui rappelait en guise d’Appendix : « Le Conseil de déontologie journalistique et de médiation a analysé, dans un avis rendu en juin dernier, un article du Point co-signé par Mme Woessner. Le Conseil a estimé que "les règles déontologiques d’exactitude et de respect de la véracité des faits, d’une part, et d’offre de réplique, d’autre part, n’ont pas été appliquées par Le Point" ».
Cependant, bien qu’apparemment attentif à cette affaire opposant Géraldine Woessner à Gilles-Eric Séralini, Reportere n’a pas cru bon d’informer ses lecteurs de l’issue de l’affaire les opposant. Pas plus Politis qui s’était pourtant fendu d’un compte rendu d’audience. La décision est-elle en cause dans cet oubli ? Le 17 octobre, la justice a débouté Gilles-Eric Séralini estimant que les propos des trois journalistes ne pouvaient être considérés comme de la diffamation. Le jugement aura même relevé que les affirmations de Géraldine Woessner s’appuyaient sur « des bases factuelles abondantes ».
Deux militantismes distincts
Le silence de leurs confrères confirme bien la scission quasiment assumée au sein de la presse française sur le sujet du glyphosate et au-delà sur les questions des méfaits environnementaux et sanitaires des substances chimiques. D’un côté, ceux qui, convaincus de leur toxicité, n’hésitent pas à militer pour la reconnaissance de la dangerosité de ces produits, en dépit des limites de la science sur le sujet. De l’autre, ceux qui tentent de rappeler la complexité de la démarche scientifique, de décrypter les avis et qui essayent de n’avoir comme seul objet de militantisme que la raison et la présentation des faits scientifiques.
Les premiers sont des médias qui continuent probablement à jouir en France d’une aura quasiment inégalée de sérieux et de respectabilité. C’est par exemple France Inter et l’institution qu’est La tête au carré de Mathieu Vidard ou plus encore Le Monde et son incontournable journaliste scientifique Stéphane Foucard.
Les seconds sont souvent des blogueurs ayant fait du décryptage de l’information et de la vulgarisation scientifique leur cheval de bataille ou des journalistes dont le champ n’est souvent pas uniquement la science, telles Géraldine Woessner ou Emmanuelle Ducros. Les discours des seconds sont souvent discrédités par l’évocation de potentiels liens avec l’industrie (souvent fantasmés).
Mais la présentation parfois biaisée de l’information n’est pas toujours là où on le croit.
Paradoxes et glissements
Ainsi, récemment, le glyphosate en a apporté une nouvelle illustration. A la veille de l’examen par la Commission européenne de la prolongation d’autorisation du glyphosate, le Monde a ainsi voulu relayer l’appel d’un clinicien et d’une chercheuse en électrophysiologie néerlandais concernant un lien entre glyphosate et maladie de Parkinson. A propos du titre du Monde (« Il y a de quoi s’inquiéter sérieusement du lien possible entre glyphosate et Parkinson ») André Heitz fait remarquer avec ironie « il y a une expression de prudence avec "possible"… mais il faut s’inquiéter "sérieusement"».
Outre cette note sémantique (qui est loin d’être unique), André Heitz relève plusieurs glissements. Il constate ainsi l’absence de mention du fait que la principale raison de l’augmentation de la maladie de Parkinson demeure probablement le vieillissement de la population, laissant ainsi la place à un doute concernant le rôle du glyphosate. Par ailleurs, il épingle l’amalgame entre pesticides et glyphosate.
« Et, si des études pointent effectivement vers des liens (statistiques) entre maladies neurodégénératives, notamment Parkinson, et pesticides, il y a un chemin plutôt long entre « pesticides » et glyphosate (…). Le bulletin N° 3 d'AGRICAN de novembre 2020 donne des détails sur ce qui a été trouvé pour la maladie de Parkinson sur une vaste cohorte d'agriculteurs de plus de 180 000 personnes. Il n'y est nullement question de glyphosate. La plupart des molécules mentionnées ont été interdites il y un certain temps (ainsi, la roténone a pu être utilisée, y compris en agriculture biologique, jusqu'en 2009). Parkinson étant d'évolution lente et d'apparition généralement tardive, ce qu'on observe aujourd'hui est en grande partie l'héritage d'hier, voire d'avant-hier », corrige-t-il.
L’injustice des émotions
L’ellipse ou l’assimilation ne sont pas seules à pouvoir (volontairement ou non) entraîner une présentation si non erronée en tout cas décalée de la réalité scientifique. De façon plus marquée, des « déformations » peuvent être repérées. Encore une fois à la veille de l’examen par la Commission européenne de la prolongation d’autorisation du glyphosate, une famille, dont l’enfant, Théo Grataloup, est né avec une atrésie de l’œsophage a voulu médiatiser l’avis (déjà un peu ancien) du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) en leur faveur. Selon Le Monde (Stéphane Foucart) citant le texte de l’avis, ce dernier aurait reconnu « la possibilité du lien de causalité entre la pathologie de l’enfant et l’exposition aux pesticides durant la période prénatale du fait de l’activité professionnelle de l’un ou des deux parents ».
Cependant, cet avis est loin d’être la preuve ultime finissant de démontrer la toxicité (ici tératogène) du glyphosate. D’abord, comme le note André Heitz, il semble que le Monde ait mal lu l’avis qui, comme le signale le Point, a en réalité « conclu » que : « Devant la profession exercée par la maman, la commission considère que l'exposition professionnelle aux pesticides, bien que limitée, est plausible, et retient la possibilité de lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides durant la période prénatale ».
L’absence de citation in extenso prive de la possibilité de comprendre l’extrême prudence du Fonds dans son avis et son mécanisme d’évaluation. Or, Géraldine Woessner (encore… ce qui d’ailleurs lui a été très vertement reproché par l’avocat de Gilles-Eric Séralini quelques jours après sa relaxe) décrypte : « On peut cependant supposer que cette entité publique, placée sous la tutelle de la Mutuelle sociale agricole (MSA), s'est appuyée sur un référentiel couramment utilisé pour évaluer quantitativement la causalité, basé sur une échelle dont les points sont assignés en fonction de caractéristiques (cliniques, biochimiques, sérologiques et radiologiques) objectives. Selon ce score, le mot « possible » suggère un niveau de preuve légèrement supérieur au niveau « peu probable », mais très inférieur à celui d'une causalité « probable » ou « hautement probable ». Bref : absolument rien de conclusif, confirme l'un des meilleurs spécialistes de cette maladie ».
Le Pr Frédéric Gottrand, responsable du centre de référence des malformations œsophagiennes rappelle que l’étiologie de la malformation dont souffre Théo Grataloup demeure inconnue et que dans les différentes discussions de spécialistes, le rôle potentiel des pesticides n’a que peu de place. « Le glyphosate n'est évoqué que parce qu'il est médiatisé, et qu'il intéresse beaucoup nos associations de patients. Mais il n'y a rien sur le plan scientifique », ajoute le Pr Gottrand.
Ici on voit à l’œuvre plusieurs mécanismes fréquents de perturbation de la transmission de l’information scientifique. D’abord, l’absence de distinction entre un avis juridique ou administratif et une démonstration scientifique. Une décision de justice ne peut jamais être considérée comme une preuve de l’existence d’un lien, tant les enjeux judiciaires sont éloignés des enjeux scientifiques.
Par ailleurs, qu’une famille désespérée cherche à trouver une explication à sa souffrance est parfaitement compréhensible, voire légitime, mais cela une fois encore ne saurait constituer une base sérieuse pour établir une corrélation scientifique. L’appel à l’émotion doit toujours être perçu comme un piège dont il faut se méfier.
Quand les anti-glyphosates utilisent les études des industriels
A ces procédés rhétoriques, s’ajoute le traditionnel discrédit des sources, qu’il s’agisse des agences de régulation ou des journalistes et/ou scientifiques en raison de leurs potentiels liens d’intérêt. Concernant la première tactique très habituelle, l’Association française pour l’information scientifique (AFIS) relève dans un communiqué récent l’opportun oubli à propos des études sur lesquelles se base le CIRC, rare instance internationale à avoir considéré le glyphosate comme cancérigène probable. « Les nombreuses agences sanitaires qui se sont penchées sur la question concluent, en tenant compte de l’exposition dans les situations normales d’utilisation, à une absence de risque significatif. Par ailleurs, elles ne partagent pas la conclusion à laquelle arrive le Circ.
Ces agences sont alors toutes accusées d’être le relais des « lobbies agro-alimentaires » et d’ignorer la littérature académique pour ne prendre en compte que les résultats des industriels. Cela ne correspond pas à la réalité. Au niveau européen, mais également dans de nombreux pays en dehors de l’Union européenne, le dossier d’homologation ou de réhomologation comprend toutes les études pertinentes, et donc également les études publiées émanant de laboratoires indépendants.
De son côté, contrairement à la fable propagée par certains, le CIRC s’appuie aussi largement sur les études industrielles. Ainsi, fait rarement rappelé dans la controverse, l’évaluation du CIRC sur la cancérogénicité animale du glyphosate repose sur l’analyse des données de sept études de long terme (sur des rats et des souris) dont six sont des études réglementaires commanditées par les industriels (Monsanto, Cheminova et Syngenta).
Pour l’étude restante, publiée dans une revue scientifique, le CIRC conclut qu’« aucune augmentation significative de l’incidence des tumeurs n’a été observée dans aucun des groupes traités ». Tous les indices retenus par le CIRC pour conclure à la cancérogénicité du glyphosate pour les animaux provenaient donc d’études industrielles. Cette conclusion sur la cancérogénicité animale, qu’aucune autre institution scientifique ne retient à ce jour, a joué un rôle crucial dans la décision finale du CIRC de classer le glyphosate « cancérogène probable », car il jugeait que les preuves épidémiologiques de cancérogénicité du glyphosate pour l’Homme étaient « limitées ». L’opposition « science réglementaire » qui ne se s’appuierait que sur les études produites par les industriels contre « littérature scientifique évaluée par les pairs » est donc une construction partisane complaisamment médiatisée, mais sans fondement », décrypte l’AFIS.
« Blanchiment de bullshit »
La discréditation des personnalités peut pour sa part aller très loin. Outre les procédures baillons comme celle qui a tenté en vain de faire taire Géraldine Woessner, d’autres méthodes peuvent être employées comme la réécriture des notices Wikipedia. Pour cet exercice, il est intéressant de noter que certains articles « militants » trouvés dans la presse généraliste peuvent être utilisés (sans doute indépendamment de la volonté de leurs auteurs) pour étayer certaines informations trompeuses.
Concernant par exemple le journaliste Mac Lesgy, Alexandre Baumann (spécialiste du référencement internet) montre comment pour conforter une présentation à charge du travail de ce dernier sont cités à l’appui des papiers de la presse grand public (Libération, Huffington Post…) où les prises de position de Mac Lesgy non conformes à une certaine doxa (par exemple sur le glyphosate) sont notamment critiquées. Ainsi, Alexandre Baumann conclut : « On observe ici l'importance des journaux militants et des scientifiques militants pour promouvoir la désinformation par une sorte de "blanchissement" de bullshit. C'est toute la puissance de la dimension organisationnelle de la pseudo-écologie : tout le monde peut participer ».
Conséquences démocratiques
S’il ne s’agissait que du glyphosate, dont certains travaux scientifiques pourraient finalement justifier son retrait ou une plus grande restriction d’utilisation, tout ceci serait sans réelle importance. Cependant, ce n’est qu’une illustration de la façon dont, sans doute facilité par un défaut d’esprit critique et de culture scientifique, l’information scientifique est régulièrement détournée à des fins idéologiques et militantes. Les conséquences peuvent être nombreuses. Politiques, bien sûr, comme le montrent les tergiversations des instances publiques concernant l’autorisation ou non du glyphosate.
Mais également stricto-sensu scientifiques : Géraldine Woessner et d’autres ont rappelé comment le brouillage médiatique permanent autour du glyphosate ou des OGM a eu une influence très claire sur la recherche française, qui aujourd’hui s’est peu à peu détournée des organismes génétiquement modifiés. Enfin, démocratiques, car cette information biaisée ne peut qu’engendrer des réflexes de défiance au sein de la population.
On relira :
L’Association française pour l’information scientifique (AFIS)
Aurélie Haroche




