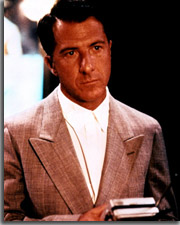
Anne PHILIPPE,
INSERM U781, Hôpital Necker-Enfants Malades,
Service de Pédopsychiatrie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris
En 1943, Léo Kanner (1894-1981) décrit des enfants qui «
sont venus au monde avec une incapacité innée de constituer
biologiquement le contact affectif normal avec les personnes, tout
comme d’autres enfants viennent au monde avec des handicaps
physiques ou intellectuels innés ». Il dénomme cette nouvelle
entité clinique : l’autisme infantile précoce. Par la suite, il y a
eu au sujet de l’origine de cette pathologie bien des débats,
souvent idéologiques plus que scientifiques.
Dans les années 1980-90, les études de jumeaux ont apporté des
arguments en faveur de facteurs génétiques. L’identification
progressive de cas, où le syndrome autistique est associé à des
pathologies connues (sclérose tubéreuse de Bourneville, syndrome de
l’X fragile, rubéole congénitale…), a fait renoncer à la conception
d’une entité clinique ayant une étiologie unique.
Une grande hétérogénéité
L’évolution des techniques d’analyse du génome (cartographie
avec des marqueurs polymorphiques [SNP] à haute densité, séquençage
systématique des gènes situés sur le chromosome X…) n’a fait que
confirmer l’hétérogénéité génétique en permettant d’identifier des
mutations dans de nombreux gènes, chacune d’elles n’étant
retrouvées que dans un très petit nombre de familles à chaque fois.
De plus, ces gènes ne sont pas impliqués dans une voie métabolique
commune, mais interviennent aussi bien dans la formation des
synapses (neuroligines ou SHANK3) que dans le transport des
protéines membranaires (AP1S2), ou encore dans les voies de
synthèse de la créatine, des purines (déficit en adénylosuccinate
lyase) ou de la dégradation du GABA (déficit en succinique
semialdéhyde déshydrogenase), etc.
De même, l’hybridation génomique comparative sur puce à ADN
(CGH-array), avec un seuil de résolution 50 à 100 fois supérieur à
celui du caryotype, constitue un nouvel outil très performant
permettant de découvrir des anomalies chromosomiques cryptiques
dans 15 à 20 % des cas d’autisme, tout particulièrement lorsque le
syndrome autistique est associé à d’autres symptômes comme un
trouble de la croissance staturo-pondérale, une dysmorphie faciale
ou des anomalies des extrémités. Là encore, les anomalies
chromosomiques retrouvées (duplication, délétion, inversion) se
caractérisent par une importante diversité quant à la région
chromosomique touchée. Parmi les plus fréquentes, on trouve la
duplication interstitielle du chromosome 15q11-q13 (1 %) survenant
de novo ou héritée qui doit être recherchée de façon systématique
en raison de l’absence de tableau clinique évocateur.
Parmi les tératogènes qui modifient de façon épigénétique
l’expression de gènes impliqués dans le développement du système
nerveux central, il a été récemment recommandé d’éviter la prise de
valproate chez les femmes enceintes du fait de plusieurs cas
d’autisme ou de syndrome d’Asperger rapportés chez les fœtus
exposés in utero.
De l’intérêt de la consultation en génétique
Aujourd’hui, la consultation en génétique devrait faire partie du bilan de tout enfant présentant un trouble appartenant au spectre autistique. Dans 15 à 20 % des cas, elle permet de retrouver l’origine de ce trouble. Le diagnostic étiologique est important sur le plan individuel, car il permet pour les familles concernées de mieux se représenter ce qui s’est passé, de proposer un conseil génétique et, dans quelques cas exceptionnels, de disposer d’un traitement spécifique (déficit en créatine, par exemple).




