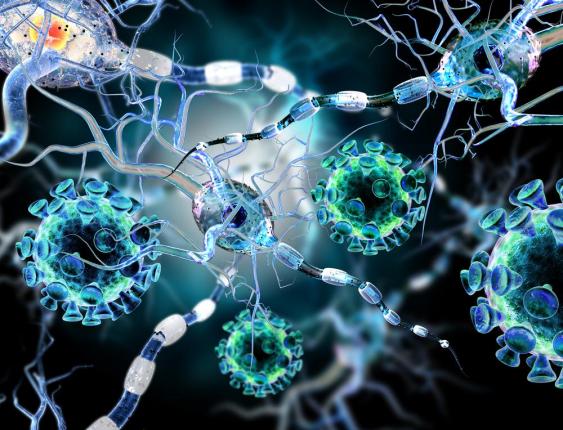
« Nous décrivons le premier traitement pour la sclérose en plaques qui stoppe complètement toute activité inflammatoire du système nerveux central pour une longue période en absence de médicaments modificateurs de la maladie ». C’est par cette phrase que Harold Atkins débute la discussion d’un article qui va sans doute marquer une étape dans l’histoire de la neurologie.
Depuis 3 décennies, la recherche thérapeutique dans la sclérose en plaques (SEP) a été très productive. Dans les années 80, les interférons, premiers immunomodulateurs, ont été la première étape de l’ère thérapeutique de la SEP. Dans les années 2000 avec le natalizumab, la rémission est devenue un objectif réel. Depuis 5 ans, nous pouvons proposer des traitements de première ligne efficaces par voie orale. La prochaine décennie sera-t-elle celle de la guérison? Le terme n’est pas employé dans la publication du Lancet mais l’observation d’un arrêt de toute activité inflammatoire n’en suscite pas moins un grand espoir.
Les auteurs rapportent ainsi les données de suivi d’un traitement par autogreffe réalisé chez des patients avec des formes très agressives de la maladie. Il s’agit d’une étude multicentrique sans placebo conduite entre 2001 et 2009. Les patients avaient 34 ans en moyenne et une SEP moyennement sévère EDSS (Expanded Disability Status Scale) 3 à 6 (capables de marcher sans canne) avec une durée d’évolution rapide sur 6,1 ans ; 50 % étaient des formes rémittentes et 50 % secondairement progressives ; 42 % n’avaient eu qu’un seul traitement et les autres deux ou trois traitements ; 29 % avaient reçu auparavant de la mitoxantrone.
Plus de progression chez 70 % des patients
Le protocole était complexe associant une sélection des cellules souches CD34, une immunoablation puis une autogreffe. Des événements fébriles ont touché 67 % des patients pendant la mobilisation des cellules souches hématopoïétiques. Un patient est décédé d’une nécrose hépatique associée à une septicémie par Klebsiella sous busulphan. Les résultats présentés correspondent à un suivi médian de 6,7 ans. Trente-cinq pour cent des patients ont eu une amélioration de leur état neurologique (score EDSS). L’activité inflammatoire quantifiée par IRM et clinique (nombre de poussées) était nulle chez les 23 patients suivis alors que dans la période précédant l’inclusion, il avait été noté 188 prises de gadolinium sur 48 IRM et 167 poussées sur une période cumulée de 140 années patients (1,2 poussées par an)!
Ces résultats spectaculaires ont été comparés à ceux rapportés
dans d’autres études avec autogreffe ou sous traitement par
alemtuzumab. La mortalité est similaire (4 %) et les résultats de
l’étude canadienne sont meilleurs. Les auteurs suggèrent que
ceux-ci sont en rapport avec la qualité de l’immunosélection.
Sous alemtuzumab, il persiste chez 35 % de patients des poussées
après 2 ans de traitement. Les auteurs concluent donc que la
maladie n’a plus progressé chez 70 % des patients. Ils tempèrent
leur résultat en rappelant l’absence de groupe contrôle mais
considèrent que cette approche thérapeutique est une option pour
les formes les plus agressives. Jan Dorr (Berlin) précise dans
l’éditorial du journal que cette thérapeutique ne doit être
pratiquée que par des équipes expérimentées afin d’éviter ce qu’il
appelle le « Tourisme Cellules Souches. »
Dr Christian Geny




