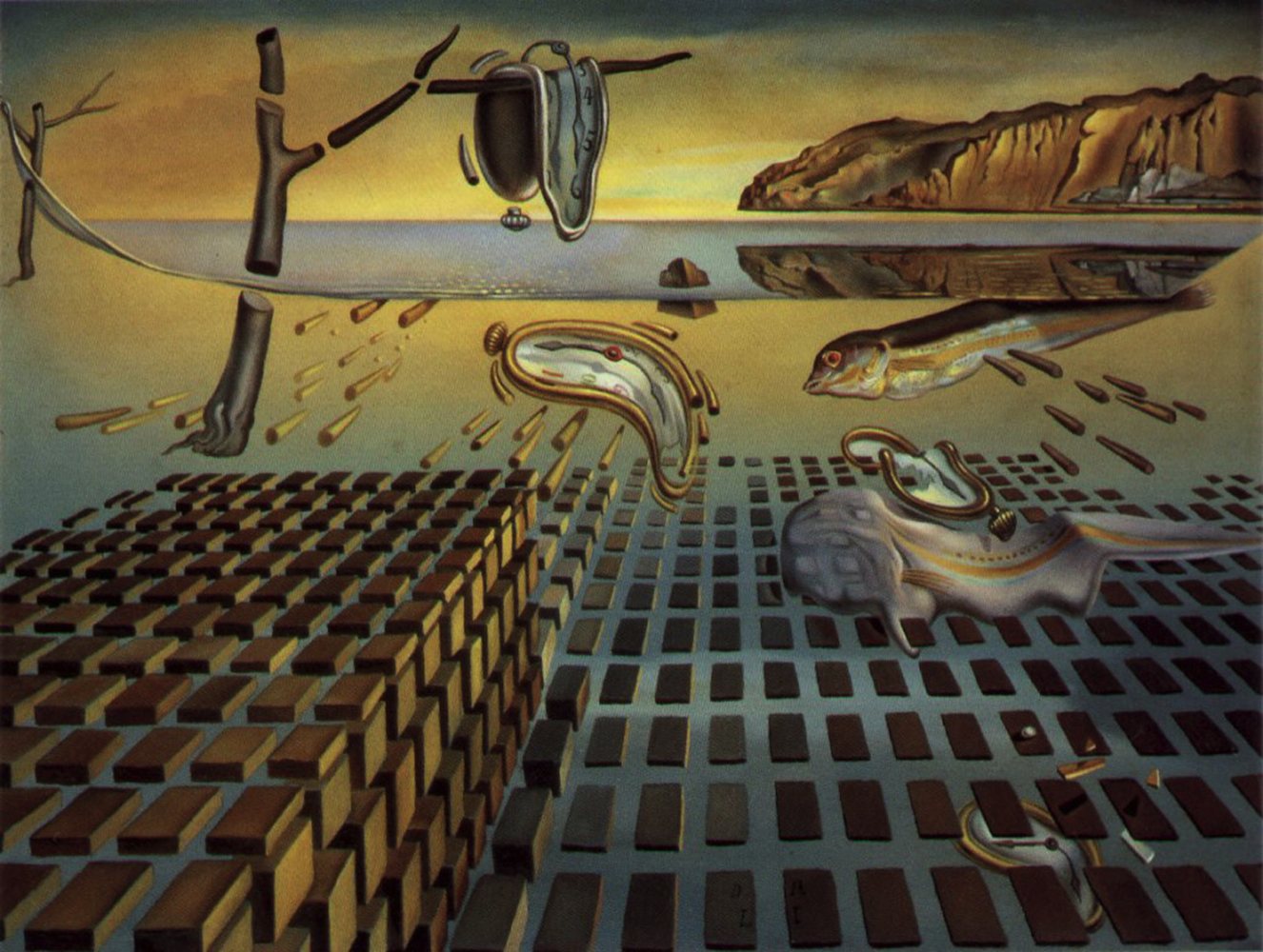
Souviens-toi de 69
Néanmoins, parallèlement à cette conviction forte régulièrement
exprimée du caractère imprévisible de cette pandémie, en raison de
notre habitude d’analyser le présent en utilisant les enseignements
du passé, beaucoup ont rappelé y compris dans ces colonnes que de
précédentes épidémies au cours du siècle dernier avaient pu
entraîner d’importantes surmortalités et un dépassement des
capacités de soins. Satisfaisantes pour l’esprit, et permettant de
mesurer combien nous vivons un éternel recommencement, ces
comparaisons pourraient cependant ne pas être totalement
suffisantes pour convaincre que la situation actuelle aurait pu
être mieux préparée, tant les évolutions ont été nombreuses.Des fléaux réguliers
Pourtant, même l’histoire très récente comptait des éléments
révélateurs de quelques-uns des points clés de la crise actuelle,
notamment concernant les capacités des hôpitaux. Il suffisait ainsi
de se pencher sur le récit des épidémies de grippe du siècle actuel
pour préjuger que les hôpitaux français pourraient être rapidement
dépassés par une crise plus grave. « Depuis mi 2013, les grippes
saisonnières de l’hiver 2013/2014, et dans une moindre mesure
celles de l’hiver 2015/2016 comme celle de l’hiver en cours ont eu
peu d’impact sur la mortalité. C’est loin d’être le cas pour les
quatre autres hivers de la période, à commencer par ceux des trois
dernières années : sur les premiers mois de 2019, Santé publique
France a observé un « excès de mortalité », toutes causes
confondues, de 12 000 environ au cours de l’épidémie de grippe, à
comparer à celui observé en 2016-2017 (21 000 environ) et 2017-2018
(18 000 environ). En croisant ces données d’état civil avec celles
qui remontent du système de soins (médecins et hôpitaux du réseau «
sentinelle »), Santé publique France produit une estimation du
nombre de décès qui peut être attribué en première intention à la
grippe, et qui représente environ 70 % de cet « excès de
mortalité ». La grippe n’est en effet pas la seule épidémie
hivernale, et une modélisation est nécessaire : elle est permise
par l’observation répétée, sur de nombreuses années, de la
succession d’épidémies de grippe et de gastro-entérite notamment »
analyse l’INSEE dans une note récente publiée sur son blog (qui
invite donc par ailleurs à ne pas précipiter les interprétations
concernant la mise en évidence de surmortalités).Les années se suivent…
Ces surmortalités ont quasiment systématiquement coïncidé avec
quelques semaines particulièrement difficiles pour les
établissements hospitaliers. Ainsi, nous écrivions dans nos
colonnes le 13 janvier 2017 : « "Les très équipés hôpitaux
français ont été débordés par des dizaines de patients, fiévreux et
toussant, redoutant d’être atteints par la grippe et parfois (mais
pas toujours) victimes de graves complications. Une situation
imprévisible ? Sans doute pas ! ". C’est ainsi que nous débutions
il y a deux ans un article sur l’épidémie de grippe qui frappait la
France. Les papiers consacrés à la crise par le JIM et la presse en
général décrivaient en effet une situation proche de celle que nous
vivons aujourd’hui. Aucune leçon n’a donc été apprise depuis deux
ans ou depuis la canicule de 2003 ? Les scénarios apparaissent très
similaires. D’abord, comme il y a treize ans, il semble que les
services des pompes funèbres apportent sur l’ampleur de la
situation des informations plus pertinentes que les (lénifiants)
rapports des organes de veille sanitaire. Ainsi, selon le réseau de
surveillance Sentinelles-INSERM, 784 000 personnes ont consulté un
médecin pour une grippe au cours des quatre dernières semaines et
depuis le 1er novembre, 52 personnes admises pour une infection
grippale sont mortes en réanimation. Mais le bilan, beaucoup le
savent déjà, sera bien plus lourd. Et pour s’en persuader, il
suffit d’interroger les réseaux des pompes funèbres. Partout les
agences évoquent une activité en forte hausse par rapport à l’année
dernière », relevait-on dans un texte permettant non seulement
de deviner l’impact de l’épidémie de 2017-2018 mais également celle
de 2015-2016.Plan blanc
Outre les signalements tragiques des pompes funèbres, ces épidémies
de grippe meurtrières conduisaient souvent à des réorganisations
temporaires des établissements hospitaliers. Ainsi constatait-on en
2015 : « A Strasbourg où l'activité des Samu a augmenté de 80 %,
comme à Besançon, Belfort, Avignon, Toulon, Mulhouse, Toulouse,
Rennes, Bordeaux ou encore Rouen, l'engorgement des cabinets des
omnipraticiens et bientôt des hôpitaux a entraîné le déclenchement
de l'alerte sanitaire (…). Si la vigilance des Agences régionales
de l'hospitalisation (ARH) et de la Direction départementale des
affaires sanitaires et sociales (DDASS) est de rigueur sur
l'ensemble du territoire, l'accent est surtout mis en Alsace,
Auvergne, Ile-de-France, dans le Nord-Pas-de-Calais, en Provence
Alpes Côte d'Azur (PACA) et dans la région Rhône-Alpes où une «
situation très tendue » a été observée. Ces six régions bénéficient
depuis hier du déclenchement du plan blanc qui prévoit
l'augmentation du nombre de lits mais aussi un renforcement des
moyens matériels et humains. La mise à disposition de nouveaux lits
est rendue possible par la déprogrammation des admissions non
urgentes. Il s'agit en outre de rappeler le personnel disponible ou
de transférer les professionnels de santé exerçant dans d'autres
services. Parallèlement à ce plan blanc, un « plan bleu », qui
concerne les maisons de retraite et qui prévoit notamment une
collaboration active entre les établissements d'hébergement et les
services hospitaliers en cas de crise, pourrait être déclenché si
la situation l'exigeait, comme l'a indiqué le secrétaire d'Etat aux
Personnes âgées, Catherine Vautrin ». Ainsi, la dynamique qui a
été déployée au début du mois de mars 2020 s’était-elle déjà
imposée (à une échelle réduite) les hivers précédents, il est vrai
pour des périodes beaucoup plus courtes.Des malades refusés en réanimation
Le déclenchement du plan blanc était rendu nécessaire le plus
souvent par l’engorgement des services d’urgences, mais également
des unités de réanimation. « "Il y a des gros soucis dans les
services de réanimation qui ont refusé un grand nombre de patients
le week-end dernier", a déclaré le secrétaire du Mouvement de
défense de l’hôpital public, Bernard Granger, en citant les
hôpitaux de Bicêtre (le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne), Cochin
(Paris VIe) et Louis-Mourier (Colombes, Hauts-de-Seine). Cette
saturation est la conséquence des épidémies de grippe et de
pneumonie qui sévissent actuellement, selon Bernard Granger. Le
patron de la réanimation de Bicêtre, le professeur Christian
Richard, confirme cette "tension". "En hiver, la demande est
toujours très forte et elle s'est accentuée ces derniers jours.
Nous avons effectivement refusé certains malades pour lesquels le
Samu a dû trouver une autre solution" » signalait par exemple
Le Parisien le 12 janvier 2011. Ces situations de crise (présentées
dans les journaux d’une façon assez proche de la crise
d’aujourd’hui, avec les mots « hécatombes » ou «
catastrophes » et la mise en avant de cartes rougies par les
surmortalités pressenties) perdurant quelques semaines tout au
plus, étaient toujours l’occasion pour les syndicats de se désoler
que des épidémies saisonnières, parfaitement prévisibles, mettent
tant à mal nos services hospitaliers. Les suppressions de lits
étaient ainsi régulièrement dénoncées. Marie-Georges Fayn revenait
le 30 janvier 2017 dans sa revue de presse préparée pour le site
Réseau CHU : « "Pourquoi un banal virus grippe les hôpitaux ?"
questionne les Dernières Nouvelles d’Alsace. L'épidémie de grippe
dévoile-t-elle un système de santé défaillant ? interroge Arte.
Dans un communiqué en date du 12 janvier, la Fédération
hospitalière de France a déploré le défaut d'anticipation du
gouvernement qui n'a pris conscience de l'ampleur de la situation
que cette semaine. Selon la FHF, cette situation est une
conséquence des "limites de la politique de suppression de lits et
d'économies au rabot". Et l’instance de plaider pour « une
politique de santé basée sur des réformes structurelles qui
soutiennent les hôpitaux publics dans leurs missions"» et
concluait plus loin : « Pour faire face à l’afflux de patients,
les hôpitaux ont mobilisé toutes leurs ressources et expliqué leurs
nouvelles organisations dans des communiqués ou lors de points
presse. Ils ont notamment réuni des cellules de crise
quotidiennement, ouvert des unités temporaires, transformé des lits
de chirurgie en lits de médecine avec des spécialistes médicaux
allant au chevet des patients, installé un deuxième lit dans
certaines chambres à 1 lit. Dans un communiqué le CHU de
Montpellier dispensait les règles de base pour limiter la
propagation d’un virus très contagieux (se laver les mains très
régulièrement, limiter les contacts directs, éviter les lieux
fréquentés, éternuer et tousser en se couvrant la bouche, porter un
masque si nécessaire) ». Ainsi, on le voit, et cela n’est guère
une surprise, les recommandations de l’observation des mesures
barrières et du port du masque faisaient partie de l’exégèse
habituelle des épidémies d’hier.Des structures modulaires ?
La lecture de ces "archives" rappelle également que de nombreuses
pistes d’amélioration étaient suggérées. Le médecin et journaliste
Jean-Daniel Flaysakier proposait par exemple sur son blog à
l’approche des épidémies hivernales la mise en place de structures
« provisoires modulaires » permettant d’accueillir plusieurs
lits et qui pourraient être gérées par des médecins ayant récemment
cessé leur activité et des jeunes praticiens venant d’achever leur
internat et pas encore installés. « Evidemment mobiliser à
l’avance a un coût. Mais gérer la pénurie de lits et de médecins,
devoir rouvrir en catastrophe des services, annuler des
interventions tout cela a aussi un coût » concluait-il.Explosion imprévisible en réanimation
Entendre de façon sérieuse ces alertes n’aurait probablement pas
été suffisant pour éviter les mesures drastiques mises en œuvre
aujourd’hui, tel que le confinement, notamment parce qu’une
différence majeure existe entre les épidémies meurtrières de grippe
des années précédentes et l’épidémie de Covid-19 : l’afflux de
patients en réanimation considérablement plus élevé. Ainsi, selon
les données de Santé publique France, jusqu’au 31 mars, 8 318
personnes infectées par SARS-CoV-2 ont été admises en réanimation,
quand les épidémies de grippe de 2012 à 2017 ont conduit entre 1099
et 2465 personnes en réanimation. Cette différence importante
suggère qu’une meilleure préparation des établissements
hospitaliers n’aurait peut-être pas permis d’éviter certaines des
conséquences de la crise actuelle. Néanmoins, et alors qu’un
rapport de l’OCDE semble établir une corrélation claire entre le
nombre de lits par habitant et la résistance à l’épidémie (avec
pour critère le nombre de décès), on mesure combien les alertes au
cours des épisodes grippaux de ces dernières années auraient mérité
d’être entendues, ne serait-ce que pour offrir aux équipes
hospitalières de meilleures conditions de combat.Alors qu’on ne cesse aujourd’hui de gloser sur le monde d’après, il apparaît important de ne pas oublier les leçons du monde d’avant.
On pourra relire :
Le blog de l’INSERM :
https://blog.insee.fr/mourir-de-la-grippe-ou-du-coronavirus-faire-parler-les-chiffres-de-deces-publies-par-linsee-avec-discernement/
Les articles du JIM : « Grippe 2016/2017 : vers une
catastrophe sanitaire ? »
https://www.jim.fr/e-docs/grippe_2016_2017_vers_une_catastrophe_sanitaire__163232/document_actu_pro.phtml
et Déclenchement du plan blanc : le dispositif d'alerte n'est pas
grippé
https://www.jim.fr/medecin/pratique/recherche/e-docs/declenchement_du_plan_blanc_le_dispositif_d_alerte_n_est_pas_grippe_21845/document_actu_pro.phtml
L’article du Parisien du 12 janvier 2011 :
http://www.leparisien.fr/economie/des-patients-refuses-en-reanimation-12-01-2011-1223522.php
Le bilan des épidémies de grippe de 2012 à 2017 par Santé publique France : https://blog.insee.fr/mourir-de-la-grippe-ou-du-coronavirus-faire-parler-les-chiffres-de-deces-publies-par-linsee-avec-discernement/
Aurélie Haroche




