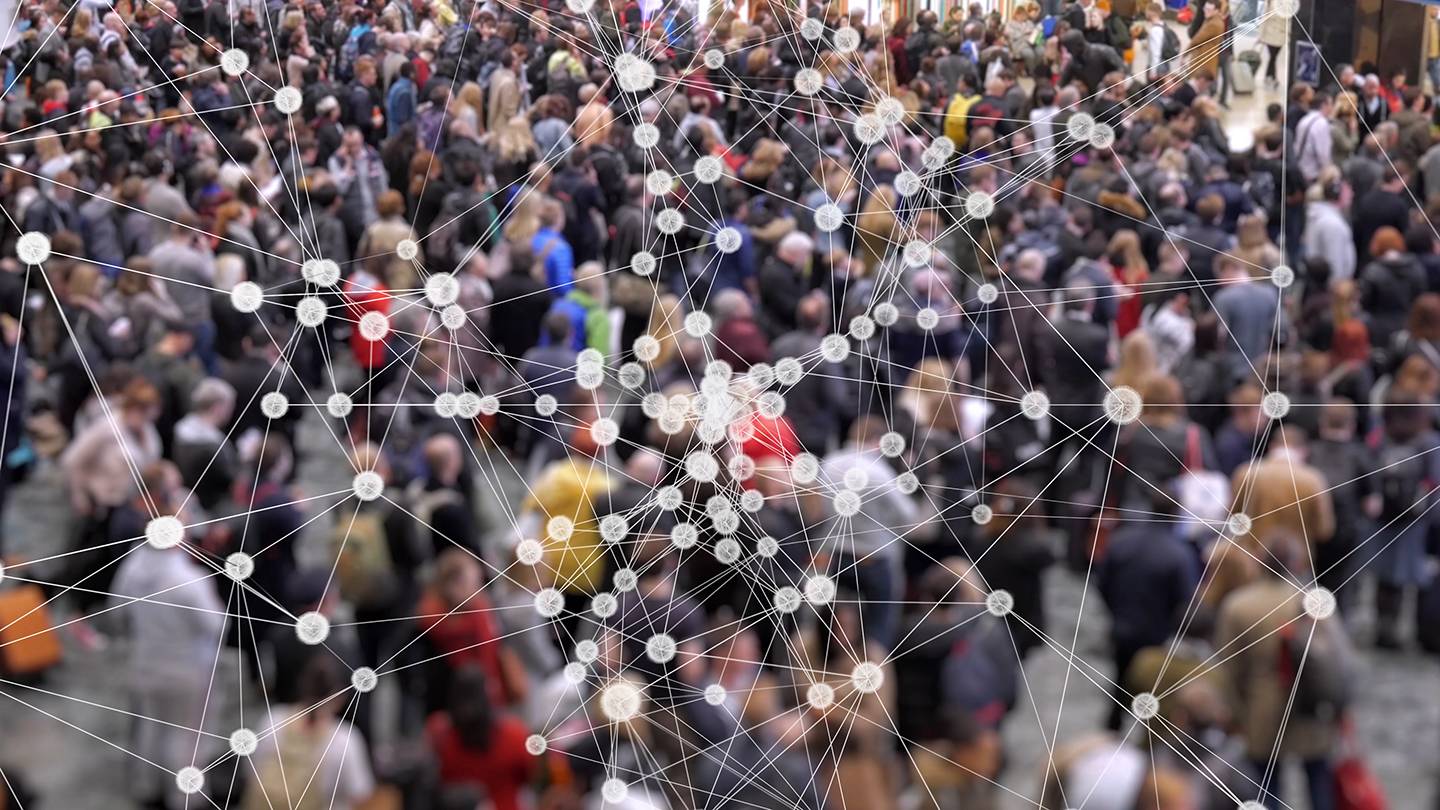
Une question clé dans la pandémie de COVID-19 est de savoir
comment et quand l'immunité collective peut être obtenue et à quel
prix.
L'immunité de horde ou immunité collective est un concept clé pour
le contrôle des épidémies. Il stipule que seule une partie de la
population doit être immunisée (en surmontant une infection
naturelle ou par la vaccination) contre un agent infectieux pour
que celui-ci cesse de générer de grandes épidémies.
Dans les coulisses de la modélisation mathématique
L'immunité collective est obtenue lorsqu'une personne infectée génère en moyenne moins d'un cas secondaire, ce qui correspond à un nombre de reproduction effectif R (c'est-à-dire le nombre moyen de personnes infectées par un cas) inférieur à 1 en l'absence d'intervention. Au sein d’une population dans laquelle les individus se mélangent de manière homogène et sont également sensibles et contagieux, R = (1 − pC)(1 − pI)R0 (équation 1), où pC est la réduction relative des taux de transmission due aux interventions non pharmaceutiques ; pI est la proportion d'individus immunisés ; et R0 est le taux de reproduction en l'absence de mesures de contrôle dans une population totalement sensible.
Le R0 peut varier selon les populations et dans le temps, en fonction de la nature et du nombre de contacts entre les individus et de facteurs environnementaux. En l'absence de mesures de contrôle (pC = 0), l’immunité collective (R < 1, où R = (1 − pI)R0) est donc atteinte lorsque la proportion d'individus immunisés atteint pI = 1 – 1/R0.
Hypothèse haute : un taux nécessaire d’immunité de la population de 67 % en France
Pour ce qui concerne le SRAS-CoV-2, la plupart des estimations de R0 se situent dans la fourchette 2,5 - 4, sans qu'il y ait de schéma géographique clair. Pour R0 = 3, tel qu'estimé pour la France, le seuil d'immunité collective pour le SRAS-CoV-2 devrait donc exiger un taux d’immunité de la population de 67 %.
Il découle également de l'équation 1 qu'en l'absence d'immunité collective, l'intensité des mesures de distanciation sociale nécessaires pour contrôler la transmission diminue à mesure que l'immunité de la population augmente. Par exemple, pour contenir la propagation pour R0 = 3, les taux de transmission doivent être réduits de 67 % si la population est totalement sensible, mais de seulement 50 % si un tiers de la population est déjà immunisé.
Toutefois, il existe des situations au cours desquelles l'immunité collective pourrait être obtenue avant que l'immunité de la population n'atteigne pI = 1 − 1/R0. Par exemple, si certains individus sont plus susceptibles d'être infectés et de transmettre parce qu'ils ont plus de contacts, ces super-diffuseurs seront probablement infectés en premier.
En conséquence, la population des individus sensibles est rapidement diminuée par ces super- diffuseurs et le rythme de transmission ralentit. Toutefois, il reste difficile de quantifier l'impact de ce phénomène dans le contexte de Covid-19. Pour R0 = 3, Britton et al. ont montré que, si l'on tient compte des schémas de contact par âge (par exemple, les individus âgés de plus de 80 ans ont beaucoup moins de contacts que ceux âgés de 20 à 40 ans), le seuil d'immunité collective passe de 66,7 % à 62,5 %.
Hypothèse basse : un taux nécessaire d’immunité de la population de 50 % en France
Si nous supposons en outre que le nombre de contacts varie considérablement entre les individus d'une même tranche d'âge, l'immunité collective pourrait être obtenue avec seulement 50 % d'immunité de population. Toutefois, dans ce scénario, l'écart par rapport à la formule pI = 1 − 1/R0 n'est prévu que si c'est toujours le même ensemble d'individus qui sont des super-diffuseurs potentiels. Si la super-diffusion est générée par des événements plutôt que par des individus, ou si les mesures de contrôle réduisent ou modifient l'ensemble des super-diffuseurs potentiels, l'impact sur l'immunité collective pourrait être limité. Le rôle des enfants dans la transmission virale est un autre facteur qui peut contribuer à abaisser le seuil d'immunité collective pour la Covid-19. Des études montrent que les enfants, en particulier ceux de moins de 10 ans, peuvent être moins sensibles et moins contagieux que les adultes, auquel cas ils peuvent être partiellement omis du calcul de l'immunité collective.
La limite des enquêtes sérologiques
L'immunité de la population est généralement estimée par des enquêtes sérologiques transversales qui mesurent l'immunité humorale, sur des échantillons représentatifs. Les enquêtes réalisées dans les pays touchés au début de l'épidémie de Covid-19, tels que l'Espagne et l'Italie, suggèrent que la prévalence nationale des anticorps varie entre 1 et 10 %, avec des pics autour de 10-15 % dans les zones urbaines fortement touchées. Ces données correspondent aux modélisations mathématiques antérieures, basées sur le nombre de décès rapporté dans les statistiques nationales et les estimations du taux de mortalité lié à l'infection, c'est-à-dire la probabilité de décès compte tenu de l'infection.
Certains ont fait justement valoir que l'immunité humorale ne couvre pas tout le spectre de l'immunité protectrice contre le SRAS-CoV-2 et que la première vague épidémique a entraîné des niveaux d'immunité plus élevés dans la population que ceux mesurés par les enquêtes transversales sur les anticorps.
En effet, la réactivité des lymphocytes T a été documentée en l'absence d'immunité humorale chez les contacts des patients, bien que la nature protectrice et la durée de la réponse observée soient inconnues.
Des doutes sur l’immunité croisée : l’affaire du porte-avions Charles de Gaulle
Nous ignorons également si une immunité préexistante aux coronavirus du rhume peut offrir un certain niveau de protection croisée. Plusieurs études ont fait état de cellules T à réaction croisée chez 20 à 50 % des personnes n'ayant jamais contracté le SARS-CoV-2. Toutefois, il reste à déterminer si ces cellules T peuvent prévenir l'infection par le SARS-CoV-2 ou protéger contre une forme grave. Les rapports préliminaires des enquêtes menées auprès des enfants ne montrent aucune corrélation entre les antécédents d’infections par des coronavirus saisonniers et la sensibilité à l'infection par le CoV-2 du SRAS. Il est évident qu'aucune immunité par protection croisée n'a été mise en évidence lors de l'épidémie de SARS-CoV-2 sur le porte-avions Charles de Gaulle où 70 % des jeunes marins adultes ont été infectés avant que l'épidémie ne s'arrête.
Pas de certitudes que la propagation du SARS-CoV-2 pourrait s'arrêter naturellement avant qu'au moins 50 % de la population ne soit immunisée
Compte tenu de ces considérations, il n'y a guère de preuves que la propagation du SARS-CoV-2 pourrait s'arrêter naturellement avant qu'au moins 50 % de la population ne soit immunisée. Une autre question est de savoir comment atteindre une immunité de 50 % de la population, étant donné que nous ignorons actuellement combien dure l'immunité acquise naturellement contre le SARS-CoV-2 (l'immunité contre les coronavirus saisonniers est généralement relativement courte), en particulier chez ceux qui ont présenté des formes légères de la maladie, et s'il pourrait falloir plusieurs cycles de réinfection avant d'atteindre une immunité robuste.
Incertitudes concernant la robustesse et la longévité de l’immunité
À ce jour, la réinfection n'a été documentée de manière concluante que dans un nombre très limité de cas et il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un phénomène rare ou qui puisse devenir courant. De même, on ne sait comment une infection antérieure affecterait l'évolution de la maladie lors d'une réinfection, ni si un certain niveau d'immunité préexistante affecterait l'excrétion et la transmissibilité du virus.
Lors des pandémie grippales, l'immunité collective est généralement atteinte après deux ou trois vagues épidémiques, chacune étant interrompue par la saisonnalité typique du virus de la grippe et plus rarement par des interventions, avec l'aide d'une protection croisée conférée l'immunité vis à vis des virus de la grippe déjà rencontrés et de vaccins lorsqu'ils sont disponibles. Pour la Covid-19, dont le taux de mortalité par infection est estimé à 0,3-1,3 %, le « coût » de l'immunité collective par infection naturelle serait très élevé, surtout en l'absence d'une meilleure prise en charge des patients et sans protection optimale des personnes exposées à de graves complications.
100 000 - 450 000 décès en France si on « laisse faire »
En supposant un seuil d'immunité collective optimiste de 50 %, pour des pays comme la France et les États-Unis, cela se traduirait respectivement par 100 000 - 450 000 et 500 000 -2 100 000 décès. Les hommes, les personnes âgées et celles souffrant de comorbidités sont touchés de manière disproportionnée, avec un taux de mortalité par infection de 3,3 % pour les personnes de plus de 60 ans et une mortalité accrue chez les personnes souffrant de diabète, de maladies cardiaques, de maladies respiratoires chroniques ou d'obésité. L'impact attendu serait nettement plus faible dans les populations plus jeunes.
Des vaccins moins efficaces chez les seniors ?
En outre, il est possible d'éviter des décès en ciblant d'abord les populations très vulnérables, bien que l'on s'attende à ce que les vaccins ne soient pas aussi efficaces chez les seniors que chez les juniors (comme les vaccins contre la grippe). Les vaccins peuvent donc avoir un impact beaucoup plus important sur la réduction de la circulation virale que l'immunité acquise naturellement, surtout s'il s'avère que l'immunité protectrice acquise naturellement nécessite des renforts par des réinfections (si nécessaire, les vaccins peuvent être systématiquement renforcés).
De plus, étant donné qu'un nombre croissant de complications à long terme sont signalées, même après une COVID-19 légère, les vaccins sont susceptibles d'offrir une option plus sûre aux personnes qui ne sont pas classées à risque.
L’hiver va être chaud
Pour les pays de l'hémisphère nord, l'automne et l'hiver à venir seront compliqués avec l'intensification probable de la circulation virale, comme on l'a récemment observé avec le retour de la saison froide dans l'hémisphère sud. À ce stade, seules les interventions non pharmaceutiques, telles que l'éloignement social, l'isolement des patients, les masques faciaux et l'hygiène des mains, se sont avérées efficaces pour contrôler la circulation du virus et doivent donc être strictement appliquées.
D’éventuels médicaments antiviraux qui réduisent la charge virale et diminuent ainsi la transmission, ou des traitements qui préviennent les complications et les décès, pourraient jouer un rôle majeur pour le contrôle de la pandémie au cours des mois à venir. Ceci jusqu'à ce que des vaccins soient disponibles, ce qui nous permettrait d'atteindre l'immunité collective de la manière la plus sûre possible.
Dr Bernard-Alex Gaüzère




