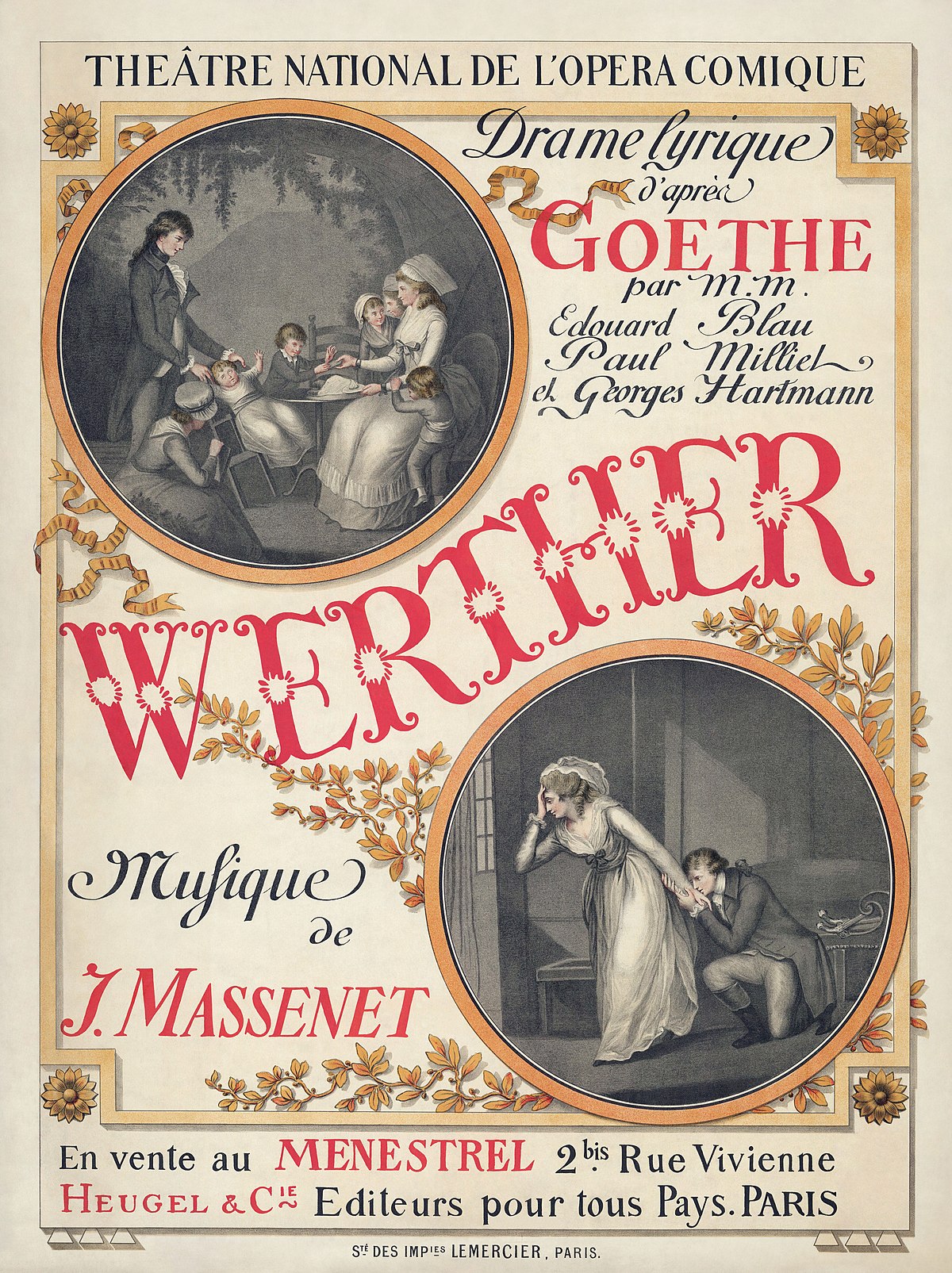
Paris, le mercredi 25 novembre 2020 – La mort brutale de
l’ancien rugbyman international Christophe Dominici rappelle
l’importance du traitement médiatique du suicide dans la prévention
de l’effet Werther.
Le monde du rugby et du sport en général est en émoi, depuis
que l’on a appris la mort ce mardi après-midi de l’ancien rugbyman
Christophe Dominici. Décédé à 48 ans, l’ancien ailier avait fait
les plus belles heures du Stade Français et du XV de France dans
les années 1990 et 2000. Ses anciens partenaires et les
commentateurs ont notamment rappelé son rôle lors de la mémorable
victoire de la France contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale de
la coupe du monde en 1999 ainsi que son sens du jeu qui en faisait
l’un des symboles du jeu à la française, le fameux « french
flair ». Signe de l’importance de ce joueur dans l’histoire du
rugby français, un hommage lui a été rendu à l’Assemblée
Nationale.
Une « mort brutale » qui ne dit pas son nom
Évoquant sa « mort brutale » ou sa « disparition
», peu étaient les médias, généralistes ou sportifs, à insister sur
les causes de la mort de Christophe Dominici. L’ancien rugbyman se
serait semble-t-il suicidé en se jetant du haut d’un immeuble à
Saint-Cloud. La plupart des articles consacrés à sa disparition ont
soigneusement éviter le mot « suicide » dans leurs titres.
Les journalistes se sont généralement peu appesantis sur les
circonstances du décès, l’Équipe rappelant d’ailleurs que la thèse
de l’accident n’était pas encore totalement écartée, pour insister
davantage sur sa carrière et sa personnalité.
Peut-on y voir la conséquence des recommandations faites aux
journalistes pour éviter l’effet Werther ? On le sait, depuis une
étude du sociologue David Phillips en 1974, la plupart des
psychiatres et des sociologues sont convaincus que le traitement du
suicide dans l’art et les médias peut entrainer des suicides par
imitation, notamment chez les personnes soufrant de troubles
psychiatriques, les jeunes et ceux qui présentent des points
communs avec l’auteur du suicide. C’est ce qu’on appelle l’effet
Werther, du nom du personnage principal du roman de Johann Goethe
Les Souffrances du jeune Werther. La parution en 1774 de
l’ouvrage, dans lequel le héros finit par se donner la mort, aurait
provoqué une vague de suicides en Europe (sans que l’on ne dispose
de statistiques fiables bien sûr).
Depuis la découverte de ce phénomène, de nombreux organismes,
dont l’Organisation mondiale de la Santé, ont publié des
recommandations à destination des journalistes afin que la
couverture médiatique des suicides et notamment celui des
personnalités, n’ait pas de conséquence dramatique.
Werther contre Papageno
Il est par exemple demandé aux journalistes de ne pas utiliser
le mot « suicide » dans le titre ou de ne pas mettre les
articles consacrés à ce phénomène à la une. Un terme comme «
suicide réussi » doit être proscrit, en ce qu’il laisse
penser que la mort est une issue souhaitable pour lui préférer
l’expression « suicide abouti ». La méthode employée et les
circonstances de la mort ne doivent pas être trop détaillée dans
l’article. De manière générale, l’OMS demande aux journalistes
d’éviter de donner une vision trop romanesque au suicide, de ne pas
relayer les mythes qui y sont liées et de mettre en avant les
moyens de lutter contre les idées suicidaires.
Tout l’objectif de ces recommandations est de créer, à
l’opposé de l’effet Werther un effet dit Papageno. A la fin de
l’acte II de La Flute enchantée de Mozart, alors que
Papageno songe à se pendre, trois génies le convainquent de
renoncer à son funeste projet.
Quentin Haroche




