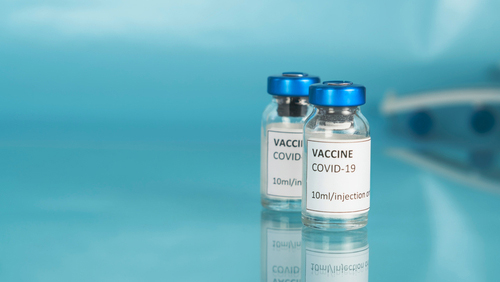
La HAS (Haute Autorité de Santé) utilise le terme de « symptômes prolongés à la suite d’une Covid-19 » et l’OMS décrit un « état post-Covid-19 ». Plus communément appelée « Covid long », cette entité désigne la persistance de symptômes au-delà de 4 semaines après la date présumée de contamination par le SARS-CoV-2, ne pouvant pas être expliqués par une autre maladie. Les symptômes incluent fatigue, dyspnée, troubles cognitifs, céphalées, douleurs musculaires, palpitations. La prévalence de ces symptômes est assez mal établie, certaines études donnant un chiffre de 2 %, d’autres de plus de 50 %, variant selon les populations étudiées. S’il semble qu’ils peuvent persister quelle que soit la sévérité de la maladie, l’efficacité de la vaccination sur ces symptômes prolongés n’est pas encore connue.
La Suède a une longue histoire de collecte de ses données démographiques et de santé. C’est ce qui a permis la réalisation d’une étude dont l’objectif était d’examiner l’efficacité de la vaccination contre la Covid-19 (2 doses initiales et un rappel), pratiquée avant l’infection, contre la survenue de symptômes prolongés.
Près de 600 000 suédois atteints de Covid-19 entre 2020 et 2022
L’étude porte sur près de 590 000 personnes, dont environ 300 000 avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19 avant d’être contaminées.
L’étude ne manque pas d’intérêt puisqu’il apparaît que les personnes non vaccinées ont presque 4 fois plus de risque de Covid long que celles qui avaient été vaccinées (1,4 % vs 0,4 %). Parmi les personnes vaccinées, l’efficacité du vaccin contre le syndrome post-Covid-19 augmente avec le nombre de doses reçues, allant de 21 % pour 1 dose, à 59 % pour 2 doses et jusqu’à 73 % pour 3 doses ou plus.
Les auteurs rappellent que la pathogénie du syndrome post-Covid-19 n’est pas encore claire, plusieurs mécanismes ayant été proposés, et l’hétérogénéité des patients atteints compliquant la synthèse : dommages tissulaires, prolongation de l’activité immunitaire du fait de la persistance du virus, auto-immunité, dysbiose, plusieurs pistes ont été évoquées. Déterminer la pathogénie permettra sans doute de comprendre l’effet protecteur de la vaccination. Les auteurs évoquent notamment l’hypothèse de la réduction de la charge virale lors de la phase aigüe de l’infection, qui pourrait réduire le risque de la persistance du virus.
Dr Roseline Péluchon




