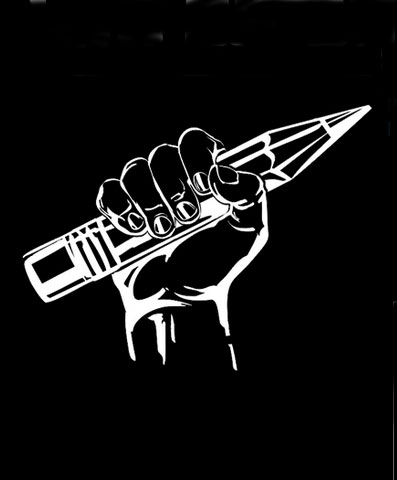
Paris, le lundi 12 janvier 2015 – Ils étaient présents dans la salle de rédaction ou ils ont pénétré sur les lieux du drame quelques instants après, ils étaient venus faire leurs courses ou ils avaient envoyé un de leur proche à l’épicerie : des dizaines de personnes ont été plongées dans l’horreur la semaine dernière, qu’il s’agisse des journalistes et proches de Charlie-Hebdo ou des clients de l’hyper cacher pris pour cible vendredi 10 janvier. L’horreur s’est imposée, implacable, dans leur existence et chez certains elle pourrait demeurer longtemps l’unique horizon. Car au-delà des journées de deuil et de souffrance, certains seront probablement atteints d'un syndrome de stress post traumatiques (SSPT) ou de ce qui est parfois également appelé le « syndrome de Lazare » propre aux « survivants ».
Des cellules d’urgence médico-psychologiques créées après l’attentat de Saint-Michel
Depuis de nombreuses années, des interventions spécifiques et rapides d’équipes spécialisées tentent de prévenir l’installation de ce syndrome. Créées à la demande de Jacques Chirac au lendemain de l’attentat terroriste perpétré à la station RER Saint Michel à Paris le 25 juillet 1995, les cellules d’urgence médico-psychologiques (CUMP) ont pour vocation d’offrir une écoute immédiate à ceux qui ont été les témoins d’événements particulièrement graves et traumatisants, tels des attentats, des catastrophes naturelles et toutes sortes d’accidents collectifs. Aujourd’hui, chaque département dispose de sa propre structure, rattachée au Samu et dirigée par un psychiatre référent. Mercredi, quelques heures à peine après la tuerie de Charlie Hebdo, les proches des victimes et tous ceux qui étaient présents sur les lieux du drame étaient accueillis dans une CUMP mise en place à l’Hôtel Dieu à Paris. Cité par Le Point la semaine dernière, le Journal international de victimologie revenait sur les objectifs et les modalités de prise en charge de ces CUMP : « prodiguer des soins médico-psychologiques d’urgence à tous les blessés psychiques qui en ont besoin : administration de médications psychotropes (…) et entretiens psychothérapeutiques d’urgence, centrés sur la verbalisation de l’émotion pour réduire les effets néfastes du stress traumatique et permettre prudemment l’inscription de l’événement dans la vie du sujet ».
Quels sont les sujets les plus à risque ?
Difficile de mesurer l’efficacité de ce type d’intervention car les études sont rares sur le sujet. Néanmoins, le docteur Bon avait conduit une enquête sur ce thème à l’occasion de son travail de thèse, auprès des rescapés du tsunami de décembre 2004. Il était apparu qu’une majorité de personnes (74 %) affirmaient avoir ressenti un véritable soulagement grâce aux entretiens proposés dans le cadre d’une CUMP mise en place à Roissy, tandis que 97 % ont été satisfaits de la qualité de l’écoute et 65 % ont estimé que le moment était adapté. Sur la base de telles données (déclaratives) et d’autres observations, beaucoup de spécialistes estiment qu'un soutien psychologique est fortement recommandé. « Certaines personnes pourront s’en passer, mais il est difficile de prévoir lesquelles. Ceux qui se placent sur un mode guerrier ne sont pas forcément ceux qui résistent le mieux. Il est difficile d’identifier les personnes les plus vulnérables dans cette situation. Beaucoup de facteurs entrent jeu : l’expérience, le vécu de l’événement (deux personnes dans la même pièce n’auront pas la même histoire à raconter), la culture, l’éducation, le lien avec les autres, la fatigue… » énumère Cyril Cosar, psychologue au centre de psychotrauma de l’Institut de victimologie interrogé par Santé Magazine. S’il semble donc complexe de déterminer les peronnes les plus à risque, les réactions des sujets dans les premières heures suivant l’événement sont souvent révélatrices. L’existence notamment d’une éventuelle « dissociation péritraumatique » chez les personnes exposées doit notamment alerter. A cet égard, dans les témoignages recueillis ces derniers jours auprès des journalistes travaillant dans les mêmes locaux que ceux de Charlie-Hebdo ou chez des proches des victimes, on peut retrouver des éléments évocateurs d’un risque de SSPT. Soulignons encore que la proportion de sujets qui pourrait souffrir de SSPT varierait entre 20 et 30 % selon le docteur François Ducrocq, psychiatre au CHRU de Lille et spécialiste du stress-post-traumatique, interrogé par le Figaro, qui rappelle par ailleurs que des molécules sont aujourd’hui disponibles permettant d’éviter la consolidation du traumatisme, tel le propranolol.
Etre spectateur n’entraîne généralement pas de traumatisme durable
Au-delà des « rescapés » de ces attentats, existe-t-il un risque de syndrome de stress post traumatique dans le reste de la population ? A l’occasion de catastrophes semblables, des études ont été menées pour déterminer l’impact global de ce type d’évènements. Dans le Quotidien du médecin, le docteur Richard Rechtman, psychiatre et anthropologue à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) évoque tout d’abord le cas particulier de sujets fragilisés. « Ceux et celles qui ont connu de près ou de loin des évènements similaires ou chargé d’une forte teneur émotionnelle ou traumatique revivent leur propre histoire (…).Chez d’autres, le sentiment d’impuissance suscite l’envie de réagir. Il pourrait même y avoir des réactions individuelles de violence, pour ceux qui vont s’identifier aux victimes ou à l’opposé, aux auteurs. Des personnes enfin qui présentent déjà des troubles peuvent être sous l’effet de la sidération, cliniquement parlant pour le coup ». Au-delà, dans la population générale, il rappelle que les travaux conduits par exemple après les attentats du 11 septembre ont finalement pu mettre en évidence qu’il n’existait pas dans la population générale de syndrome de stress post traumatique réel chez ceux et celles qui avaient par exemple revu l’évènement en boucle à la télévision. Des éléments rassurants d’autant plus que les images des attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper casher sont probablement moins marquantes et explosives que celles liées aux événements new-yorkais.
Aurélie Haroche




