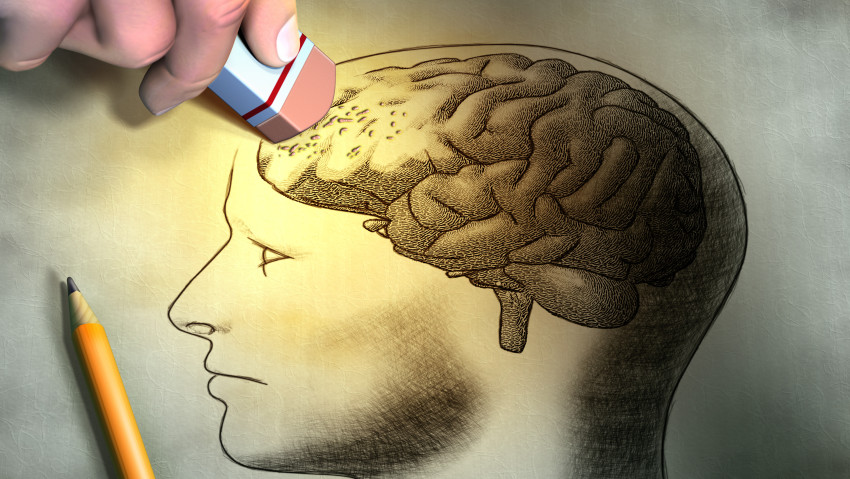
A ce jour, pour les cliniciens, il est impossible de savoir à l’avance quels patients vont répondre à un traitement donné. Et encore moins de savoir quelle classe thérapeutique conviendra à tel ou tel patient.
Des données issues de la recherche… Mais rien (pour l’instant) pour la pratique
On dispose avec l’imagerie cérébrale fonctionnelle de données intéressantes, mais qui correspondent surtout à des corrélations statistiques issues d’études souffrant de faiblesses méthodologiques, et difficiles à transposer en pratique clinique quotidienne. Ainsi, l’activation du cortex cingulaire antérieur (région impliquée dans la régulation émotionnelle) avant le début du traitement est corrélée à l’amélioration sous traitement (1). Sans donner d’indication sur quel traitement pourrait être utile. Une étude toujours en cours permet de prédire avec une bonne efficacité les patients qui seront répondeurs à la thérapie cognitivo-comportementale ou aux traitements médicamenteux à l’aide de l’analyse de la connectivité fonctionnelle de repos en IRM fonctionnelle (2). Une grande limite de ce type d’études est qu’elles comparent généralement les patients répondeurs et non répondeurs à un traitement, sans groupe placebo (dont l’efficacité pourrait être associée aux mêmes activations cérébrales).Il existe depuis longtemps des marqueurs inflammatoires et neuroendocriniens intéressants dans les dépressions. On sait ainsi que les pathologies inflammatoires sont associées à une forte prévalence de dépression et la plupart des marqueurs inflammatoires sont augmentés chez les patients déprimés. On sait même que l’infliximab (anti-TNF) est efficace sur les symptômes dépressifs, uniquement chez les patients présentant une CRP supérieure à 5 mg. Un test consistant en la mesure de la production de cortisol endogène après administration de dexamethasone (pour freiner la production de cortisol) puis de Cortisol Releasing Factor le lendemain (pour la stimuler), une semaine après l’instauration d’un traitement antidépresseur permet de déterminer les patients qui vont répondre aux traitements (une augmentation importante du cortisol étant un marqueur de mauvais pronostic) (3,4). Ce test coûteux n’est cependant pas utilisé en pratique clinique.
Une inefficacité due aux métaboliseurs rapides ?
Un facteur fréquent d’échec du traitement antidépresseur est probablement la pharmacocinétique. En effet, les individus qui sont métaboliseurs ultra-rapides pour certains cytochromes peuvent avoir une concentration de médicaments nulle, malgré des posologies importantes. Ces variations interindividuelles sont liés à des caractéristiques pharmacogénétiques (polymorphismes du cytochrome), mais pas seulement : l’activité des cytochromes dépend également de l’inhibition ou l’induction par d’autres médicaments, des conditions physiologiques, ou encore de l’alcool et du tabac. Pour la clinique, des données phénotypiques (c’est-à-dire les dosages de traitement qui donnent des informations sur le métabolisme des patients en conditions réelles) semblent donc plus utiles que les « simples » caractéristiques génétiques des patients.En pratique, les dosages médicamenteux ne sont aujourd’hui réalisés qu’en cas d’échec thérapeutique (généralement après plusieurs semaines). Un nouvel outil pourrait permettre d’avoir une information phénotypique a priori sur le métabolisme des médicaments. L’idée est de doser des molécules qui sont métabolisées spécifiquement par tel ou tel cytochrome, dans un contexte contrôlé (dose fixe, à une durée fixée par rapport au dosage).On utilise par exemple 10 mg d’oméprazole pour évaluer le fonctionnement du CYP 2C19, ou encore 1mg de midazolam pour le CYP 3A4. A terme, ces dosages pourraient être effectués en un seul prélèvement capillaire.
On a donc ainsi une information sur le métabolisme des médicaments en termes de phénotype, résultant de la génétique et de facteurs environnementaux. Cette analyse pharmacocinétique en début de traitement pourrait permettre d’éviter de donner un médicament inutile à un patient qui le métaboliserait trop rapidement, donnant la possibilité de choisir une autre molécule. Une première étude, intitulée MARVEL, est en cours, se donnant pour premier objectif d’évaluer si les métaboliseurs ultrarapides du 2C19 sont plus fréquents parmi les non répondeurs de la venlafaxine.
Dr Alexandre Haroche




