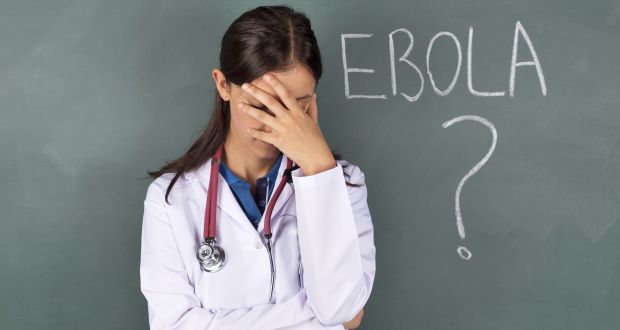
A l’heure où la lutte contre l’infection par le virus Ebola commence à obtenir des réponses du côté des vaccins, et où débute le premier programme clinique de traitement en Afrique, se pose aussi le problème du continuum de soins pour les patients qui ont bénéficié d’une prise en charge symptomatique.
Des séquelles cliniques, biologiques et psychosociales
Le pronostic de l’infection par le virus Ebola s’est amélioré, en partie grâce à une meilleure prise en charge symptomatique, avec une mortalité de l’ordre de 40 % aujourd’hui au centre MSF de Conakry. Le programme de recherche français de suivi d’une cohorte de survivants a évolué vers un projet sans visée thérapeutique de 18 mois qui évaluera l’évolution clinique, virologique, immunologique et psychosociale des personnes infectées par le virus Ebola et déclarées guéries. « Intitulé ‘Vivre après Ebola, accompagnement et suivi des patients déclarés guéris d’une infection par le virus Ebola en Guinée’, sa vocation est d’assurer une prise en charge pluridisciplinaire de cohortes de convalescents à leur sortie des centres de Conakry et de Macenta », explique son coordinateur, le Pr Eric Delaporte (IRD France-Sud Montpellier/Inserm/Université). « Contrairement au concept initial, il n’est pas question dans cette étude de prélèvements sanguins en vue d’une utilisation thérapeutique ».
« Il s’agit de répondre à une urgence de santé publique, et d’autre part d’approfondir nos connaissances sur les séquelles de l’infection, par exemple d’apporter plus de réponses à la question de la clairance virale » souligne le Pr Delaporte. L’expérience acquise a enseigné aux chercheurs que « nombre de personnes guéries souffrent de problèmes cliniques (myalgies, fatigue importante, troubles neurosensoriels), psychosociaux (stigmatisation, acceptabilité de l’entourage), et de conséquences biologiques (sur le foie, le rein, l’hémoglobine), qui requièrent une intervention multidisciplinaire ». Ces patients, notamment des enfants, vont pouvoir bénéficier d’un suivi avec des bilans réguliers, comme nous le connaissons en France. Financé par l’Inserm qui en est le promoteur, ce projet qui réunit cliniciens, épidémiologistes, anthropologues et sociologues devrait démarrer en janvier, et s’appuiera sur les associations de personnes guéries. La cohorte sera ouverte aussi aux patients ayant bénéficié du premier programme clinique en Afrique sur les antiviraux et l’immunothérapie passive par du plasma ou du sang de patients guéris de l’infection, déjà décrit sur JIM.fr. Il est prévu de démarrer le 15 décembre l’essai sur le favipiravir (1), confie son coordinateur le Pr Malvy.
Un projet d’essai thérapeutique par des anticorps d’origine équine
Les autres pistes de traitement ne sont pas pour autant abandonnées, à l’exception de la lamivudine dont l’absence d’activité contre Ebola a été établie (2).
Côté antiviraux, le BCX4430 (BioCryst) témoigne d’une augmentation de la survie aux plus hautes doses testées dans de premiers essais chez le macaque. Un autre essai devait démarrer fin novembre à des doses supérieures. La biotech américaine anticipe le dépôt d’une demande d'autorisation d'essai clinique à la FDA avant la fin de l’année et la disponibilité de 2 000 traitements en mars 2015.
L’immunothérapie passive par les immunoglobulines polyclonales pourrait bien être une arme essentielle pour stopper l’épidémie actuelle. L’IRD cordonne avec l’UMR-MD3 (Université Aix-Marseille) un projet de détection ultrasensible du virus Ebola et son application à un essai de thérapie en phase précoce par immunothérapie passive avec des anticorps produits chez le cheval. La Commission européenne (CE) finance ce projet à hauteur de 2 M€, sur 24,4 M€ débloqués le 23 octobre pour la recherche de vaccins et de traitements contre Ebola. Il s’agit d’un partenariat avec la biopharmaceutique lyonnaise Fab’entech spécialisée en immunothérapie passive des maladies infectieuses émergentes, qui propose des anticorps polyclonaux obtenus après purification du sérum de chevaux hyperimmunisés et fragmentation (fragment Fab). Metabiota, qui joue un rôle central dans la lutte contre Ebola en Sierra Leone depuis 2009, notamment en temps que laboratoire de diagnostic référent, est le premier sous-traitant américain à annoncer le 3 décembre que la CE lui a octroyé un financement pour ce projet. Orion Integrated Biosciences devrait être le deuxième.
De son côté SAB Biotherapeutics travaille avec une équipe du centre de recherches sur les maladies infectieuses de l’armée américaine (USAMRIID) pour produire de grandes quantités d’anticorps humains anti-Ebola à partir de bovins immunisés. Les chercheurs ont apporté la preuve que leur concept est valable contre de nombreux pathogènes dont des hantavirus (3).
Les anticorps monoclonaux tels le ZMapp sont plus difficiles à obtenir en quantité importante (4). Ce dernier, grâce aux efforts de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) américaine pour accélérer sa production, devrait être disponible en décembre en doses suffisantes pour environ 100 traitements. Selon la Maison Blanche, des études cliniques devraient commencer début 2015 aux USA et dans les pays africains.
En septembre la biopharmaceutique Tekmira avait annoncé son engagement avec le consortium international financé par Wellcome Trust en vue d’essais cliniques accélérés en Afrique de son ARN interférent TKM-Ebola. L’utilisation de son produit ne lui a toujours pas été confirmée alors même que fin octobre elle avait déjà commencé la fabrication aux normes GMP d’une quantité limitée de l’ARNi ciblant spécifiquement la variante virale Ebola-Guinée responsable de l'épidémie actuelle, la disponibilité de ce produit étant prévue pour début décembre.
Un bond de la valeur des parts de Tekmira le 10 décembre est attribué par certains à l’acceptation -tant attendue- par le congrès américain d’un financement de $5,5 milliards qui conditionne la suite de la lutte contre Ebola engagées par les USA, notamment la construction au Libéria de 11 unités supplémentaires de traitement et les prochaines étapes concernant vaccins et traitements.
Amplifier la réponse vaccinale ?
Les résultats du premier essai de phase 1 réalisé aux USA du vaccin ChAd3-EBOV (GSK/National Institute of Allergy and Infectious Diseases) contre les espèces virales Zaïre et Soudan sont encourageants (5, 6) et ont déjà été commentés sur JIM.fr. Le titre en anticorps est similaire à celui observé chez le singe mais la réponse spécifique CD8 nécessite la dose la plus élevée, n’étant que de 20 % à 2x1010 PU (particle units) contre 70 % à 2x1011PU. Ce qui pourrait avoir une incidence sur le nombre de doses produites. Aucun effet indésirable grave n'a été relevé. La société Bavarian Nordic a annoncé le 4 décembre l’inclusion du premier patient dans un essai de phase 1 de l’université d’Oxford évaluant une stratégie de prime-boost du vaccin. Trente volontaires sains ayant reçu le ChAd3-EBOV recevront une injection de rappel avec un vecteur MVA (Modified Vaccinia Ankara) dont elle est propriétaire exprimant la glycoprotéine virale. Les réponses préliminaires à la question importante de la nécessité ou non de ce rappel, connu pour augmenter la durée de l’immunité, sont attendus au premier semestre 2015.
Merck & Co et NewLink Genetics ont annoncé le 24 novembre qu'ils avaient conclu un accord de licence exclusive mondiale pour la recherche, le développement, la fabrication, et la distribution du candidat vaccin rVSV-ZEBOV, actuellement en phase 1.
Dominique Monnier




