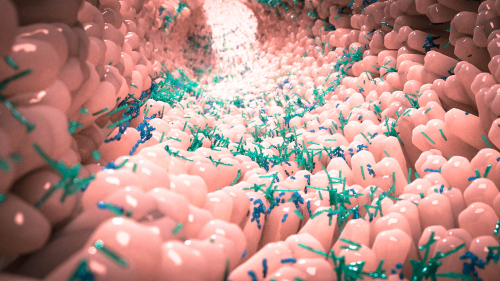
Dans le tube digestif, il existe un microbiote commun à tous
et des différences inter-individuelles selon l’environnement, les
facteurs génétiques, l’alimentation, les médicaments, et en
particulier les traitements antibiotiques… Sa diversité, signe de
bonne santé, s’établit avant 5 ans. Trois phyla sont majeurs dans
l’intestin : Bacteroïdetes, Firmicutes et
Actinobacteria. Le microbiote humain est constitué en
moyenne de 100 000 milliards de microbes, soit 2 kilos chez un
adulte. Il se constitue dès la naissance, au contact de la flore
vaginale en cas d’accouchement par voie basse, et des
microorganismes de l’environnement chez les enfants nés par
césarienne. Le microbiote placentaire est unique, composé de
bactéries commensales non pathogènes, curieusement plus proche du
microbiote de la bouche que de celui du vagin. Le rôle de cette
flore est encore mal connu mais on observe que le microbiote
placentaire est perturbé dans certaines pathologies de la grossesse
(chorioamniotite, rupture prématurée des membranes, menace
d’accouchement prématuré…). De même, on relève plus de vaginoses
bactériennes en cas d’infertilité tubaire et de fausses couches
précoces. Le microbiote uro-génital est très dépendant de
l’imprégnation œstrogénique, donc de la période considérée.
L’utilisation d’antibiotiques en clinique aboutit à une altération
du microbiote (baisse de la diversité, dysbiose…). En cas
d’exposition chronique, aucun retour en arrière du microbiote n’est
possible. De même, il existe une susceptibilité individuelle aux
xénobiotiques (polluants, additifs, pesticides…) qui peut impacter
le microbiote. Or l’appauvrissement du microbiote est très
défavorable puisqu’il pourrait être relié à l’apparition de
maladies « post-modernes », a priori non transmissibles
(maladies auto-immunes, allergies, troubles du spectre
autistique…), comme permettent de l’évoquer plusieurs études
observationnelles et même interventionnelles (probiotiques,
post-biotiques, transfert de microbiote fécal…).
Dr Catherine Azoulay




