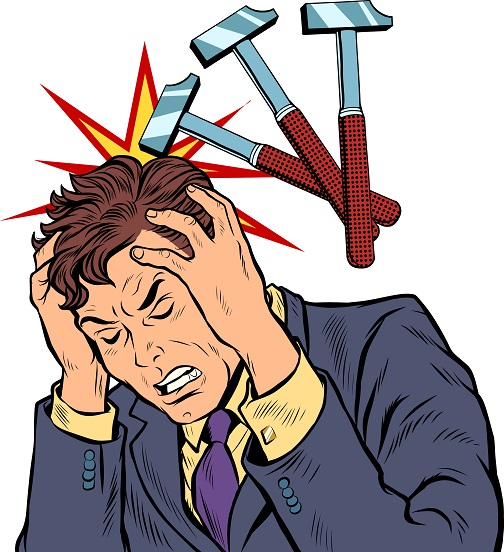
Les céphalées sont un motif de consultation particulièrement fréquent. Le plus souvent, l’anamnèse et l’examen clinique permettent d’orienter le diagnostic étiologique vers les causes les plus fréquentes. Il est formes cliniques rares et atypiques qui vont nécessiter l’intervention des neuroradiologues : c’est l’occasion de rappeler quelques causes souvent méconnues (car rares) de céphalées et d’envisager à la fois les critères de leur diagnostic et leur traitement qui peut relever de la neuroradiologie interventionnelle.
L’hypotension intracrânienne (Boulouis G)
L’hypotension intracrânienne est le type même des causes sous diagnostiquée de céphalées orthostatiques. Son diagnostic positif repose sur l’IRM cérébrale et médullaire. L’IRM cérébrale avec injection de produit de contraste révèle des signes divers et variés, à type de collections sous-durales, de rehaussement pachyméningé, engorgement veineux, d’hyperhémie pituitaire ou encore l’affaissement des structures médianes.
L’IRM médullaire, pour sa part, révèle parfois une accumulation épidurale de liquide céphalorachidien témoignant d’une fuite qui peut être le mécanisme causal. Cette dernière sera confirmée par myéloscanner ou myélographie latérale. Le traitement est neurochirurgical ou endovasculaire selon le type de l’hypotension intracrânienne, défini par l’imagerie cérébrale et médullaire la plus exhaustive possible.
Le cas de l’hypertension intracrânienne primitive (Labeyrie MA)
L’hypertension intracrânienne primitive survient typiquement chez des femmes jeunes en surpoids. Elle est à l’origine de céphalées matinales qui disparaissent volontiers lors du passage en orthostatisme et s’améliorent transitoirement après une ponction lombaire. L’IRM cérébrale avec injection de produit de contraste permet d’objectiver les signes évocateurs du diagnostic à type de sténose veineuse et d’arachnoïdocèle intrasellaire (correspondant à une hernie des espaces sous-arachnoïdiens au sein de la selle turcique).
L’IRM distingue les sténoses veineuses extrinsèques (déhiscence segmentaire du sinus) ou intrinsèque (granulation de Pacchioni). Elle permet aussi le diagnostic différentiel en éliminant les processus post-thrombotiques, l’envahissement tumoral ou encore l’inflammation méningée, tout en recherchant une éventuelle brèche dure-mérienne.
Le traitement de ces pathologies exceptionnelles passe par les centres de référence. Il peut relever de l’urgence, au moins relative en cas de baisse de l’acuité visuelle. La prise en charge médicale peut reposer sur la ponction lombaire à visée soustractive, la perte de poids en d’obésité ou l’administration d’un inhibiteur de l’anhydrase carbonique, type Diamox. En cas d’échec, un stenting veineux relevant de la neuroradiologie interventionnelle peut se discuter, en sachant que les résultats de ce geste sont excellents quand son indication est bien posée.
Anévrisme cérébral découvert à l’occasion de céphalées (Caroff J)
Les anévrismes intracrâniens non disséquants et non compressifs ne sont pas des causes de céphalée, et leur découverte lors d’un bilan en fait le plus souvent des incidentalomes. Il faut toutefois rechercher systématiquement des signes d’alerte pouvant déboucher sur une prise en charge urgente : céphalées ictales (graves et soudaines), aspect d’hémorragie sous-arachnoïdienne en IRM, dissection ou encore syndrome compressif du type paralysie du troisième nerf crânien. En l’absence de ces signes, il convient de rassurer le patient, la prévalence des anévrismes cérébraux au sein de la population générale étant de l’ordre de 2 %. Une orientation vers un parcours de soins dédié est souhaitable pour encourager le sevrage tabagique et prendre en charge une éventuelle HTA.
HSA corticales focales non traumatiques : que rechercher ? (Bonneville F)
Le mode de présentation et les étiologies des hémorragies sous-arachnoïdiennes corticales focales non traumatiques ne sont pas ceux des hémorragies sous-arachnoïdiennes plus diffuses qui sont généralement secondaires à une rupture anévrismale. Les céphalées aiguës, a fortiori intenses, imposent un scanner cérébral en urgence : quand celui-ci s’avère normal, une IRM doit compléter le bilan étiologique à la recherche de causes rares, en recourant à des séquences spécifiques du type T2 FLAIR / T2* ou SWI (Susceptibility Weighted Imaging), complétées par un protocole TOF (Time Of Flight) et une injection de produit de contraste, pour atteindre une sensibilité maximale. C’est ainsi que l’on pourra mettre en évidence les étiologies suivantes :
·Une thrombose veineuse cérébrale,
·Un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible qui sera confirmé a posteriori par une IRM de contrôle à 3 mois
·Un PRES (Posterior Reversible Encephalopathy Syndrom), hémorragique dans 20 % des cas,
·Un tableau évocateur d’endocardite infectieuse, surtout quand il existe une association de lésions ischémiques et hémorragiques
·Une angiopathie amyloïde ou une vasculopathie rare du type Moya-Moya
Dr Philippe Tellier




