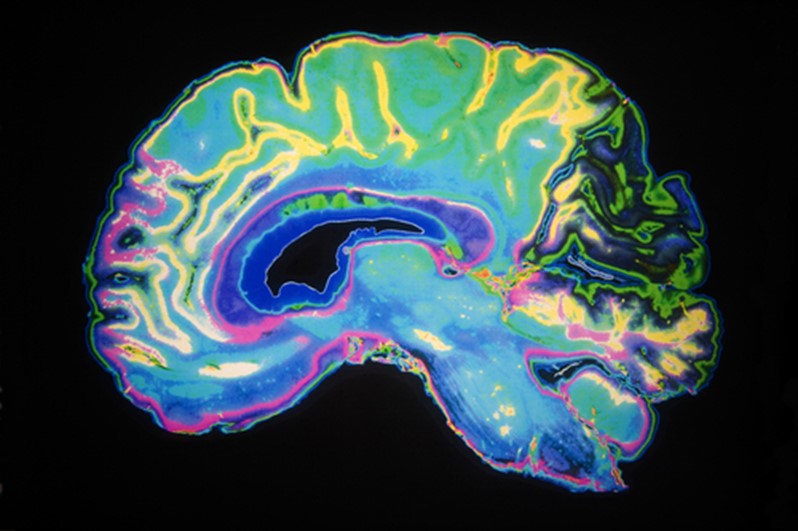
S’il est une spécialité médicale où les besoins en imagerie
sont énormes, c’est la psychiatrie. De fait, les troubles
psychiatriques représentent un enjeu majeur en santé publique.
L’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’à l’échelon
planétaire, plus d’un individu sur huit connaîtra un trouble
psychiatrique au cours de sa vie.
Le diagnostic repose sur des critères cliniques, fonctionnels
et temporels par essence subjectifs. Les critères diagnostiques
sont résumés dans la cinquième et dernière édition du DSM
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) de
l’APA (American Psychiatric Association) datant de 2015. Le
diagnostic des maladies psychiatriques est parfois délicat, dans la
mesure où il repose sur l’anamnèse, l’interrogatoire et l’examen
clinique, aucun test biologique et aucune imagerie ne venant
confirmer ou infirmer les hypothèses qui en découlent.
Diagnostic différentiel : l’IRM de routine
De nombreuses pathologies neurologiques organiques notamment
tumorales, auto-immunes, vasculaires, métaboliques, infectieuse,
dégénératives etc. peuvent se révéler par des manifestations
psychiatriques diverses, de sorte qu’il convient de les éliminer en
s’aidant des techniques d’imagerie cérébrale non invasives. A
l’heure actuelle, l’IRM (imagerie par résonance magnétique) est la
technique privilégiée dans l’exploration des troubles
psychiatriques.
Elle permet le diagnostic différentiel dans la majorité des
cas et fournit une image de référence qui sera bien utile dans le
suivi d’une maladie organique le cas échéant. Sa précision
anatomique remarquable permet une étude fine des structures
cérébrales et ses performances diagnostiques la rendent
incontournable dans le bilan initial et le suivi de la plupart des
maladies neuropsychiatriques. C’est d’ores et déjà un apport
considérable qui permet de s’orienter vers une affection
psychiatrique « pure » sans subtratum organique à l’aune des
critères diagnostiques actuels.
Imagerie avancée
Par ailleurs, si cette imagerie est d’une précision anatomique
remarquable, elle est également capable d’offrir une vision
fonctionnelle du cerveau : à ce titre, elle a donné une impulsion
majeure dans la recherche en santé mentale. L’IRM dite
fonctionnelle (IRMf) ouvre des perspectives nouvelles dans la
compréhension des troubles mentaux, tout en facilitant les
innovations thérapeutiques au travers des thérapies guidées par
l’image.
Elle est ainsi appelée à dépasser son rôle actuel d’outil
diagnostique de routine pour s’intégrer progressivement dans une
prise en charge personnalisée des patients à tous les stades de
l’affection psychiatrique. Il est par ailleurs de plus en plus
clair qu’il existe des altérations structurelles et fonctionnelles
cérébrales dans les pathologies psychiatriques.
C’est le domaine de l’imagerie dite avancée qui n’est pas
encore en application en pratique médicale quotidienne. L’analyse
tridimensionnelle du volume cortical sur des séquences pondérées en
T1 a révélé, par exemple, une diminution du volume de la substance
grise du système limbique dans certaines maladies
psychiatriques.
Les analyses volumétriques qui s’appuient de plus en plus sur
des reconstructions automatiques basées sur des algorithmes
d’intelligence artificielle devraient permettre de gagner en
précision dans les années à venir, car les possibilités sont
immenses. La connectivité structurelle peut par ailleurs être
évaluée par la tractographie grâce à l'imagerie du tenseur de
diffusion. A titre d’exemple, l’étude du tractus du faisceau
unciné, reliant l'amygdale aux cortex frontal médial et
orbito-frontal, a révélé une diminution de la fraction
d’anisotropie chez les patients schizophrènes.
La piste de la connectivité fonctionnelle
L’IRMf permet d’analyser les modifications de la connectivité
fonctionnelle cérébrale. Cette technique, introduite en 1990,
repose sur l’analyse des variations temporelles du signal BOLD
(Blood Oxygen Level Dependent) au sein de différentes
régions cérébrales, qui sont tributaires des concentrations locales
de désoxyhémoglobine qui fluctuent au gré de l’activation de la
région cérébrale étudiée.
La technique recueille des séries temporelles de ce signal en
différents points du cerveau et il est ensuite possible de les
corréler entre différentes régions d’intérêt, afin d’évaluer leur
degré de connectivité. Plusieurs études utilisant l’IRMf ont permis
d’objectiver des anomalies de connectivité fonctionnelle
spécifiques à certaines maladies psychiatriques et c’est là un
champ de recherche à la fois vaste et hautement évolutif.
Enfin, l’avènement de l’IRM à ultra-haut champ magnétique (IRM
à 7 Tesla) devrait contribuer à une approche encore plus fine des
mécanismes physiopathologiques des maladies psychiatriques.
L’imagerie avancée est appelée à jouer un rôle croissant dans
l’univers des troubles psychiatriques et ses applications
changeront probablement leur prise en charge dans un avenir qui
n’est pas si lointain.
Dr Philippe Tellier




