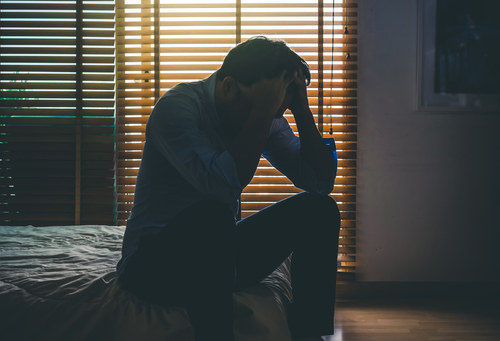
Décrit en 1998 par le psychiatre japonais Toshikazu Saito, le
terme de Hikikomori désigne les patients, généralement de jeunes
hommes, qui vivent reclus chez leurs parents, et limitent au
maximum les contacts sociaux "en vie réelle". Ils abandonnent
progressivement leurs études, leur emploi, leurs amis et leur
famille. Ils sont souvent décrits comme incuriques, apathiques et
apragmatiques. Ce n’est pas un hasard si cette description est
relativement récente : en parallèle du désintéressement social, il
est décrit dans le syndrome de hikikomori un temps excessif passé
devant les écrans. Une étude de 2016 estime qu’au Japon environ 541
000 sujets répondraient à la définition du Hikikomori. Il existe
également des cas rapportés en France.
Mais aussi fréquente que soit cette situation clinique,
constitue-t-elle une maladie pour autant ? La description de
l’isolement relationnel existait déjà avant le Dr Saito, avec par
exemple les travaux de Gayral datant des années 1950 sur le
syndrome de claustration à domicile. En réalité, lorsqu’elle est
possible, l’analyse sémiologique permet de préciser dans quel cadre
se situe cette situation de « hikikomori », et on retrouve
fréquemment des cas de schizophrénie, de dépression, de trouble du
spectre de l’autisme, ou encore de phobie sociale. Au-delà de ces
hikikomori " secondaires", on ne peut pas exclure l’existence
d’hypothétiques hikikomoris "primaires", indemnes de tout trouble
psychiatrique, et dont la claustration se rapprocherait davantage
d’un "choix".
Dr Alexandre Haroche




