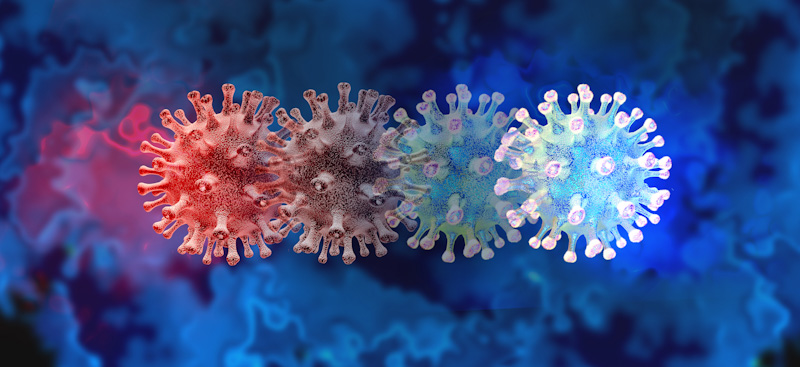
Au 1er janvier 2023, la pandémie de la Covid-19 avait entraîné depuis le 4 janvier 2020, selon les estimations, 17,2 millions de décès (6,88 millions de décès déclarés) et environ 7,6 milliards d'infections et de réinfections [1, 2]. Une grande partie de ces infections sont survenues après le 14 novembre 2022 ; on estime que 3 à 8 milliards de personnes, soit 46 % de la population mondiale, ont été infectées par le variant omicron et/ou ses sous-lignées [3].
Les variants préoccupants (OMS-VOC) du SARS-CoV-2 sont apparus fin 2020 et font l’objet d’une dénomination internationale, définie par l’OMS et basée sur l’alphabet grec. Le variant Alpha s’est rapidement propagé en France après son introduction fin 2020 et est devenu majoritaire en mars 2021. Les variants Beta et Gamma ont également circulé au premier semestre 2021, de manière toutefois moindre. Le variant Delta est apparu en mai 2021 et a rapidement remplacé les précédents variants ; il est devenu majoritaire en France en juillet 2021. Le variant Omicron est le dernier VOC apparu, fin novembre 2021 avec une diffusion croissante ; il est majoritaire aujourd’hui (environ 98 % des cas en France).
Les responsables politiques étant de plus en plus réticents à l'idée d'imposer des distanciations physiques strictes et le port obligatoire du masque, l’impact santé de la Covid-19 dépend et dépendra en grande partie du niveau et de l’efficacité de la couverture vaccinale, du rôle des antiviraux dans la prévention des hospitalisations et des décès dus à la Covid-19, ainsi que de la transmissibilité et de la gravité des variants en circulation [4] ; elle dépendra aussi du niveau de protection lié à des infections virales antérieures contre des réinfections. Il est important de connaître la durée de l’immunité au fil du temps et la manière dont cette immunité varie en fonction des virus variants infectants [5].
Comprendre les caractéristiques de la protection conférée par une infection « naturelle » par les variants pré-omicron
Il est donc essentiel de comprendre le niveau et les caractéristiques de la protection conférée par une infection antérieure par le SARS-CoV-2 contre une réinfection ultérieure, vis à vis de la maladie symptomatique Covid-19 et des formes graves, cela pour prédire la charge de morbidité potentielle future, pour concevoir des politiques visant à recommander ou imposer le port du masque, à restreindre les voyages ou l'accès aux lieux où le risque de transmission est élevé, et pour éclairer les choix concernant le moment où les doses de vaccin doivent être administrées.
La prise en compte d’une infection antérieure dans les stratégies de lutte contre la COVID-19 a varié selon les Etats. Par exemple, le certificat Covid de l'Union européenne permet aux personnes dont l'infection a été documentée au cours des 180 derniers jours de bénéficier du certificat au même titre que les sujets correctement vaccinés [6]. En revanche la réglementation américaine exige des non-citoyens qu'ils soient entièrement vaccinés pour se rendre aux États-Unis ; les non-citoyens non vaccinés, même si une lnfection a été officiellement documentée par le passé ne peuvent pas entrer dans le pays [7].
Depuis janvier 2021, plusieurs études ont documenté l'efficacité d'une infection antérieure par le SARS-CoV-2 et ses variants vis-à-vis du risque de réinfection, et l’évolution de l'immunité avec le temps [5]. Ces études varient en termes de période sur laquelle la protection est évaluée, et cible le variant viral pour lequel le risque de réinfection est évalué. Des revues systématiques et des méta-analyses ont aussi été réalisées sur les risques de réinfection [8] ; cependant, à ce jour, aucune étude n'avait évalué de manière exhaustive le niveau de protection conféré par une infection virale, avec une stratification selon le variant SARS-CoV-2 en cause, et peut être plus important encore la durée dans le temps de l’immunité liée à cette infection.
Une méta-analyse de 65 études
Une récente étude conduite aux Etats Unis, publiée en mars 2023 dans The Lancet a eu pour objectif d’analyser systématiquement tous les travaux disponibles afin d'estimer la protection conférée par une infection passée en fonction du variant viral et, lorsque les données le permettaient, du temps écoulé depuis l’infection [9]. Nous en présentons les principaux résultats.
Il s’agit donc d’une revue systématique d’articles et de méta-analyses portant sur la réduction du risque de la Covid-19 chez les personnes ayant déjà été infectées par le SARS-CoV-2, par comparaison à celles qui n'avaient pas été infectées auparavant.
La réinfection a été définie par les caractéristiques suivantes : un test PCR SARS-CoV-2 positif ou un test rapide à l'antigène (RAT) plus de 90 jours (ou dans certaines études 120 jours) après un test PCR ou RAT précédemment positif ; deux tests PCR ou RAT positifs séparés par quatre tests PCR négatifs consécutifs ; ou un test PCR ou RAT positif chez une personne ayant un test IgG anti-spike SARS-CoV-2 positif.
La réinfection symptomatique a été définie comme une réinfection par le SARS-CoV-2 entraînant l'apparition de symptômes pouvant inclure, sans s'y limiter, de la fièvre, une toux, un essoufflement, des frissons, des douleurs musculaires, une nouvelle perte du goût ou de l'odorat, des maux de gorge, de la diarrhée et des vomissements. La réinfection sévère est définie comme une réinfection par le SARS-CoV-2 qui a entraîné une hospitalisation ou un décès.
Toute étude présentant des résultats sur l'effet protecteur de l'immunité naturelle liée à la maladie Covid-19 chez des personnes non vaccinées par rapport à des personnes non vaccinées et naïves vis-à-vis de Covid-19 a été incluse dans notre analyse. Toute étude ne comportant que des résultats relatifs à l'efficacité protectrice de l'immunité naturelle associée à la vaccination (c'est-à-dire l'immunité hybride) a été exclue de l'analyse.
Des études de cohortes rétrospectives et prospectives, des études cas (maladie) -témoins (test-négatif) publiées depuis le début le début de la pandémie et jusqu’au 31 septembre 2022, ont été extraites de la littérature scientifique, puis examinées. Une méta-analyse de l'efficacité de l'infection antérieure en fonction du résultat (infection, maladie symptomatique et maladie grave), du variant viral et du temps écoulé depuis l’infection a été effectuée. Une méta-régression bayésienne a permis de valider les estimations de la protection. Le risque de partialité a été évalué à l'aide des outils d'évaluation de la qualité des National Institutes of Health. L'examen systématique était conforme à PRISMA et a été enregistré auprès de PROSPERO (numéro CRD42022303850).
Faible protection vis-à-vis d’une réinfection par omicron
Soixante-cinq études provenant de 19 pays différents, dont la France, ont été analysées. Les méta-analyses ont montré que la protection liée aux infections passées par les variants pré omicron (alpha, bêta et delta) était élevée en cas de réinfection par ces mêmes variants, de 90 % pour le variant Alpha (intervalle de confiance à 95 % IC 54,8-98,4), de 85,7 % pour le variant Beta (IC 83,4-87,7), de 82 % (IC 63,5-91,9) pour le variant Delta. La protection contre la maladie COVID-19 symptomatique allait de de 82 à 87 % selon ces trois variants.
Par contre la protection était nettement plus faible en cas de réinfection par le variant omicron BA.1. Elle était de 45,3 % (IC 17,3-76,1), et de 44,0 % (26,5-65,0) contre la maladie symptomatique liée à ce variant. A A noter que l'efficacité contre les formes graves de la maladie (hospitalisation et décès) était très élevée pour tous les variants, y compris le variant omicron BA.1 (Delta 97,2 %-Beta 88 %-Omicron BA-1 81.9 %-Alpha 79,6 %, sans différence significative).
La protection contre la réinfection par les variants alpha et delta a diminué avec le temps mais est restée élevée à 78,6 % (49,8-93,6) à 40 semaines. La protection contre la réinfection par le variant omicron BA.1 a diminué plus rapidement et a été estimée à 36,1 % (24,4-51,3) à 40 semaines. En revanche, la protection contre les formes graves de la Covid-19 est restée élevée pour tous les variants, avec 90,2 % (69,7-97,5) pour les variants alpha et delta, et 88 % (84,7-90,9) pour le variant omicron BA.1 à 40 semaines.
Bien que la protection conférée par une infection passée s'estompe avec le temps, le niveau de protection contre la réinfection, la maladie symptomatique et la maladie grave semble être au moins aussi durable, sinon plus, que celui fourni par une vaccination à deux doses avec les vaccins ARNm pour les variants alpha, delta et omicron de BA.1, ce qui ressort également d'études comparant directement l'immunité naturelle à la protection induite par le vaccin [10].
Les niveaux de protection contre les formes graves restent élevés (comme avec une vaccination) quel que soit le variant impliqué dans la réinfection
Cette étude fournit une analyse complète des travaux portant sur la protection liée à une infection antérieure par le SARS-CoV-2 contre une réinfection virale, avec une analyse selon les variants en cause ; elle évalue aussi l'affaiblissement de l'immunité en fonction du temps écoulé depuis la primo-infection.
Les résultats montrent des niveaux élevés de protection contre la réinfection par les variants Alpha Beta et Delta ; l’étude a révélé une protection significativement réduite contre la réinfection par le variant omicron BA.1, ce qui met en évidence les caractéristiques d'échappement immunitaire élevé de ce variant. Cependant, les niveaux de protection contre les maladies graves sont restés élevés quel que soit le variant impliqué dans la réinfection.
Les auteurs suggèrent que le niveau de protection offert par une infection antérieure est au moins aussi élevé, sinon plus élevé, que celui offert par une vaccination en deux doses utilisant des vaccins ARNm (Moderna et Pfizer-BioNTech).
Cette constatation a également des implications importantes pour la conception de politiques de lutte contre la Covid-19. Elle conforte l'idée que les personnes dont l'infection antérieure est avérée devraient être traitées de la même manière que celles qui ont été complètement vaccinées avec des vaccins ARNm. Cette mesure a été mise en œuvre, par exemple, dans le cadre du certificat Covid de l'UE, mais pas dans des pays comme les États-Unis [6,7] .
Cette étude concerne la protection liée à une « primo infection » par les variants Alpha Beta et Delta. Le manque de données sur la protection conférée par une infection antérieure par le variant omicron BA.1 et ses sous-lignées (BA.2, BA.4 et BA.5) souligne l'importance d'une évaluation continue, en particulier si l'on considère qu'environ 46 % de la population mondiale a été infectée par le variant omicron entre le 15 novembre 2021 et le 1er juin 2022.
Pr Dominique Baudon




