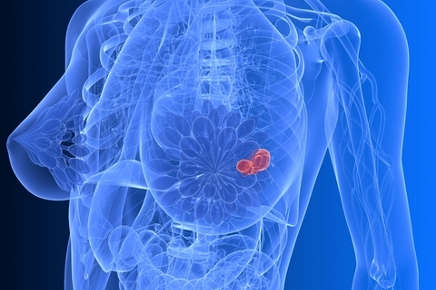
Au cours des dernières décennies, les taux de survie après un cancer du sein ont augmenté partout dans le monde. Le dépistage systématique reste considéré comme l’un des acteurs de cette amélioration du pronostic, bien que des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent contre cette interprétation. Le rôle favorable des nouveaux protocoles thérapeutiques ne fait quant à lui plus aucun doute. Mais à l’ère des nouvelles thérapies systémiques, l’on peut se demander si les traditionnels facteurs, tels que la taille de la tumeur ou le nombre de ganglions positifs, gardent encore une quelconque valeur pronostique et si oui, dans quelle mesure.
Comparaison de 2 cohortes de patientes traitées avant ou après l’ère des thérapeutiques modernes
Pour répondre à ces questions, une équipe hollandaise a réalisé une étude prospective, basée sur les données de leur registre national des cancers. Ces auteurs ont recueilli les données de près de 174 mille femmes chez lesquelles un cancer du sein avait été diagnostiqué entre 1999 et 2012 et les ont divisées en 2 cohortes (1999-2005 et 2006-2012) dont ils ont comparé la survie.
Les patientes de la cohorte la plus récente avaient des tumeurs de plus petite taille (≤ T1 : 65 % vs 60 %) et une absence plus fréquente d’envahissement ganglionnaire (N0 : 68 % vs 65 %). Elles ont plus souvent été traitées par chimiothérapie, hormonothérapie ou thérapie ciblée (traitement néo-adjuvant/ traitement systémique 60 % vs 53 %). Le taux moyen de survie relative à 5 ans est de 96 % pour cette cohorte, comparée à 91 % pour celle des années précédentes et est en progression pour toutes les tumeurs et les stades ganglionnaires. Notons que les femmes de plus de 75 ans, non incluses dans le dépistage systématique, connaissent aussi une amélioration très significative de la survie, qui passe de 83 % pour la première période à 91 % ensuite.
Taille plus importante de la tumeur et envahissement ganglionnaire augmentent toujours la mortalité sauf pour les stades T1b et T1a
En analyse multivariée, ajustée pour l’âge et le type de tumeur,
la mortalité totale est réduite par la chirurgie, la radiothérapie
et les thérapies systémiques. Dans les deux cohortes, la mortalité
augmente avec la taille de la tumeur et
le stade d’envahissement ganglionnaire, excepté pour le stade T1b
vs T1a, deux stades pour lesquels la survie à 5 ans est de 100
%.
Bien que le stade tumoral soit en général plus favorable pour les cancers diagnostiqués entre 2006 et 2012, les patientes concernées ont reçu plus souvent des thérapies systémiques (néo)adjuvantes, réduisant, en analyse multivariée, le taux de mortalité de 14 %. En revanche, le statut HER2 positif ne semble plus associé à la survie totale. Les auteurs expliquent cela par l’efficacité du trastuzumab qui, utilisé couramment dans les tumeurs de plus de 1 cm, rendrait négligeable l’effet du HER + sur la survie.
La taille de la tumeur au moment du diagnostic et l’existence ou non d’un envahissement ganglionnaire gardent donc encore une influence significative sur le pronostic, indépendamment de la nature tumorale, et malgré les avancées importantes dans les prises en charge thérapeutiques. Les auteurs ne manquent pas de plaider pour un diagnostic à un stade précoce, sans toutefois évoquer le dépistage systématique de masse ni le risque de surdiagnostic qui lui est associé.
Dr Roseline Péluchon




