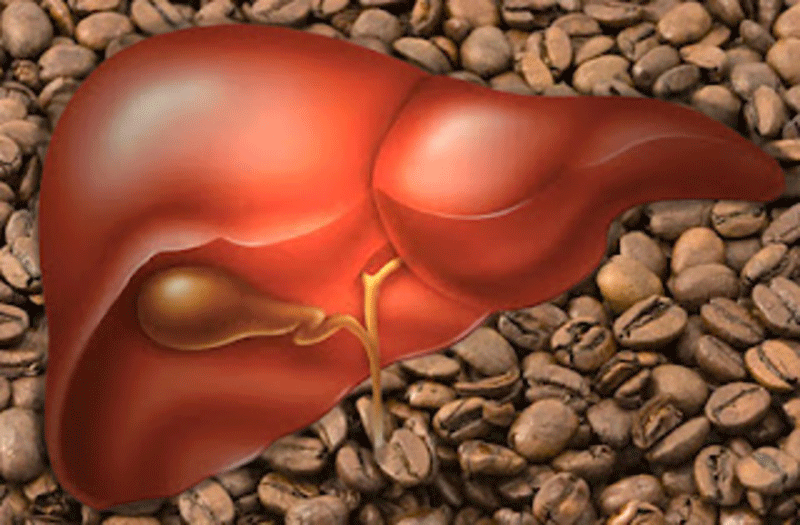
L’augmentation rapide au cours des dernières années de l’incidence de la stéatose hépatique non alcoolique (NASH) devrait avoir pour corollaire une augmentation de l’incidence des hépatocarcinomes. Certains auteurs projettent d’ici 2030 une augmentation de 50 % des nouveaux cas dépistés chaque année. De précédents travaux ont attiré l’attention sur un impact possible de la consommation de café sur le risque d’hépatocarcinome. Les résultats d’une méta-analyse sur ce sujet, publiée récemment, méritent que l’on s’y attarde.
Les auteurs ont réalisé une revue de la littérature concernant le lien entre la consommation de café, en incluant les boissons décaféinées, et l’hépato-carcinome. Au total 18 cohortes ont été retenues, incluant au total plus de 2 millions de personnes, parmi lesquels 2 905 patients ont présenté un hépato-carcinome. Huit études cas-contrôle ont aussi été incluses, avec au total 1 825 cas et 4 652 témoins.
Réduction du risque de moitié avec 5 tasses
S’ils en manquaient, les amateurs de café trouveront dans ces résultats de bons arguments pour assouvir leur penchant. Il apparaît en effet une association significative entre la consommation de café quotidienne et une réduction du risque d’hépato-carcinome. La réduction du risque est de 35 % (Hazard Ratio [HR] 0,65 % ; intervalle de confiance à 95 % IC 0,59 à 0,72) à partir de 2 tasses et, dans certaines études, dépasse 50 % à partir de 5 tasses par jour. Ces résultats ne sont pas modifiés par la présence ou le stade d’une éventuelle insuffisance hépatique, par la consommation d’alcool, un indice de masse corporelle élevé, un diabète de type 2, le tabagisme, ou une hépatite virale B ou C.
Quant à ceux qui craignent les effets excitants de la caféine, qu’ils se rassurent : les études dans lesquelles le type de café consommé est précisé (avec caféine ou décaféiné) montrent que la relation persiste, bien que moins significative, avec le seul café décaféiné (HR 0,86 ; IC 0,74 à 1,00).
De précédents travaux expliquaient ce lien inverse entre consommation de café et hépatocarcinome par une action de certains composants du café au cours du processus d’installation de la cirrhose. Cette étude semble contredire en partie cette hypothèse, puisque la réduction du risque existe ici même quand la cirrhose est préexistante. Les auteurs évoquent de possibles propriétés anticancéreuses de certains composants du café, parmi lesquels la caféine, l’acide chlorogénique ou les diterpènes.
Prudence toutefois avant de se précipiter vers la machine à café, d’autres travaux récents ayant suggéré un lien entre le café et le cancer du poumon ou les fractures osseuses ou encore un lien possible entre le café et l’augmentation du taux de cholestérol.
Dr Roseline Péluchon




