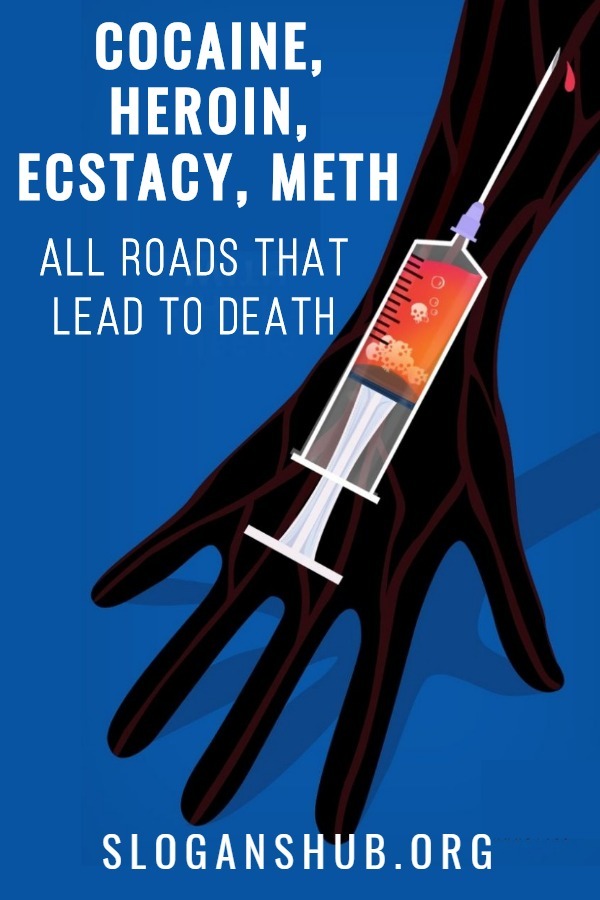
Paris, le samedi 17 août 2019 – Présentant il y a une dizaine
de jours le budget du nouveau Fonds de lutte contre les addictions,
le ministre de la Santé a signalé dans un communiqué l’importance
de cet enjeu de santé publique en rappelant que « Chaque année
en France le tabac tue 75 000 personnes, l’alcool 41 000 personnes
et les drogues illicites 1 600 ». Ce dernier chiffre aurait
suscité la circonspection de quelques spécialistes de la lutte
contre les addictions, circonspection rapportée par le médecin et
blogueur Jean-Yves Nau. « D’où sort ce chiffre ? demanda l’un
des meilleurs cliniciens (…) de la lutte contre les addictions.
"Quelqu’un a-t-il la référence". Aucune référence donnée par un
ministère en vacances post-caniculaire. Un autre spécialiste (…)
renvoya vers les derniers travaux de l’Observatoire français des
drogues et des toxicomanies ». Or, dans leur dernier rapport
publié début juillet sur le sujet, les spécialistes de l’OFDT
relèvent que « la mesure du nombre de décès directement liés aux
drogues (DDLD) et de son évolution s’avère complexe. Il est
possible néanmoins d’affirmer qu’il est au minimum de 537 en 2017
et de conclure à une nette tendance à l’augmentation des DDLD entre
2000 et 2015 ».
L’ANPAA aussi
Dès lors, comment comprendre le chiffre de 1 600 avancé par le
ministère ? L’Avenue de Ségur est loin d’être la seule à s’y
référer : on le retrouve dans de nombreuses communications aussi
sérieuses concernant la lutte contre la toxicomanie. Ainsi, dans un
communiqué de 2017, l’Association nationale de prévention de
l’alcoologie et des addictions (ANPAA) écrivait elle aussi que «
la consommation de substances psychoactives, licites et
illicites, est à l’origine, chaque année en France, de près de 130
000 décès prématurés, dont 79 000 liés au tabac, 49 000 à l’alcool
et 1 600 aux drogues illicites ».
Un chiffre souvent repris
La reprise de ce chiffre suggère que l’ANPAA et le ministère
de la Santé ont probablement les mêmes sources (voire que l’ANPAA
est peut-être une des sources du ministère). Il faut dire que de
façon rapide on peut aussi retrouver ce chiffre dans la revue La
Santé en Action éditée par Santé publique France (SPF), comme par
exemple dans son n°440 où les auteurs relèvent en introduction d’un
article dédié à la consommation de substances psychoactives dans
les DOM « L’impact sanitaire des drogues illicites apparaît en
regard bien inférieur (1 600 décès imputables à la consommation de
drogues illicites en 2010) » et renvoie comme source à
l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (un rapport
publié en 2015 sur Le coût social des drogues en France qui met en
effet en avant ce chiffre).
Décès directs et indirects
De la même manière, la revue trimestrielle du Haut conseil de
la santé publique (HCSP) dans son numéro 95 (juin 2016) précise : «
Chaque année, on compte environ 1 600 décès attribuables aux
drogues illicites (…) principalement imputables aux opiacés ».
Cette analyse permet cependant pour sa part de mieux comprendre le
décalage que l’on observe entre les chiffres donnés par la dernière
revue de l’OFDT et ce nombre de 1 600 si souvent mis en avant. «
Sur dix décès, six sont liés à des complications chroniques
consécutives à une infection par le VIH (1 000), deux à une surdose
(300) et deux à un accident de la route en présence de cannabis
(230) ou un cas de sida lié à l’usage de drogues par voie
intraveineuse (75) ». Ainsi, peut-on supposer que c’est le
choix de retenir ou pas certaines complications qui crée une
différence majeure entre ce chiffre de 1 600 et les 537 DDLD
évoqués en juillet par l’OFDT et qui auraient plus certainement
retenus l’attention des spécialistes de l’addiction. D’ailleurs,
les auteurs de l’OFDT consacraient une large partie de leur étude à
évoquer les problèmes de terminologie qui entraînent autant de
distorsions dans les chiffres. Ils ont choisi pour leur part de ne
retenir que les décès assimilables à des surdoses (relevant même
que l’introduction dans ce cadre des décès survenant peu de temps
après la consommation de produits illicites mais non
doses-dépendants chez des patients présentant des facteurs de
risque cardiovasculaires peut être sujet à discussion).
Comme pour l’alcool
Aurélie Haroche




