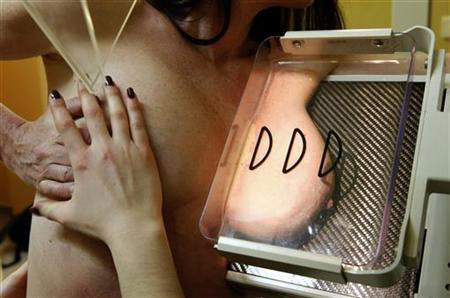
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers non cutanés chez la femme. Il représente, aux USA, la seconde cause de mortalité avec 40 000 décès annuels. La pratique de mammographies de dépistage a démontré son utilité pour réduire la mortalité spécifique mais peut aussi entrainer des effets délétères. En 2009, l’US Preventive Services Task Force (USPSTF) a mis à jour, en direction notamment des femmes jeunes, ses précédentes recommandations qui, on le rappelle, préconisaient un dépistage débutant à 40 ans, effectué tous les 1 à 2 ans en fonction des données personnelles, puis un dépistage de routine bi annuel à partir de 50 ans. A ce jour, de nombreuses controverses subsistent et les recommandations les plus récentes de l’USPSTF ne paraissent pas avoir été complètement intégrées en pratique quotidienne.
L E Pace et N L Keating, dans un travail publié dans le JAMA d’Avril 2014 ont rassemblé les preuves témoignant du gain en terme de mortalité spécifique qu’apporte la pratique du dépistage par mammographies itératives, ont ensuite rappelé les principaux aléas de la méthode et ont étudié les moyens pouvant aider utilement à la prise de décisions, via notamment une meilleure information. Les auteurs se sont appuyés sur une sélection d’essais contrôlés randomisés (ECR) et de méta-analyses référencés dans MEDLINE depuis 1960 jusqu’à Janvier 2014. L’investigation informatique a été complétée par une recherche manuelle d’articles clés, de revues choisies, de méta-analyses particulières et de recommandations pratiques précédemment publiés.
Une réduction de la mortalité spécifique de 19 % grâce au dépistage
Entre et 1990, 8 ECR de grande ampleur ont évalué l’impact du dépistage sur la mortalité spécifique par cancer du sein. Une méta-analyse a permis de chiffrer entre 15 et 20 % la diminution du risque. Ces travaux sont toutefois anciens et difficilement transposables à la situation actuelle du dépistage. Deux méta-analyses plus récentes ont été publiées en 2013. Celle de la Canadian Task Force a confirmé le gain induit par la mammographie avec un risque relatif (RR), au terme de 11,4 ans de suivi médian, abaissé grâce au dépistage à 0,81 (pour un intervalle de confiance, IC, à 95 % compris entre 0,74 et 0,85). Une revue Cochrane, reprenant 3 ECR de bonne qualité a situé le RR à 0,90 (IC : 0,79- 1,02). Ces résultats positifs s’opposent à ceux de 2 essais publiés en 2014 qui, après un suivi particuliérement prolongé de 25 ans, n’ont décelé aucune différence significative de mortalité (RR : 1,05; IC: 0,88- 1,82). En 2009, l'USPSTF estimait que 1 904 femmes entre 39 et 49 ans devaient être dépistées pour prévenir un cancer du sein et 377, entre 60 et 69 ans.
Sur 10 000 femmes âgées de 50 ans ou plus bénéficiant d’un dépistage annuel, il a pu également être calculé que 302 d’entre elles vont développer un cancer du sein invasif ou un carcinome canalaire infiltrant in situ, que 56 à 64 vont mourir de leur cancer malgré la mammographie et que environ 30 à 32 décès pourront être prévenus grâce au dépistage. Il en résulte que le dépistage par mammographie est associé à une réduction globale de 19 % de la mortalité spécifique, plus précisément de 15 % pour les femmes dans la quarantaine et de 32 % pour celles de 60 ans et plus.
Beaucoup de faux positifs et un taux de surdiagnostics difficile à estimer
Les dangers du dépistage sont, essentiellement, des résultats faussement positifs et des surdiagnotics. Les faux positif, source d’anxiété, entraînent la pratique d’autres examens complémentaires, tels qu’une nouvelle imagerie et/ ou des biopsies qui viendront finalement infirmer le diagnostic initial. On estime entre 7,0 % et 9,8 % le pourcentage de femmes qui, après 10 ans de dépistage, font l’expérience d'une biopsie non nécessaire. Une analyse récente du Breast Cancer Surveillance Consortium estime que le risque cumulé à 10 ans de faux diagnostics culmine à 61,3 % chez les femmes ayant débuté le dépistage entre 40 et 50 ans et se situe à 49,7 % chez celles, entre 66 et 74 ans avec un dépistage annuel. En d’autres termes, sur 10 000 femmes de plus de 50 ans dépistées annuellement, 6 130 (IC: 5800- 6470) auront au moins une fois dans leur vie un résultat faux positif. Le risque augmente d’autant que le dépistage est mis en route précocement et qu’il est annuel, d’où les recommandations de l'USPSTF de 2009 en faveur de la pratique d’un examen tous les 2 ans chez les femmes entre 50 et 74 ans.
Le sur diagnostic correspond à la découverte d’une tumeur qui ne se serait jamais manifestée cliniquement en l’absence de dépistage, du fait d’une évolution particuliérement indolente ou de l’existence de co morbidités et/ ou d’un âge avancé réduisant l’espérance de vie. Ce risque concerne avant tout les cancers canalaires infiltrant in situ mais aussi certains cancers invasifs. La patiente subit alors des traitements actifs en toute inutilité. L’amplitude du risque de sur diagnostic est difficile à établir; seule une étude des survies à très long terme de patientes dépistées et d’autres non dépistées pourrait amener à une estimation satisfaisante. Une méta analyse a chiffré ce risque à 19 % de l’ensemble des cancers dépistés mais avec une méthodologie rendant la généralisation des résultats très incertaine. Dans la littérature mondiale, les valeurs avancées sont éminemment variables, allant de moins de 5 % à plus de 50 %. Approximativement, sur 10 000 femmes de plus de 50 ans passant une mammographie par an, le nombre de surdiagnostics oscillerait entre 30 et 137, avec une moyenne à 57 sur 302 cancers détectés (soit 19 %).
Un dépistage en fonction du risque individuel mais aussi du choix des patientes ?
Aux USA, le risque de cancer du sein, vie entière, se situe à 12,3 %. Plusieurs modèles existent pour quantifier ce risque, le plus utilisé étant celui de Gall qui inclut divers paramètres : âge aux premières règles et au premier enfant, antécédents familiaux de cancer du sein, nombre de biopsies effectuées, présence d’une hyperplasie atypique. Ce modèle fait toutefois l’objet de nombreuses réserves, car il ne prend pas en compte notamment la densité mammaire et reste difficilement applicable dans certains sous groupes. Il est surtout utile pour apprécier l’incidence des cancers du sein dans une population bien identifiée mais est de moindre valeur dans les cas individuels. Une étude comparative a été menée à partir de 4 micro modèles. Elle révèle que les femmes entre 40 et 49 ans dont le risque de base est doublé, avec un dépistage tous les 2 ans, ont un rapport bénéfices/ risques identique à celui de femmes de plus de 50 ans, de risque moyen, ayant une mammographie tous les 2 ans.
La décision d’effectuer ou non un dépistage par mammographie doit être prise après avoir considéré le rapport bénéfices/ risques mais aussi les incertitudes, les autres possibilités et les préférences de la patiente. Quelle que soit leur forme, des aides à la décision sont utiles, améliorant le degré de connaissance et pouvant diminuer l’anxiété. Un ECR récent, sur une cohorte de femmes âgées de 38 à 45 ans tend à montrer que le groupe ayant bénéficié d’une information préalable a effectivement plus de notions sur la mammographie mais, en contre partie, pourrait être enclin à moins pratiquer le dépistage.
En résumé, le dépistage par mammographie contribue de façon certaine, quoique modeste, à diminuer la mortalité du cancer du sein. Les effets secondaires, dont les risques de faux diagnostics positifs et de surdiagnostics sont à connaitre. Le bénéfice net d’un dépistage annuel est d’autant plus faible que la femme est plus jeune et que ses facteurs de risque sont minimes. Les recommandations des principales agences tant américaines qu’européennes sont d’un apport réduit pour guider une prise de décision individuelle. Elles doivent être confrontées aux choix et aux préférences personnels. La modélisation des risques et les aides à la décision peuvent être utiles mais sont souvent, en pratique, insuffisantes. La recherche future devra tenter d'explorer d’autres stratégies de dépistage des cancers du sein.
Dr Pierre Margent




