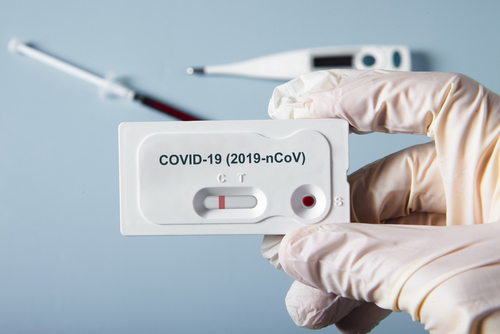
Une innovation australienne repérée très vite par les Américains
Tout n’a pas commencé le 1er février 2021 quand les Etats-Unis annoncent avoir passé un contrat de 230 millions de dollars avec la société australienne Ellume pour la fabrication d’autodépistages rapides de l’infection par SARS-CoV-2. Parallèlement, le Premier ministre britannique, Boris Johnson indique avoir entamé des discussions avec l’entreprise spécialisée dans les autodiagnostics. Tout n’avait même pas commencé le 17 décembre quand la Food and Drug Administration déclare délivrer une autorisation en urgence pour la commercialisation d’un autotest digital et que ce feu vert permet aux USA d’espérer la livraison de 100 000 tests par jour dans les semaines à venir. Tout avait commencé plusieurs mois auparavant quand aux premières heures de l’épidémie, le docteur Sean Parsons, patron de l’entreprise Ellume connue pour avoir développé des autotests de dépistage de la grippe, décide d’adapter son dispositif à SARS-CoV-2. Il obtient pour ce faire un soutien de 31 millions de dollars d’agences gouvernementales américaines. Rapidement le système est au point. Il s’agit d’un test antigénique dont les résultats sont obtenus en une vingtaine de minutes. Le prélèvement est nasal, mais l’écouvillon est bien plus court que ceux utilisés en routine pour les PCR ou les tests antigéniques de dépistage. Le bâtonnet est ensuite mis en contact avec un réactif et inséré dans un boîtier. Le rayonnement fluorescent obtenu en cas de présence des antigènes du virus est détecté par un nanocristal. La lecture est réalisée grâce à une application et les résultats sont envoyés par Bluetooth à un système internet sécurisé. Les données sur lesquelles se sont appuyées la FDA pour approuver le test Ellume signalent une sensibilité de 96 % et une spécificité de 100 % (mais dans des conditions de réalisation optimales).Réticence en France
La France n’a nullement ignoré ces différents développements et d’une manière générale les travaux autours des autotests. Cependant, au printemps, la Haute autorité de Santé (HAS) se montre quasiment catégorique. Elle juge prématuré l’emploi en routine des autotests. Les performances de ces derniers sont alors considérées comme trop incertaines. Surtout, la HAS note que l’interprétation du résultat pourrait être délicate. « Sans accompagnement, le patient prend le risque de tirer des conclusions erronées de ce test », insiste-t-elle. Cependant, en octobre, à la veille d’une « seconde vague », le Président de la République Emmanuel Macron évoque les innovations concernant le dépistage et s’enthousiasme : « On continue à innover pour aller vers des autotests, où sur la base de votre salive, parfois de votre sang, vous pourrez vous autotester ». Cette volonté politique laissait-elle espérer que la France se montrerait très réactive pour s’emparer des nouveaux dispositifs ?*Des discussions à prévoir
Il n’est pas difficile de prédire la longue liste des obstacles qui pourraient faire que la France connaisse le sort que nous évoquons dans notre premier paragraphe d’anticipation (et de mauvaise foi !). Les résultats concernant la sensibilité et la spécificité seront discutés. « Il existe à ce jour très peu de données scientifiques sur les performances des autotests pour le diagnostic du COVID-19 en vie réelle » avait remarqué au printemps la HAS. Face à ces arguments, les spécialistes enthousiastes s’emporteront. « Toutes les méthodes de tests sont bonnes à prendre», remarquait ainsi, interrogé sur ce sujet le mois dernier par le Figaro, Philippe Froguel, professeur à l'Imperial College à Londres et à l'université Lille-2. Mais le gouvernement temporisera : aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, l’organisation du dépistage est très différente, suscitant des engorgements des laboratoires, qui aujourd’hui n’existent plus en France, tandis que les tests antigéniques accessibles gratuitement en pharmacie permettent de répondre aux situations d’urgences ou aux besoins de vérification.Un parcours semé d’embûches
Cependant, les impatients continueront à s’impatienter. Hier, sur LCI, le docteur Martin Blachier et l’économiste Nicolas Bouzou s’inquiétaient de deviner un défaut de volonté politique qui pourrait priver la France de ce nouvel outil de lutte contre l’épidémie. Alors, d’autres arguments seront opposés. On s’inquiétera des difficultés d’utilisation, on mettra en avant l’impossibilité d’assurer le traçage des cas positifs et on s’interrogera sur l’attitude de ceux qui se découvriront infectés par le virus. Chercheur en immuno-oncologie et membre du collectif Du Côté de la science, interrogé par Yahoo.fr sur les autotests en général (notamment les autotests salivaires), Eric Billy nuançait il y a quelques semaines la portée de cet argument en donnant l’exemple du milieu professionnel : « Je doute fortement qu’un chef d’entreprise dise à un de ses employés positif de rester au bureau et de risquer de contaminer les autres. Et si c’est vraiment ça la crainte, rien n’empêche de mettre en place un système informatique qui garantisse le suivi ». Rien n’empêche si ce n’est la nécessité de mettre en place des gardes fous stricts pour assurer la sécurité des données, répondront les autorités. D’ailleurs, déjà, la Direction générale de la santé remarque « Il n’y a pas de traçabilité des résultats obtenus par autotests ». Imaginons que l’on vienne enfin à bout de ces différents écueils, que l’on dépasse les multiples problèmes juridiques (peut-on contraindre quelqu’un à s’autotester ?) et les pressions de différents groupes professionnels, demeurera la question du prix : aux Etats-Unis, l’autotest Ellume sera commercialisé (y compris dans les supermarchés… encore un point qui sera sans doute très discuté en France !) autour de 25 euros. Face à un tel budget, beaucoup se montreront sans doute inquiets en France et de nouvelles discussions sont à prévoir.Le triste exemple des tests salivaires
Vous refusez de croire à cet article pessimiste
d’anticipation. D’autres fins alternatives sont en effet possibles
: le test ne répond nullement à ses promesses et très vite les pays
qui avaient cru à ce miroir aux alouettes l’abandonnent constatant
les très nombreux faux négatifs, les difficultés d’utilisation et
autres problèmes. Ou dans une autre uchronie : Emmanuel Macron
annonce le 4 février, non pas un reconfinement mais un partenariat
spécial avec Ellume et une production en France avec un rendement
promis de 5 millions de tests par semaine fabriqués en septembre.
Cependant, pour se convaincre que la réalité pourrait rejoindre la
science-fiction, il est possible d’observer la lenteur avec
laquelle la France a enfin approuvé le système de dépistage par
RT-PCR à partir de prélèvements salivaires (EasyCov). Un avis
positif a enfin été rendu le 22 janvier par la HAS. Cependant, le
déploiement pourrait encore prendre plusieurs semaines. « Nous
devons préparer et accompagner la mise en œuvre et proposer des
schémas d’organisation applicables avant tout déploiement à large
échelle », explique Lise Alter, directrice de l’évaluation
médicale, économique et santé publique à la HAS citée par Le
Monde. On parle d’une éventuelle expérience pilote en
février.
D’autres pays sont loin d’avoir attendus aussi longtemps et la
praticité du prélèvement salivaire (en autotest ou non, pour une
analyse RT-PCR ou antigénique) est à l’origine notamment de
différentes campagnes dans le cadre scolaire. Ce matin, sur RTL
Belgique, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a
indiqué le probable prochain déploiement de tests récurrents du
personnel enseignant via des tests salivaires (bien plus simples à
mettre en œuvre et bien plus facilement acceptables). A quand en
France ?
*A Tahiti, l'audace n'a pas attendu : depuis début septembre
les voyageurs arrivant en Polynésie reçoivent systématiquement un
kit d'auto-prélèvement : ils se doivent de le renvoyer quatre jours
après. Ici, les questions sur la faisabilité ont vite été écartées.
Et dans plus de 95 % des cas, les kits sont bien renvoyés à
l'Institut chargé de procéder à l'analyse par RT-PCR.
Aurélie Haroche




