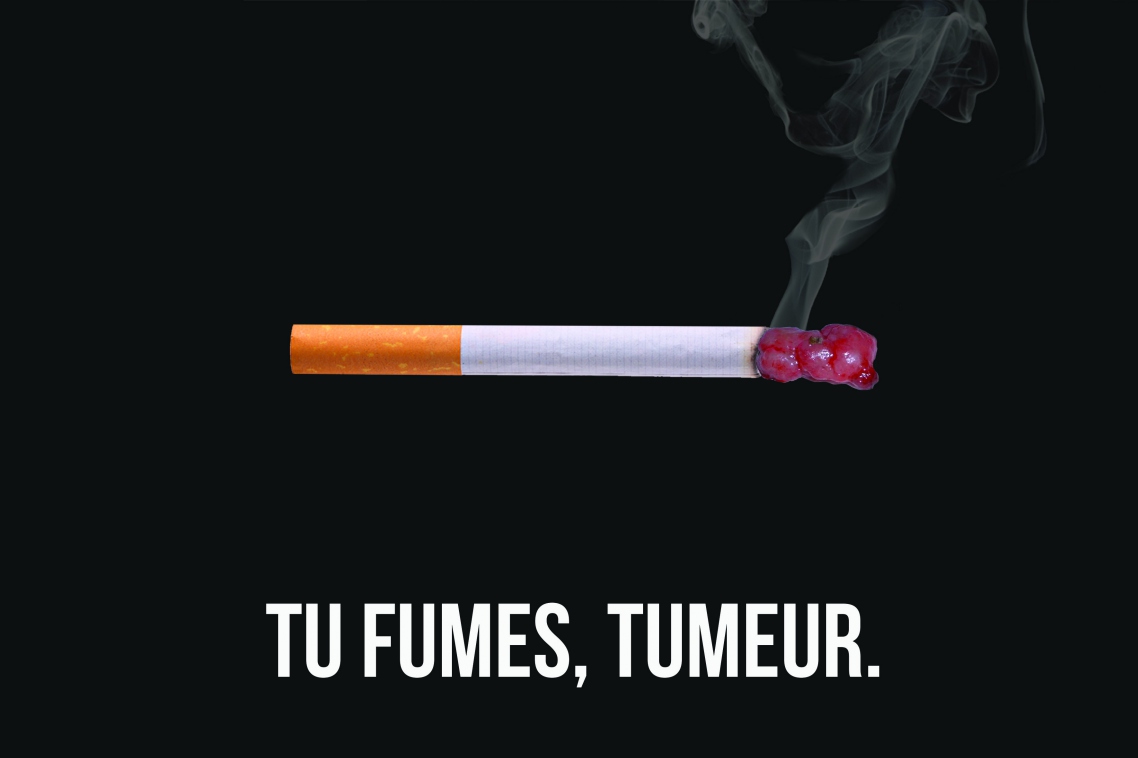
L'un des principaux combats à mener pour endiguer le tabagisme est de lutter contre l’ignorance. En dépit en effet de la systématisation des messages de prévention sur le sujet et de la dégradation certaine de l’image du tabac, trop nombreux sont encore ceux qui sous-estiment ses méfaits. Cette constatation concerne notamment les complications cardiovasculaires provoquées par la cigarette et les autres produits du tabac, thème central de la journée mondiale.
Des connaissances fumeuses
L’OMS rappelle ainsi qu’ « une enquête réalisée en Chine en 2009 a montré que, dans ce pays, respectivement 38 % et 27 % seulement des fumeurs savent que le tabac provoque des cardiopathies coronariennes et des accidents vasculaires cérébraux ». En France, une enquête commandée cette année par la Fédération française de cardiologie à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes avait mis en évidence que ces dernières « ne sont que 28 % à citer spontanément l’arrêt du tabac ou la limitation de sa consommation comme moyen de se protéger des maladies cardiovasculaires ». D’autres études rendent compte des mécanismes en jeu associant défaut de sensibilisation et précarité sociale, précarité sociale qui est, par ailleurs, un facteur de risque de tabagisme. Ainsi, le dernier Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) publie des travaux de Santé publique France sur l’émergence des inégalités sociales qui permettent d’observer que par rapport aux adolescents et adolescentes scolarisé(e)s dans l’enseignement général, ceux qui suivent un enseignement technique ou professionnel ont « en moyenne moins peur des conséquences du tabac ».Des stratégies pas parfaitement appliquées
Face à cette situation, de véritables stratégies doivent être mises en place, qui sont encore insuffisantes à l’échelle mondiale. Elles s’orientent autour de six axes : la surveillance de la consommation, la protection de la population (à travers les interdictions de fumer), l’aide au sevrage, la prévention, la fin de la publicité et l’action sur les taxes. Ces objectifs ne sont pas encore unanimement suivis. Par exemple, « Des services complets d’aide au sevrage, dont le coût est intégralement ou partiellement pris en charge, ne sont disponibles pour aider les fumeurs à cesser de fumer que dans 24 pays, représentant 15 % de la population mondiale ». Le plus souvent, ce sont les pays pauvres (ou l’on compte aujourd’hui le plus grand nombre de fumeurs) qui tardent le plus à développer des stratégies efficaces contre le tabac. Ainsi, « il n’existe aucune aide au sevrage dans un quart des pays à revenu faible ». Cependant, certaines exceptions existent. Ainsi, concernant l’adoption du paquet neutre arborant une image dissuasive, les pays pauvres ou à revenus intermédiaires font figure de leaders.Une France en dents de scie
En France, la lutte contre le tabac a traversé différentes phases. Des efforts très importants ont été réalisés depuis les années soixante-dix pour transformer l’image du tabac et réduire la place de la cigarette dans la société. Des législations encadrant strictement la publicité, interdisant de fumer dans les espaces publics, augmentant le prix des cigarettes ont été adoptées avec succès. Cependant, l’élan s’est essoufflé au début des années 2000 (avec notamment une politique fiscale qualifiée « d’erratique » par les spécialistes) et une stagnation du nombre de fumeurs a été déplorée. Ces dernières années ont cependant permis de renouer avec une politique volontariste dont les premiers effets sont visibles, comme le signalent différents chiffres présentés par le BEH.Tous les indicateurs en vert
On comptait ainsi en 2017 un million de fumeurs quotidiens en moins selon les données du baromètre de Santé publique France. Ainsi, la prévalence du tabagisme quotidien est-elle passée de 29,4 % à 26,9 % en 2017. La tendance est la plus forte chez les jeunes hommes de 18 à 24 ans pour lesquels la baisse a atteint neuf points (la même évolution n’apparaît pas chez les jeunes femmes). De nombreux autres signaux positifs s’observent. Il apparaît tout d’abord que le recul concerne également l’entrée dans le tabagisme, avec une proportion de personnes n’ayant jamais fumé passant de 34,3 % à 37,1 % entre 2016 et 2017. On relève encore une augmentation des ventes de traitements d’aide au sevrage tabagique (+28,5 %), tandis que le Baromètre permet d’estimer à deux millions le nombre de personnes ayant tenté d’arrêter de fumer (ne serait-ce que vingt-quatre heures) en 2017. Autre signe marquant, la diminution de la prévalence du tabagisme concerne prioritairement les personnes dont les niveaux de diplômes et les revenus sont les plus faibles. C’est la première fois depuis 2000 que la prévalence du tabagisme quotidien diminue parmi les fumeurs les plus défavorisés (elle est passée de 49,7 % à 43,5 % chez les sujets au chômage) et que les inégalités en matière de consommation de tabac ne se creusent pas.Mois sans tabac : un tabac !
Ces évolutions encourageantes, même si la France continue à
connaître une prévalence du tabagisme plus élevée que beaucoup de
pays d’Europe (elle n’est par exemple que de 16 % en
Grande-Bretagne) portent la marque des actions du Programme
national de réduction du tabagisme (2014-2019) dont un des
objectifs est de compter moins de 20 % de fumeurs en 2024.
Concernant cette opération, plusieurs données suggèrent une efficacité certaine. Ainsi, « Près d’un fumeur quotidien sur six (15,9 %) a déclaré avoir fait une tentative d’arrêt au dernier trimestre 2016, et 18,4 % d’entre eux ont déclaré qu’elle était liée à Mois sans tabac, ce qui représente environ 380 000 tentatives d’arrêt liées à Mois sans tabac » relèvent ainsi dans le BEH des chercheurs de Santé publique France.
Prix : mettre le paquet !
Si les premières impulsions du programme national voient donc leurs premiers fruits, d’autres mesures fortes adoptées plus récemment sont également prometteuses de résultats, tels le remboursement des substituts nicotiniques au même titre que les médicaments et la hausse du prix du tabac, pour atteindre 10 euros en 2020.Concernant cette augmentation essentielle, des experts de
l’Institut Gustave Roussy et de l’Université Paris Saclay font
remarquer dans le BEH que « La politique annoncée (…) est
ambitieuse, mais les paramètres qui ont servi à en estimer les
conséquences sont optimistes. Le gouvernement prévoit une
élasticité de -0,75 (…) alors que l’élasticité observée dans le
passé n’a jamais été inférieure à -0,5. De plus le gouvernement
prévoit un transfert complet des augmentations des taxes sur le
prix de vente, mais le passé nous montre que l’industrie du tabac
ne procède jamais de cette manière ». Aussi, les auteurs
concluent qu’il sera probablement nécessaire de « renforcer la
politique fiscale pour arriver au prix de 10 euros pour 20
cigarettes fin 2020 et poursuivre cette politique au-delà de 2020
si on veut réduire considérablement la consommation de tabac ».
Ils insistent également sur la nécessité de revenir sur les
exceptions qui prévalent encore en Corse. Enfin, la lecture des
différentes études du BEH met en évidence que les actions à adopter
parallèlement sont très diverses. Concernant par exemple les plus
jeunes, la nécessité de renforcer le respect de l’interdiction
d’achat de cigarettes avant 18 ans s’impose : il apparaît en effet
aujourd’hui que la majorité (94,5 %) des jeunes de 17 ans
parviennent sans aucune difficulté à se procurer des cigarettes
dans les débits de tabac. Des messages plus clairs concernant la
toxicité comparable du tabac à rouler apparaissent également
souhaitables.
Bulletin épidémiologique hebdomadaire :
http://invs.santepubliquefrance.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Archives/2018/BEH-n-14-15-2018
Aurélie Haroche




