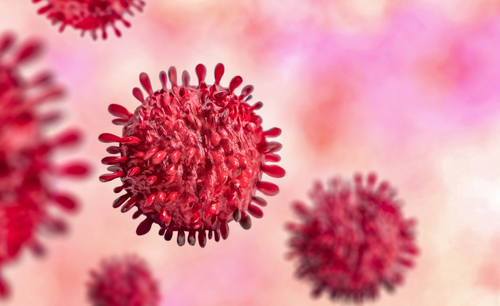
L’hypogammaglobulinémie acquise est fréquente chez les patients atteints de tumeurs malignes à lymphocytes B, telles que la leucémie lymphoïde chronique (LLC), le lymphome non hodgkinien (LNH) ou encore le myélome multiple (MM). Ces affections sont donc associées à un déficit immunitaire multifactoriel imputable à la maladie sous-jacente, à son traitement ou aux deux facteurs intriqués. Les stratégies visant à prévenir le risque infectieux dans un tel contexte sont importantes pour diminuer la mortalité, d’un part, et pour améliorer la qualité de vie d’autre part.
Les moyens de ces stratégies restent limités et se résument à : l’administration prophylactique d’immunoglobulines, la vaccination et l’antibiothérapie. Leur efficacité relative est au demeurant mal connue, compte tenu de leur utilisation variable dans la pratique médicale courante. Les données de la littérature internationale médicale ont fait l’objet de revues et d’analyses déjà anciennes portant sur des études réalisées dans les années 80 et 90. La situation a évolué depuis avec l’émergence de thérapies ciblées visant les lymphocytes B ou les plasmocytes, au point de contribuer également à l'hypogammaglobulinémie.
Une revue de la littérature médicale récente
Dans ce contexte, une revue systématique de la littérature internationale couplée à une méta-analyse permet de dresser un état des lieux conforme aux périls infectieux qui ont changé de visage depuis la pandémie de Covid-19.
Les bases de données PubMed (MEDLINE), EMBASE et Cochrane Registry ont été consultées jusqu'au 9 janvier 2021. L’objectif a été d’évaluer le rapport acceptabilité/efficacité des trois stratégies préventives précédemment évoquées chez des patients atteints d’une LLC, d’un LNH ou encore d’un MM. Les résultats de la méta-analyse à effets aléatoires ont été exprimés et regroupés sous la forme de risques relatifs (RR) assortis de leurs intervalles de confiance (IC) à 95 %.
Sur les 10 576 publications identifiées, seuls 22 essais contrôlés ont été retenus (dont un en cours donc non exploitable) et inclus dans la méta-analyse. Parmi ceux-ci, huit se sont attachés à évaluer l’efficacité des immunoglobulines prophylactiques (n = 370 patients ; 7 publiés avant 2000), cependant que cinq autres ont évalué l’antibiothérapie prophylactique (n = 1587). Sept autres études (n = 3996) se sont intéressées à la vaccination et un seul essai (n=60) a comparé immunoglobulines et antibiotiques.
Peu d’études concluantes
De cette analyse, il ressort que les immunoglobulines utilisées à titre prophylactique ont réduit le risque d'infection cliniquement documentées de 28 % (n = 2 essais ; RR, 0,72 ; IC 95 %, 0,54-0,96). La vaccination a fait mieux en réduisant ce risque de 63 % (RR, 0,37 ; IC 95 %, 0,30-0,45), alors que l’antibiothérapie prophylactique n’a eu aucun effet significatif. Aucune des trois stratégies préventives n’a permis de réduire la mortalité toutes causes confondues. Sur le plan de l’acceptabilité, seuls les immunoglobulines et les antibiotiques ont retenu l’attention. Force est cependant de reconnaître que les études en question sont quelque peu biaisées, ce qui limite la portée de leurs résultats.
Cette revue de la littérature internationale met en exergue la rareté des études contrôlées visant à évaluer l’efficacité des moyens de prévention des infections chez les patients atteints d’hémopathies malignes, en l’occurrence LLC, LNH et MM. L’indigence de la recherche clinique dans ce domaine mérite d’être soulignée, face à la montée du péril infectieux et l’émergence de phénomènes nouveaux tels l’antibiorésistance ou l’aggravation iatrogène des déficits immunitaires. Sans parler de l’émergence d’agents microbiens nouveaux…
Dr Philippe Tellier




